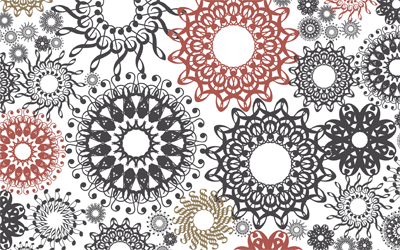Journal
Une Interview de Béatrice Uria-Monzon - " Chanter n’est pas quelque chose d’anecdotique "

Brune à la peau mate et à l'oeil de braise, Béatrice Uria-Monzon est aussi séduisante à la ville qu'à la scène. Sa franchise et son recul sur le métier de cantatrice qu'elle exerce depuis deux décennies, sont ceux d'une artiste sans complaisance, qui a toujours fait confiance au travail et à la vie. Mezzo réputée pour ses incursions dans le répertoire français, cette Carmen de renom ne néglige ni Verdi, ni Wagner, franchissant même les frontières du soprano comme l'an dernier à Orange où elle a tenté Santuzza (Cavalleria rusticana), avant d'aborder prochainement Tosca. Rencontre avec une musicienne intègre doublée d'une femme d'exception, que l'on pourra à nouveau entendre sur la scène de l'Opéra Bastille du 7 mai au 3 juin, dans le rôle de Giulietta des Contes d'Hoffmann d’Offenbach.
Contrairement à certains artistes, vous n'étiez pas programmée pour la musique ; avec le recul, considérez-vous le temps de réflexion que vous avez pris comme essentiel et finalement comme un trait de votre caractère ?
Béatrice Uria-Monzon : Vous savez, je n'ai pas débuté le piano ou le violon dès cinq ans, mais j'ai commencé à suivre des cours de chant à dix-huit ans, ce qui n’est pas si tard que ça. Bien sûr certains de mes collègues ont suivi un cursus musical plus précoce que le mien, mais je reste persuadée que l’on ne sait jamais à l’avance si l’on est fait ou pas pour mener une carrière : qui peut savoir avec assurance quel sera le cours de votre existence ? Personne. Combien de jeunes bardés de diplômes et de prix de conservatoire, restent au bord du chemin, tout est si aléatoire. C’est la vie qui décide, les rencontres que l’on fait, le hasard. A bien y regarder, je suis issue d'un milieu artistique, j'ai fait de l'histoire de l'art, j'ai baigné dans un univers propice et ne m’en suis pas éloignée. Il est exact que j'ai du recul par rapport aux choses, aux événements, suis quelqu’un de réfléchi, capable de foncer mais avec prudence. Je ne pense pas avoir commis trop d'erreurs par rapport aux répertoires et aux rôles que j’ai choisi d’aborder. Certains peuvent me reprocher de ne pas être allé assez vite, de ne pas avoir accepté d’étaler ma vie privée dans les médias, mais cela fait partie de mon caractère, ce sont des choix de vie et j’ai toujours préféré rester discrète.
La présence d'un artiste dans la famille, en l'occurrence votre père, le peintre Antonio Uria-Monzon disparu en 1996, a-t-elle été, dans un premier temps, quelque chose de difficile à assumer et donc à dépasser ?
B. U. M. : Je considère cela comme une chance, car mon père et ma mère connaissaient très précisément les joies et les difficultés d'être artiste. Ils ont éprouvé les mêmes inquiétudes que n’importe quels parents. Je suis moi même mère et si ma fille me disait quelle voulait être artiste je serai également très inquiète. Le fait d’avoir évolué dans un milieu artistique a été un atout, car mes frères et moi avons visité de nombreux musées, avons vu mon père peindre, nous parler de l'art, et même si la peinture n'est pas le chant, la démarche artistique est équivalente. Je suis convaincue que tout cet acquis a été un plus.
Vous n'êtes pas la première à dire qu'en France l'enseignement musical est catastrophique. C'est pourtant là que vous avez appris la musique et le chant d'abord au Conservatoire de Bordeaux, puis au CNIPAL de Marseille et enfin à l'Ecole d'art lyrique de l'ONP. Qu'est-ce qui manque selon vous aux structures et aux professionnels français, pour être véritablement opérants ?
B. U. M. : Si je le savais (rires) ! Je suis restée peu de temps dans les structures auxquelles vous faites allusion : un an et demi à Marseille et deux ans à Paris et suis intimement convaincue qu'il faut savoir que l'on est son propre professeur. C’est terrifiant et facile à dire, je sais, mais l’étude du chant c'est l’histoire de toute une vie, je vous assure. Un professeur, comme un père ou une mère doit être un guide, mais qui peut savoir ce qui ce passe en nous ? Il faut beaucoup de courage, de capacité à se connecter à ce que l'on est pour le découvrir. Je crois énormément au travail personnel et à la rencontre avec soi-même, qui peut avoir des résonances très douloureuses. Je me souviens d'un professeur qui me conseillait des tas de choses qui ne marchaient pas avec moi, c’est pour cela qu’il faut connaître l'imaginaire de celui que l’on est censé guider. Certains professeurs préconisent une technique qui utilise le larynx bas, mais que fait l’élève qui arrive avec une position du larynx déjà basse ? Faut-il absolument le faire descendre encore plus bas ?
Nous sommes les seuls à être habilités à ressentir cela profondément, mais ce n’est pas facile, car il faut faire abstraction de ses fantasmes. Combien de filles veulent être mezzo et arrivent avec des voix exagérément grossies. Un de mes amis qui enseigne me racontait qu’il avait travaillé avec un jeune homme qui forçait sa voix, pour faire croire qu’il était baryton alors qu’il avait tout d’un ténor, jusqu’au jour où il est arrivé en larmes et lui a avoué qu'il était homosexuel mais ne l'assumant pas, voulait absolument avoir une voix « d'homme », pour faire plaisir à son père. Vous voyez comme cela peut aller loin. Chanter n’est pas quelque chose d’anecdotique.
Comment avez-vous réagi lorsque vous avez découvert votre tessiture de mezzo? Auriez-vous préféré être soprano ?
B. U. M. : A mes débuts je n’avais même pas un fa dans la voix et j’ai dû sculpter non pas une voix, mais une masse vocale, que je ne saisissais pas très bien. A force de travail et de patience j'ai réussi à obtenir des aigus qui m’ont conduite sur les rivages du soprano, mais j'ai senti peu de temps après que je perdais mon identité vocale, ma couleur, cette marque de fabrique qui nous différencie des autres, dans un monde où tout doit avoir le même goût, où tout doit être pareil. Un jour dans la voiture de mon père j'ai écouté de vieilles cassettes et me suis aperçue que j'avais renoncé à une grande partie de moi-même. J'ai donc retravaillé le registre de mezzo ; l'enseignement est un sujet très vaste. J'écoute les conseils de professeurs de chant et me rends compte de la complexité de cet exercice.
Nous sommes très sollicités par des jeunes qui attendent des recettes miracles, alors qu'il faut partir de son corps et prioritairement de sa voix parlée : pour moi c'est la logique. Il ne faut pas aller contre, les bases du chant, de son fonctionnement doivent rester similaires, que vous chantiez Venus ou Amneris. Ce grand rôle verdien n'est sans doute pas le rôle de ma vie, mais je voulais l'essayer pour me rendre compte. Quand j'ai interprété Adalgisa dans Norma avec maestro Giuliano Carella, je venais juste de l'aborder et il m'a conseillé de chanter Bellini de la même manière et il n'avait pas tort. Il y a des exigences, bien sûr, mais il faut trouver une ouverture appropriée pour Amnéris, sans grossir inutilement la voix, les cordes vocales et le souffle demeurant les mêmes.
Vos débuts sur scène ont été très rapides : était-ce l'envie de rattraper le temps perdu qui vous a donné des ailes ?
B. U. M. : Pas du tout, ce n'est pas dans mon caractère : je fais confiance à la vie et aux choses qui arrivent. Je n'avais rien à prouver, je suis sortie en juin 1989 de l'école et ai commencé avec Cherubino et quelques petits rôles, avant que Carmen ne me soit proposée quelques années plus tard.
L'année 1993 demeure une date importante puisqu'elle marque votre rencontre avec le rôle de Carmen. Vos origines espagnoles vous ont-elles été utiles pour ressentir ce personnage, qui est devenu votre rôle fétiche et pensez-vous l’avoir immédiatement compris ?
B. U. M. : Au départ elle m'a fait très peur, pas vocalement car la partition ne contient pas de réels dangers, mais j’ai tellement entendu de choses à son sujet que j'y suis allé prudemment. Le personnage m’intriguait mais plus encore l'idée que les gens en attendaient et que j'étais incapable de leur donner, de part mon caractère et ma pudeur. N’étant pas d’une une nature extravertie, je ne voulais ni taper des pieds, ni rouler les yeux, ni remonter mes jupes à tout bout de champ. On m'a demandé qui j'avais écouté, quelle était ma référence, mais j'ai préféré répondre que je ne souhaitais imiter personne, étant suffisamment angoissée comme cela. José Luis Gomez le metteur en scène, n'a pas totalement convaincu, ce que je déplore, car sa lecture était très belle. Toutes les images qu'il employait étaient justes et m’ont rappelé les propos de mon père sur les gitans, qu'il avait côtoyés. Cette vision espagnole m'a beaucoup aidé. Je peux dire en revanche, que je comprenais la femme, car le texte n'indique jamais que l'on doive se trémousser dès la habanera, c'est un contresens. Pourquoi relever la jupe et lancer des œillades ? Ce n'est pas Carmen qui décide, c'est la vie, le destin.
Carmen vous colle à la peau depuis près de vingt ans, oeuvre que vous craignez de galvauder et dont vous défendez depuis le début une conception très personnelle. Qu'est-ce qui vous pousserait à ne plus l'interpréter et pourquoi ?
B. U. M. : J’ai le sentiment qu'on en fait n'importe quoi, et cela m’insupporte. Je sais que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre de cette œuvre et n'attends que cela ! Or, je n’apprends plus. Certains metteurs en scène considèrent que je la connais tellement bien, que je n’ai pas besoin d’eux et que je me débrouillerais très bien en scène. Je n'ai pas pu m’empêcher un jour de demander à l'un d’entre eux de me donner son cachet. J'ai fondamentalement besoin de raconter une histoire et refuse tout ce qui peut être convenu, car j'ai besoin d'être portée et ne veux pas recourir à la facilité. Je dois la retrouver à nouveau à deux reprises, mais je refuse de nombreuses propositions.
Parlons de votre répertoire et de l'évolution de votre instrument : à la différence de votre consoeur Sophie Koch qui a beaucoup fréquenté Mozart et Strauss, vous avez d'emblée abordé le répertoire français avec Berlioz, Massenet, Thomas, Saint-Saëns, italien avec Verdi, Bellini, Donizetti, Wagner et Bartok n'arrivant que récemment. Comment expliquez-vous ces choix : répondent-ils à un plan de carrière ou reflètent-ils le hasard des propositions ?
B. U. M. : Le hasard et la logique, car à mes débuts on me disait que je n’étais pas faite pour Mozart, que je ne vocalisais pas assez bien pour Rossini, et que ma voix n’était pas assez puissante pour aborder Verdi. N’ayant pas suffisamment d'aigus pour me diriger vers certains rôles de soprano dramatique, j’ai accepté les propositions que l’on me faisait. Le répertoire français s'est imposé tout naturellement, craignant de m’aventurer chez Wagner, j'ai par prudence refusé les engagements qui se succédaient, pour conserver ma voix et je pense avoir bien fait. Berlioz est vocalement idéal, car il demande une couleur de mezzo tout en permettant des envolées vers le soprano. J'aime énormément Didon des Troyens, ce rôle me touche : peut-être oserais-je un jour Cassandre. Nous verrons.
Depuis 1993, vous avez été fréquemment entendue à la Bastille dans Don Quichotte, La Damnation de Faust, L'Amour des trois oranges, Tannhäuser, Le Château de Barbe-Bleue (à Garnier) et Les Contes d'Hoffmann, production bien connue de Robert Carsen que vous répétez en ce moment. Avez-vous le sentiment d'avoir créé des liens avec cette salle et son public, ou y chantez-vous comme s'il s'agissait de n'importe quel autre théâtre ?
B. U. M. : Avec le public je ne sais pas, même s'il me connaît bien, mais j'ai une affection particulière pour ce théâtre et tant pis si je préfère l’architecture du Palais Garnier. J'ai de tels souvenirs artistiques que je m'y sens chez moi (rires). Comme vous le disiez, j'y chante depuis presque vingt ans et des liens très forts se sont tissés avec des personnes qui y travaillent toujours. Je me souviens de ma première Carmen, j'étais pétrifiée, mais les choeurs m'ont soutenue, se sont montrés enthousiastes, m’ont envoyé des fleurs ; c'était très fort. La partie administrative et technique est également très présente et accueillante.
Pourriez-vous décrire cette production dans laquelle vous interprétez le rôle de l’intrigante Giulietta, à ceux qui n'auraient pas vu la production et nous parler de votre personnage ?
B. U. M. : La production, comme toutes celles signées de Robert Carsen, est à son image, brillante, intelligente et bien construite. Pleine d'humour également, car l'oeuvre s’y prête. L'acte de Giulietta est insolite avec ce théâtre dans le théâtre, Garnier dans la salle de Bastille, c'est très amusant à la fin lorsque tout se fige ; le rôle est celui d’une séductrice et je rêve souvent d'interpréter les trois personnages, ce doit être phénoménal ; mais c'est totalement proscrit, je le sais bien. Giulietta est très difficile à chanter, car le rôle n'est pas toujours bien écrit, même s'il est court, il peut être dangereux vocalement. Autant certaines oeuvres sont parfaites, comme Adalgisa par exemple qui ne procure que du bonheur pour la voix, ou Chimène du Cid, que je travaille actuellement. Didon est proche de Gulietta, mais beaucoup mieux écrite.
Vous avez abordé l'été dernier à Orange le rôle de Santuzza dans Cavalleria rusticana, qui comme Carmen peut être chanté indifféremment par des sopranos ou des mezzos, à la différence d'Amneris ou d'Eboli. Peut-on parler d'un nouveau cap, confirmé par une autre prise de rôle audacieuse prévue en mai 2012 à Avignon, Tosca ?
B. U. M. : Il faut faire attention avec un rôle comme Tosca, mais ce challenge n'est pas insensé. Il comporte trois uts difficiles, mais le premier duo ne me pose pas de problème et je dois veiller à ne pas me laisser emporter pendant celui avec Scarpia. J’ai chanté le rôle à Raymond Duffaut qui voulait m'entendre, mais ne le chanterai pas à Orange : il faut être prudente. Mais vous savez il est en général très difficile de refuser les offres qui nous parviennent, il faut savoir ménager les susceptibilités de certains directeurs qui peuvent se vexer si je suis déjà engagée ailleurs. C'est une réalité que nous devons prendre en compte.
Vous avez su, malgré vos multiples invitations à l'étranger, rester fidèle à la France où l'on vous entend fréquemment de Montpellier à Marseille, de Strasbourg à Avignon, Orange, Bordeaux ou Paris. Là encore est-ce une attitude volontariste de votre part, ou un heureux concours de circonstances ?
B. U. M. : J'ai la chance d'être appréciée par ces directeurs, qui font confiance aux artistes français. Pendant un temps, je me suis souvent produite entre Bordeaux et Toulouse, ce qui faisait sourire mon agent, mais je devais mener de front ma vie de famille et mon métier, et cela m‘allait très bien.
Vous qui chantez en français, en allemand, en hongrois, en russe et en espagnol, quelle est la langue qui convient le mieux à votre voix ?
B. U. M. : J'ai peu chanté en russe, mais c'est avec l'italien la langue où ma vocalité s'épanouit le mieux, en raison de l'ouverture naturellement plus large qui facilite la rondeur du son et me procure un réel confort vocal. Le français est moins évident, ce qui explique que bien des chanteurs étrangers n'aiment pas s’y frotter, mais j'aime beaucoup chanter cette langue et ce répertoire.
Propos recueillis par François Lesueur, le vendredi 16 avril 2010 à l’Opéra Bastille.
> Programme détaillé de l’Opéra Bastille
> <a data-cke-saved-href="mailto:administration@concertclassic.com?subject=Une Interview de Béatrice Uria-Monzon - " href="mailto:administration@concertclassic.com?subject=Une Interview de Béatrice Uria-Monzon - " chanter="" n’est="" pas="" quelque="" chose="" d’anecdotique"="">Vous souhaitez répondre à l’auteur de cet article.
> Lire les autres articles de François Lesueur
Photo : DR
---------------------------
À CONSULTER ÉGALEMENT

> Le Cid de Massenet avec Roberto Alagna et Beatrice Uria-Monzon
Derniers articles
-
05 Mars 2026Le Duo Reflet au Festival Elite de l’Ecole Normale de Musique (Salle Cortot) – Splendide maturationAlain COCHARD
-
04 Mars 2026Alain COCHARD
-
04 Mars 2026Laurent BURY