Journal
Béjart Ballet Lausanne au Palais Garnier – Béjart for ever – Compte-rendu

On le dit souvent démodé, ce qui est fréquent avec la danse, émanation fugace de la sensibilité d’une époque, et particulièrement pour lui qui se voulut témoin de son temps et non bâtisseur d’une œuvre. Certaines pièces de Béjart, certes, ne parlent plus aujourd’hui, ainsi Messe pour le Temps présent, ou L’Oiseau de feu, revu récemment au Palais Garnier, et qui a perdu ses plumes, alors que son Sacre du printemps, auquel on préfère aujourd’hui celui de Pina Bausch, est sans nul doute la plus parfaite transposition scénique du scandaleux chef-d’œuvre. On dit aussi que son héritage, ce Ballet Béjart Lausanne, créé en 1987, est comme vidé de sa portée depuis la mort du maître en 2007.
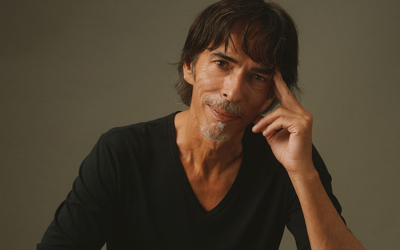
Gil Roman © Anoush Abrar
Juste du feu
Il n’en est rien, et la compagnie, venue sur le premier plateau français, vient d’en donner la preuve éblouissante, devant un public aussi fou d’enthousiasme qu’abasourdi par la leçon de danse qui venait de lui être donnée, si éloignée des ratiocinations et vulgarités à la mode. Pas de clinquant, juste du feu. Certes, la période qui suivit 2007 fut difficile, la troupe se cherchant, d’autant que les dernières œuvres d’un Béjart épuisé ne méritent pas qu’on s’en souvienne. Mais à ce jour, grâce à Gil Roman, son directeur artistique, personnage complexe et torturé, mais infiniment doué et qui fut un de ses grands interprètes, Béjart revit, et le choix intelligemment opéré dans cette œuvre énorme a permis une remise en mémoire plus que parlante pour le public parisien. On imagine combien il a été difficile de tailler dans cette masse, pour montrer au mieux l’excellence des danseurs et la pureté d’écriture d’un créateur qui sut allier graphisme, mystique et fabuleuse gestique : avec un sens des ensembles qui le promena sur des scènes circulaires dans le monde entier, et un lyrisme torrentiel, ce qui s’est généralement perdu depuis lui, la danse s’animalisant ou s’intellectualisant de plus en plus.
Comme un courant fondamental
Lui nous donne une danse qui n’est pas seulement une réflexion ou un dessin, mais une invite à rejoindre les élans du monde, de la rêverie, de la passion, en un œcuménisme chorégraphique et philosophique (on sait qu’avec son père, Gaston Berger, il fut à bonne école) qu’on a pu trouver touchant, et qui prend aujourd’hui une valeur accrue, qu’il se cherche dans le soufisme, le judaïsme, l’hindouisme et le christianisme, sans parler du retour aux sources antiques. Shiva dansait, comme David devant l’Arche, comme le thyrse de Dionysos, et grâce à Béjart et à sa mobilité transcendante, on ressent ce frémissement, cette vibration, comme un courant fondamental qui emporte loin des diktats du corps dit civilisé et bridé. Mais sans jamais atteindre à l’hystérie, cette destructrice de toute harmonie.

Tous les hommes ( Jasmine Cammarota ) © Gregory Batardon
Une mélancolie un peu trouble
On passera, sans aucune animosité ou dédain sur la trop longue pièce de Gil Roman qui ouvre le programme, intitulée Tous les Hommes presque toujours s’imaginent. D’un texte, on dirait qu’il est bavard. D’enchaînements de mouvements ici, on trouve qu’ils sont répétitifs et ne permettent pas la compréhension, car l’œuvre est peu structurée, même si le personnage central, une sorte de revenant habité par les souvenirs, permet de créer un climat de mélancolie un peu trouble, et prenant par moments. Et surtout, on admire l’extrême qualité des danseurs, leur beauté et leur engagement dans cette longue quête qui se veut existentielle. Ils sont magnifiques, notamment Jasmine Cammarota, algue fluide, et le très habité Vito Pansini, dans un rôle difficile. Quant à la musique, enregistrée, elle n’est pas du meilleur John Zorn, dont on sait la multiplicité d’inspiration et l’étrangeté, qu’il soit qualifié d’Eléphant constipé dans des fils barbelés ou compositeur d’une étincelante transcendance.

Bakhti III (Mari Ohashi) © Laurent Philippe - OnP
En une énergie commune
Puis vient l’explosion, avec Bhakti III (photo), dernier volet d’une trilogie qui mit en scène trois grandes divinités hindouistes et leurs parèdres. Un moment de danse intimement lié aux inspirations de la jeunesse soixante-huitarde, fascinée par le Népal et la culture indienne, et que les augures locaux fustigèrent vigoureusement, car il ne leur plaisait guère de voir leurs divinités sacrées mises en représentation. Si les deux premières phases ont à peu près disparu des scènes, la troisième, montrant Shiva et Shakti, est devenue un grand classique. Et lorsque le rideau se lève sur cette figure double d’énergie à la fois statique et prête à bondir, comme les cent bras de dieux embrassant la création, on reçoit un choc. Puis vient le cliquetis de la musique indienne, la variation syncopée, d’une extraordinaire écriture tout en secousses érotiques et provocantes de Shakti, la violence du solo de Shiva, les deux s’emboîtant pour ne créer in fine qu’une énergie commune. La divine symétrie des figures déployées, la fulgurance des pas autant que le caractère immobile des visages des danseurs produisent un contraste surprenant. Créé par le tandem prestigieux Maïna Gielgud-Germinal Casado (lequel en a signé les costumes écarlates), repris ensuite par d’illustres danseurs, notamment Marie-Claude Pietragalla, le tableau, avec ici les étincelants Mari Ohashi et Alessandro Cavallo, provoque toujours la même émotion.

Duo ( Valerija Franck & Julien Favreau ) © Laurent Philippe - OnP
Fusion désespérée
Puis, même sens de l’équilibre, du déploiement au cordeau des corps enlacés, dans un Duo islamisant, extrait du ballet Pyramide, qui demande aux danseurs, ici la poétique Valerija Franck et le toujours beau Julien Favreau, une formidable concentration et un énorme travail de mise au point (on peut signaler à ce propos que le maître de ballet de la compagnie n’est autre que le grand Ruichi Kobayashi, jadis l’un des grands interprètes de Béjart). Avec Dibouk, où un couple – subtils Kathleen Thielhelm et Dorian Browne – s’entrelace en une fusion désespérée, suivant les rites kabbalistiques, on entre dans un monde magique, où l’âme se grise et se perd. Là encore, deux interprètes inspirés, sur fond de musique traditionnelle juive d’Europe Centrale, sans jamais tomber dans l’exotisme.

7 Danses grecques ( Oscar Eduardo Chacón ) © Laurent Philippe - OnP
Pulsion vitale
Une tentation de folklore également évitée dans les 7 Danses grecques, sur lesquelles culmine le programme : pièce abondamment donnée et dont l’impact demeure, sans être un instant abîmé par le temps. Le secret de cette longévité ? L’habileté avec laquelle Béjart, face à un sujet dionysiaque qui lance des corps uniquement portés par le génie de la danse, évite tout exotisme, malgré la forte couleur de la musique de Theodorakis, et dessine, comme sur des vases, une longue fresque d’attitudes, de rondes, de tourbillons, qui ne sont qu’invite au mouvement dans ce qu’il a de vital. A preuve, au lieu de tuniques flottant au vent, et de blouses légères, les danseurs sont vêtus avec la plus extrême rigueur, collants académiques, avec maillots pour les filles et torses nus pour les garçons.
Charisme intact
Et au milieu de cet autre Boléro, un être à part, épaules larges, cheveux fous et cambré sacré : Oscar Eduardo Chacón, aussi habité que sut l’être Jorge Donn et dégageant, bien qu’il ne lui ressemble guère, la même aura de griserie, de volupté. Un artiste dangereux pour ceux qui l’entourent, car il dévore littéralement l’espace et capte l’attention comme un phare. De ceux que Stravinsky et Béjart appelaient l’Elu. Et que l’on regrette de connaître aussi peu car on l’a rarement vu en France, malgré une réputation internationale flatteuse. Un charisme que Béjart lui-même repéra il y a vingt ans, et qui demeure intact. Il est donc temps de suivre cette merveille venue de Colombie, avant qu’il ne s’envole … Le voir emmener ses compagnons dans l’ivresse est un moment qui ne se laisse pas oublier.
Bravo à Béjart pour sa savante pratique, sa sincérité, son sens du spectacle autant que la force de ses élans solaires, et bravo à Gil Roman pour la rigueur avec laquelle il garde présent le souffle de ce régénérateur de la danse, et sait transmettre un héritage incomparable.
Jacqueline Thuilleux

Béjart Ballet Lausanne – Paris, Palais Garnier, 6 janvier 2024 // www.operadeparis.fr/saison-23-24/ballet/bejart-ballet-lausanne
Photo © Gregory Batardon
Derniers articles
-
24 Février 2026Antoine SIBELLE
-
23 Février 2026Alain COCHARD
-
21 Février 2026François LESUEUR







