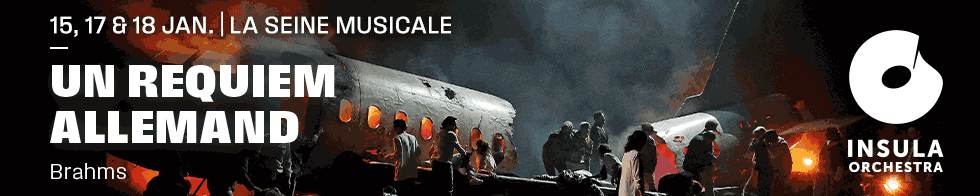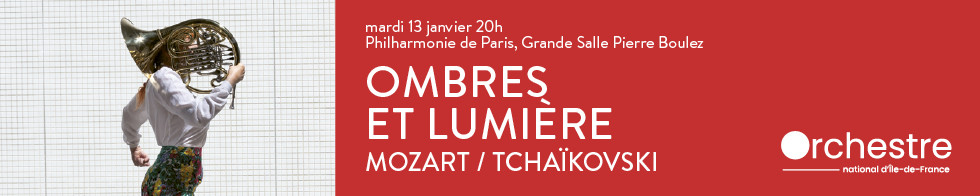Journal
Le Chevalier à la rose au Théâtre des Champs-Elysées – Schwärmerei alla Warli — Compte rendu

En confiant cette nouvelle production du Rosenkavalier à Krzysztof Warlikowski, le TCE a obtenu ce qui était prévisible : du Warli, mais du Warli assez peu inspiré, une resucée de ses précédents spectacles, entre auto-citation et hommage réflexif à son propre art. On y trouve donc un lavabo, un clone d’Amy Winehouse (souvenir de la Médée jadis proposée dans ce même Théâtre des Champs-Elysées), des figurants/danseurs issus de l’immigration, un concours au plus grand nombre de personnages allumant une cigarette sur scène, le tout entassé dans un décor unique de vieux cinéma, avec quelques-uns des costumes les plus laids qu’on puisse imaginer (un grand merci, une fois encore, à madame Małgorzata Szczęśniak).

Frontières brouillées
Inutile de chercher une véritable cohérence dans ce qui nous est montré, l’intrigue relevant désormais de ce qu’on qualifiait jadis de Schwärmerei, quand des jeunes filles se prenaient d’une folle passion pour une de leurs camarades ou de leurs enseignantes, puisque l’on ne sait plus qui est Octavian : genderfluid, nous dit-on, mais ses tenues semblent nettement tirer vers le féminin, et surtout sa métamorphose en Mariandel ne lui coûte absolument aucun effort – c’est à peine si l’on reconnaît le « jeune homme » lorsqu’il reparaît en femme de ménage, rien ne trahissant le travestissement (et on se demande comment Ochs reconnaît Mariandel lorsqu’au dernier acte, celle-ci est à nouveau transformée, en Amy Winehouse comme dit plus haut). Le lever de la Maréchale devient un vague défilé de – plus ou moins – beautiful people dont on s’explique mal la présence ; on sourit néanmoins de voir l’intervention du chanteur italien se changer en tournage d’une sorte de clip aberrant, et l’idée de transformer le monologue de la maréchale en réalisation d’une vidéo confessionnelle était une piste qu’il aurait peut-être été judicieux d’exploiter.
Histoire vécue ou jouée, représentée ? On ne sait pas trop, et les frontières sont soigneusement brouillées entre réalité et comédie puisque, lors du duo final, Sophie recoiffe Octavian pour rendre sa liberté à la véritable chevelure de sa partenaire, et l’on retrouve le visage de l’artiste incarnant le rôle-titre tel qu’il était apparu dans les premiers instants du spectacle, sur une vidéo où on la voyait au naturel, partageant un moment de tendresse sous la couette avec sa consœur incarnant la Maréchale.

> Voir l'extrait "Di rigori armato il seno" par Francesco Demuro <
Sous la direction alerte d’Henrik Nánási
On se serait d’ailleurs bien passé de cette projection initiale, inutilement superposée à l’une des musiques les plus éloquentes qu’ait composées Richard Strauss, d’autant plus que la partition est superbement servie par l’Orchestre National de France, sous la direction alerte et convaincante d’Henrik Nánási. A défaut d’avoir l’œil ravi, le mélomane a au moins la satisfaction d’entendre une fort belle exécution de l’œuvre, avec une distribution où brillent quelques interprètes remarquables. De la prolifération de figures secondaires, on détachera l’aubergiste plein de vivacité de Yoann Le Lan et la conquérante Annina d’Eléonore Pancrazi, aux côtés de Krešimir Špicer dont on avait déjà pu apprécier le Valzacchi à Avignon en 2021. Si Jean-Sébastien Bou ne trouve pas vraiment en Faninal un personnage lui permettant de déployer au mieux son talent, Francesco Demuro est en revanche parfait en chanteur italien, le théâtre s’étant donné les moyens d’engager un interprète de premier plan pour ce rôle bref mais marquant.

L'éclatante revanche de Véronique Gens
Si l’on se concentre sur le quatuor central, on s’avoue un peu déçu par la prestation de Peter Rose, pourtant spécialiste d’Ochs : la basse britannique semble ce soir en méforme, éprouvant le besoin de porter très régulièrement la main à son oreille droite, avec un volume sonore parfois confidentiel, et une justesse aléatoire pour son ultime note du deuxième acte. Regula Mühlemann réussit la prouesse d’être une Sophie exquise et pleine de piquant malgré une vilaine robe moutarde, puis un costume encore plus hideux à la fin. Après le forfait de Marina Viotti (en 2021 à Avignon, c’est un autre Octavian français, Violette Polchi, qui avait renoncé in extremis), Niamh O’Sullivan fait mieux que sauver le spectacle avec un Octavian de très haute tenue, à la voix riche et expressive et des ressources théâtrales qu’on espère revoir mieux utilisées. Véronique Gens, enfin, convainc pleinement dans son virage vers un répertoire où on l’a jusqu’ici peu entendue : il y a quelques années, en interview, elle exprimait le regret qu’on ne lui ait jamais proposé Octavian, mais elle prend ici une éclatante revanche avec cette conversation en musique où la noblesse de son phrasé fait merveille, même lorsqu’elle est affublée d’une tenue ridicule au premier acte. On attend maintenant avec impatience de l’applaudir en Elina Makropoulos la saison prochaine …
Laurent Bury

> Les prochains opéras en Ile-de-France <
Richard Strauss : Der Rosenkavalier. Théâtre des Champs-Elysées, 21 juin ; prochaines représentations les 24, 27 mai, 2 et 5 juin 2025 // www.theatrechampselysees.fr/saison-2024-2025/opera-mis-en-scene/le-chevalier-a-la-rose
Photo © Vincent Pontet
Derniers articles
-
05 Janvier 2026Frédéric HUTMAN
-
05 Janvier 2026Alain COCHARD
-
05 Janvier 2026Alain COCHARD