Journal
Yvonne, princesse ambiguë - Création mondiale à Garnier
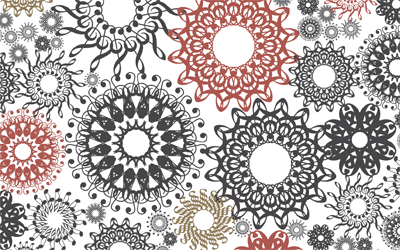
En adaptant Yvonne, princesse de Bourgogne, le compositeur belge Philippe Boesmans poursuit une œuvre lyrique riche en paradoxes. Paradoxale, la pièce de Witold Gombrowicz l’est à coup sûr, qui fait d’un personnage mutique, falot, a priori sans consistance, son rôle-titre, envahissant par sa présence immobile. Yvonne est choisie comme fiancée par le prince Philippe au nom de ce seul principe qu’il énonce à la fin du premier acte : « Seule une beauté aurait le droit de me plaire et pourquoi pas une horreur ? ». Dès lors, elle devient le révélateur, le catalyseur des travers de la cour.
Philippe Boesmans a bien vu le parti qu’il pouvait tirer d’une telle intrigue et d’un tel personnage : en transposant la pièce à l’opéra, il en décuple la corrosive absurdité. Yvonne parle peu (sept répliques minimales et redondantes sur les deux heures que dure l’opéra) et ne chante jamais. Mais elle est là, irritante par son silence, irritante plus encore lorsqu’elle ouvre la bouche. L’actrice Dörte Lyssewski, égérie des grandes figures du théâtre contemporain (Peter Stein, Heiner Müller, Klaus Michael Grüber), lui donne une extraordinaire présence, aux limites de la chorégraphie et, comme le glisse Cyprien (très bon Jean-Luc Ballestra) au prince Philippe à l’acte II : « elle te dévore des yeux ». C’est tout le petit monde de la cour qui s’agite autour d’elle.
Coauteur du livret avec Marie-Louise Bischofberger comme pour les précédents opéras du compositeur, Wintermärchen (1999) et Julie (2005) – il avait écrit seul celui de La Ronde (1993) –, Luc Bondy signe une mise en scène juste, qui n’épargne jamais au spectateur la vision de l’anti-héroïne. Au centre du plateau ou à ses extrémités selon les scènes, elle est toujours celle qui attire et attise les mouvements de la foule et la repousse en même temps. Certes, la peinture des cercles du pouvoir, très jet-set débraillée, n’est pas forcément originale mais elle révèle les béances esthétiques, morales et philosophiques d’un monde sûr de son bon goût. C’est un monde, comme l’a bien vu Luc Bondy, tiraillé entre l’héritage (le Chambellan de Victor von Hallem, basse grandiloquente qui évoque le Don Iñigo Gomez de L’Heure espagnole) et la supposée modernité (le roi Ignace, souverain vulgaire et décomplexé, interprété par Paul Gay).
Dans ses précédents opéras, Philippe Boesmans avait montré son art du détournement. Il en use encore avec une ironie ravageuse : danse de cour au beau milieu de l’ouvrage (scène finale de l’acte III) ou allusions wagnériennes du « thème d’Yvonne », à la fois solennel et grotesque. Le goût du compositeur pour une musique qui se délite le pousse à des harmonies instables, saisissantes dans l’écriture pour le chœur – la prestation de l’ensemble Les Jeunes Solistes est d’ailleurs remarquable, tant du point de vue scénique que musical. Son amour évident de la vocalité l’amène à écrire pour Mireille Delunsch une jubilatoire scène de prima donna et seul véritable « grand air » de l’œuvre, lorsque la Reine chante l’un de ses poèmes, mise en abyme devant le rideau tombé.
Pourtant, il semble manquer quelque chose à l’ouvrage pour qu’il porte l’invention aussi loin que l’avaient fait les précédents. Les scènes sont moins caractérisées musicalement qu’elles ne l’étaient dans La Ronde, où Philippe Boesmans prolongeait brillamment la leçon du Wozzeck d’Alban Berg. L’hétérogénéité musicale, qui aurait eu toute sa place ici, est plus timide que dans Wintermärchen, le mélange du lyrisme et de la prosodie qui faisait la force de Julie semble émoussé. Même le livret, pourtant une remarquable contraction de la pièce de Gombrowicz, n’est pas toujours satisfaisant : précipité, le quatrième et dernier acte – celui où naît et s’exécute le projet de la mise à mort d’Yvonne – participe à une certaine faiblesse dramatique de la fin de l’ouvrage.
Ces quelques réserves, dues avant tout à l’attente que suscite chaque nouvelle œuvre du compositeur belge, n’enlèvent cependant rien à la qualité de cette production, qui s’appuie sur une scénographie froide, décors géométriques de Richard Peduzzi habités par des mouvements d’acteurs d’une précision diabolique. Dans la fosse, la trentaine de musiciens de l’ensemble Klangforum Wien répond avec précision et lyrisme à la direction visiblement enthousiaste de Sylvain Cambreling et donne aisément l’illusion du grand orchestre. Yann Beuron, quant à lui, est parfait dans le principal rôle chanté, celui du Prince Philippe – et c’est une gageure pour ce personnage, fluctuant et tortueux, qui semble épouser toutes les contradictions de son environnement.
Jean-Guillaume Lebrun
Philippe Boesmans : Yvonne, princesse de Bourgogne (création). Palais Garnier, samedi 24 janvier 2009. Prochaines représentations les 28, 30 janvier, 3 et 5 février à 19h30, les 1er et 8 février à 14h30.
> Programme détaillé de l’Opéra Garnier
> Lire les autres articles de Jean-Guillaume Lebrun
> Les prochains concerts de musique contemporaine
Photo : Ruth Walz / Opéra national de Paris
Derniers articles
-
18 Février 2026Laurent BURY
-
17 Février 2026Jacqueline THUILLEUX
-
17 Février 2026Alain COCHARD







