Journal
Rideau
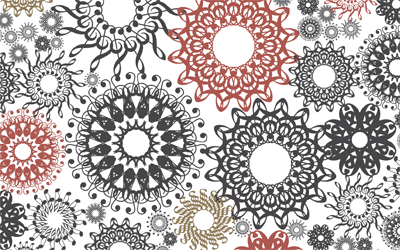
Un nouveau Simon Boccanegra pour Bastille ?
Transcrire Simon Boccanegra, dont une grande part de l’intrigue est portée par la politique au sens vulgaire comme au sens noble du terme, à l’époque contemporaine avec un clin d’œil appuyé aux récentes élections qui ont tenu en haleine l’Italie n’est pas une mauvaise idée, loin de là. Et en bien des occasions, la direction d’acteur assez juste de Johan Simons (photo ci-contre) fait mouche, outre que quelques unes de ses idées apportent un surcroît d’émotion. : ainsi la noce de Maria et de Gabriele qui vient assister à l’agonie du Doge.
Mais cette production qui aurait pu être emblématique du souci affiché par Gérard Mortier de réintroduire l’opéra dans notre temps est grevée par les décors rédhibitoires de Bert Neumann. Trop c’est trop : la laideur insigne de l’estrade, le seul élément de décor, (qu’on retournera au dernier tableau pour en faire le carcere), avec ces affiches hyperréalistes des représentants des deux partis, ces rideaux scintillants qui enclosent sur toute sa hauteur un cadre de scène ouvert intégralement, sont simplement, oui pardon, je ne trouve pas d’autres expressions, d’un goût de chiotte qui ne peut pas, ne doit plus, paraître sur la scène d’une maison aussi prestigieuse que l’Opéra de Paris. Impossible. Et pourtant, même ce rideau peut jouer un rôle : Simons le fait descendre en rideau de scène pour tout le premier tableau de l’acte II (là où Strehler, dont la production scaligère a trop brièvement hanté le Palais Garnier donnait à voir les hautes voiles de bateaux symboliques), qui se déroule donc sur le proscenium, et le fameux rideau scintille, mer verticale illuminée par les ondes solaires que décrit si bien l’orchestre. Autre écueil : l’action de Boccanegra, et ce dés le prologue qui n’éclaircit rien mais au contraire complique tout, est passablement embrouillée ; hors Joan Simons ne donne aucune piste qui permette au néophyte d’en démêler les trames.
Au lieu de vieillir Fiesco et Boccanegra pour nous indiquer les décennies qui séparent le prologue des trois actes, un méchant « 25 ans plus tard » affiché par projection règle le problème. On aura souvent le sentiment que ce metteur en scène de premier ordre – on se souvient encore de sa lecture si pertinente de « La caduta degli dei » d’après Visconti - a travaillé un peu rapidement au point qu’il a opté pour des solutions de facilité pour contourner les nombreuses difficultés que pose l’œuvre. Dommage, car la distribution réunie pour cette nouvelle production frôlait la perfection, du Boccanegra intense, au timbre si charbonnneux de Carlos Alvarez, au Fiesco torturé de Ferruccio Furlanetto, basse chantante idéale ici, à l’Amelia Grimaldi d’Anna Maria Martinez qui compense son timbre un rien plébéien par un engagement dramatique et un chant stylé, tous furent exemplaires à commencer par Frank Ferrari, toujours aussi épatant pour un Paolo dont il se garde bien de surcharger les vilenies.
Mais la révélation de la soirée aura été le Gabriele Adorno de Stefano Secco, ténor percutant qui donnait a son personnage un relief inédit et que le public fêta à juste titre. En fosse, Sylvain Cambreling signe sa plus belle prestation de la saison. Direction sombre, tendue, qui accentue l’une des données essentielles d’une partition dont la révision hanta la vieillesse de Verdi : le caractère dépressif, la morbidité immanente. Cet orchestre en gris colorés, qui prend exactement le contre-pied des lectures plus extraverties auxquelles nous avait habituées Claudio Abbado, Cambreling en exalte le caractère à la fois elliptique et expressif avec une justesse de propos déduite d’une longue fréquentation de l’œuvre.
Jean-Charles Hoffelé
Guiseppe Verdi, Simon Boccanegra, le 7 mai 2006, puis les 11, 14, 16, 20, 23, 25, 28 mai et le 1er juin.
Photo : Eric MAHOUDEAU/ Opéra national de Paris
Derniers articles
-
02 Mars 2026Vincent BOREL
-
02 Mars 2026Antoine SIBELLE
-
02 Mars 2026Jacqueline THUILLEUX







