Journal
Paris - Compte-rendu - Pour Karita Mattila. Reprise de l’Arabella selon et malgré Peter Mussbach.
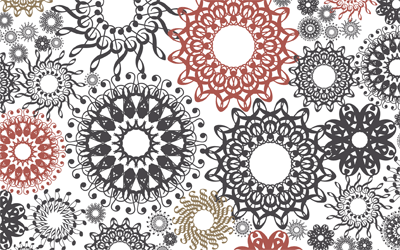
Arabella, un chef d’œuvre straussien ? Le livret d’Hofmannsthal, engoncé dans un style ampoulé et tirant plus souvent que de raison à la ligne, avec ses intrigues et ses quiproquos de coulisses téléphonés, n’est pas son meilleur, mais il peut être sauvé si le metteur en scène brosse de véritables personnages. Sous ses atours assez conventionnels, qu’essayent de racheter quelques smurfeurs et durant le bal de Carnaval une théorie de néo punks dépressifs, le discours de Mussbach est bien teuton, symptomatique de l’épidémie du « Regietheater » et souligne avec des sabots trop souvent : ainsi on vous explique que rien ne va plus en « bourgeoisieland » durant le prélude du III, en faisant marcher un quidam la tête en bas. Si vous ne comprenez pas, c’est que vous êtes irrécupérable.
Principal atout de cette production, son décor unique, produit esthétique plutôt prétentieux, qui marie les aplats dorés des fonds de tableaux de Klimt avec les escalators d’un centre commercial. On s’en lasse avant même la fin de l’acte I, même si il autorise avec ses trois plans superposés une circulation fluide sinon inspirée des comédiens. L’Arabella de Karita Mattila rayonne, seul atout absolu d’une distribution inégale. Passée par les épreuves de Jenufa et de Salomé, la finlandaise s’est enfin départie de sa légendaire froideur, elle incarne une héroïne flamboyante loin des pseudo aristocrates façon Della Casa. Qui d’autre a osé une Arabella aussi volontariste sinon Eleanor Steber ? Personne à notre connaissance et surtout pas Julia Varady, si longtemps fêtée dans cet emploi à Munich.
Son Mandryka, un Thomas Hampson assez formidable de présence, souffre hélas de désordres vocaux inquiétants, médium usé, graves sans assises, aigus escamotés ; le geste, aussi éloquent soit-il ne pallie pas à l’absence de la voix. Barbara Bonney, déstabilisée par une trachéite , chantât le I, mais elle fut doublée par Jeni Bern pour les actes suivants. Le soprano tranchant de la jeune anglaise était une heureuse surprise, on aimerait la voir en scène, c’est probablement ce qui arrivera si Barbara Bonney ne se rétablit pas.
Quelques seconds rôles soutenaient l’attention : l’Adelaïde jamais hystérique de Rosalind Plowright, le Matteo suicidaire, un peu éprouvé au III, de Stephan Rügamer, mais la palme revenait au Lamoral de Nicolas Courjal : en quelques répliques il imposait sa voix de basse chantante qui portait sans effort. On regrette, mais c’est devenu la règle hélas, la coupure des dernières pages du II, avec la coda enivrante de Fiakermilli et des invités, d’autant que la colorature pimentée de Chantal Perraud y faisait mouche.
En fosse, les splendeurs du Philharmonia ne masquaient pas la direction routinière de Günther Neuhold, tirant l’œuvre vers la comédie sentimentale, méprisant son orchestre suractif, en gommant les rythmes et les arrêtes. Décidément, Christoph von Dohnanyi, condamné au repos par l’opération de sa phlébite, nous manquait cruellement. Lui seul aurait pu donner la touche de névrose sans laquelle Arabella n’est plus qu’une partition de second rayon, qui cumule ses atermoiements sentimentaux et ses tirades convenues jusqu’à la nausée.
Jean-Charles Hoffelé
Richard Strauss : Arabella, Theâtre du Châtelet le 25 mai, puis les 28 et 31 mai. Strauss en DVD
Photo: M.N. Robert
Derniers articles
-
04 Février 2026Jacqueline THUILLEUX
-
04 Février 2026Jean-Guillaume LEBRUN
-
04 Février 2026Vincent BOREL







