Journal
Paris - Compte-rendu : La Juive à l’Opéra Bastille : un retour trop espéré
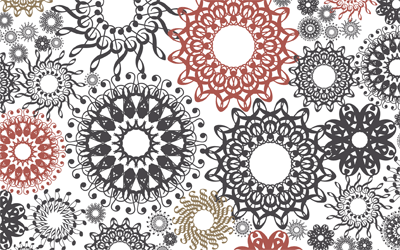
Le grand problème de La Juive n’est pas tant son livret – dramatique à souhait et plein d’arrière-plans qui exploitent les psychologies complexes de tous les personnages (il n’y a que Ruggiero qui soit univoque) – mais bien la pauvreté de plume que lui a consenti un Scribe au plus bas de ses moyens sans évoquer même une improbable inspiration. La meilleure poésie de l’ouvrage se trouve sans conteste dans le grand air d’Eléazar dont l’auteur n’est autre qu’Adolphe Nourrit.
L’autre grande improbabilité de La Juive n’est pas tant son orchestration, ingénieuse mais qui se délite dans de nombreux ponts qui avouent leurs formules d’école, que l’impossibilité démontrée par l’auteur à réussir au fond le grand opéra qu’il espérait et que Meyerbeer ou Auber manufacturaient avec un art autrement trempé. Car enfin, ce qui fait la valeur de cette partition est avant tout la modernité de son sujet et la force psychologique qui sous-tend les rapports si enchevêtrés des uns avec les autre : Halévy obéit d’ailleurs à cette logique en composant la plupart des numéros dans un caractère intimiste.
Pierre Audi et Daniel Oren ont pourtant un peu trop tiré la couverture dans ce sens, au point que l’enfant d’Halévy peinait à se faire passer pour un grand opéra, sinon par sa longueur, qui n’était plus imputable aux monstruosités du genre – exit les ballets, exit la cabalette d’Eléazar (« Dieu m’éclaire ») et tout le final du IV, plus grave, pas de Boléro d’Eudoxie, un comble quand on a sous la main Annick Massis – mais bien à la lenteur subtile certes mais trop constante d’une battue qui semblait diriger plutôt Parsifal que La Juive. A ce titre tout le I s’arrêtait plus souvent qu’il ne prenait son élan, et les deux épisodes où la vie d’Eléazar et de Rachel sont mises en péril faisaient redondance, ne trouvant jamais leur impact dramatique.
Mais pas seulement : Pierre Audi, qui aurait dû débarrasser sa mise en scène lavellienne des scories qui l’encombrent – ces clones qui esquissent leur ballet breakdance, le toc toc de la garde d’Eudoxie frappant au linteau d’Eléazar - impossible de ne pas rire -, un jeu d’acteur terriblement convenu qui contrastait avec le décor pratique et symbolique de George Tsypin, inspiré par la verrière de la Gare Saint Lazare et les flèches du Duomo de Milan – n’animent jamais l’action dans le sens de la musique. La Juive, même si elle contient quantité d’éléments qui parlent à notre temps, se meut radicalement dans une époque créatrice différente dont le tactus est bien plus fébrile que celui proposé aux spectateurs durant toute cette soirée. Mahler qui adorait cette partition, en aimait la nervosité constante. Elle s’était totalement évaporée à la Bastille.
Gérard Mortier avait particulièrement soigné sa distribution, plus que pour aucun autre opéra de cette saison. Neil Schicoff s’est approprié Eléazar depuis quelques années. Il campe le joaillier dans toutes ses ambiguïtés et n’en masque pas les traits caricaturaux qui empêchent l’empathie : l’âpreté au gain, le fanatisme, la dépendance criminelle à la naissance contre la culture qui lui permet de sacrifier Rachel. Mais il n’est en rien, vocalement et de style l’Eléazar dont l’œuvre a besoin pour revivre dans toute sa splendeur vocale. Adolphe Nourrit était encore un jeune homme qui marchait sur les brisées de son propre père lorsqu’il s’appropria un rôle qu’Halévy destinait initialement à une basse. Nourrit enrichit considérablement la partition, y mettant ses notes hautes dont Schicoff ne rêve même pas.
Il a au fond raison de ne pas chanter la cabalette qui s’enchaîne à « Rachel quand du seigneur » : il n’en a jamais eu les moyens, on le sait pour l’avoir entendu alors qu’il s’y risquait encore. Mais aujourd’hui son piteux état vocal le contraint à transposer sans cesse au point que le rôle en devient méconnaissable. Ainsi au lieu de ligne et de fièvre, orne-t-il son grand air d’un râle fort disgracieux dont l’effet dramatique s’avère incertain. Il sera au mieux de ses moyens durant le Séder de l’acte II. Mais du moins le personnage est-il là, incarné avec une vérité psychologique indéniable.
On ne peut que tresser des couronnes de lauriers et de roses à Anna Caterina Antonacci, le Falcon idéal pour Rachel, avec ce français parfait délesté d’un accent que la cantatrice garde pour sa seule voix parlée, cette intelligence du texte et cette vaillance vocale que bridait, on l’entendait trop, la battue scrupuleuse de Daniel Oren. Avec cette somme de qualités qui frôle l’idéal, pourquoi sa Rachel est-elle si peu émouvante ? On n’est pas parvenu à débrouiller les raisons de ce mystère.
Si John Osborn a peiné un peu dans l’aigu au I, son ténor percutant et pourtant subtil retrouve bien la typologie vocale du créateur du rôle, Marcelin Laffont. Avec les années Robert Lloyd a perdu un peu de son legato, mais sa basse profonde, et si noble, tombe exactement dans la mansuétude et les angoisses de Brogni : une formidable leçon de chant qui désarmera peut-être ses détracteurs inexplicablement acharnés parmi la critique parisienne. Ruggiero venimeux à souhait d’André Heyboer, Albert en grande voix de Vincent Pavesi.
Mais la perle de la soirée, ce fut Annick Massis, Eudoxie de haut rang, à la vocalise dardée et au soprano ample et précis. Elle ne s’en laissait pas trop compter par la battue de Daniel Oren et emmenait avec elle un orchestre soudain rédimé par la grâce du bel canto qu’Halévy a réservé à la seule Princesse. Lorsqu’elle chantait passait soudain le frisson du grand opéra qui nous fit si souvent défaut durant la soirée.
Jean-Charles Hoffelé
Jacques Fromentin Halévy, La Juive, Opéra Bastille, le 24 février 2007 Prochaines représentations le 28 février et les 3, 6, 10, 14, 18 et 20 mars.
Réservez vos places pour l’Opéra de Paris
Les autres comptes rendus de Jean-Charles Hoffelé
Lire les réactions des internautes suscitées par cet article
Photo : Ruth Walz/Opéra National de Paris
Derniers articles
-
08 Février 2026Laurent BURY
-
07 Février 2026François LESUEUR
-
06 Février 2026Laurent BURY







