Journal
MUSIQUE ET CINEMA - « La lumière du film est une source d’inspiration majeure » - Une interview de Bruno Coulais, compositeur
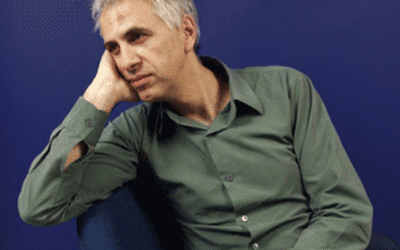
Du documentaire au film noir, en passant par la comédie, le compositeur Bruno Coulais a su brasser tous les genres cinématographiques en s’adaptant à l’univers de chaque réalisateur qu’il affectionne. Depuis maintenant plus de trente ans, il a su constamment se renouveler tout en gardant un style personnel qui fait sa force et sa renommée mondiale.
A l’occasion de la sortie du film « Les adieux à la reine » de Benoit Jacquot, il nous en dit plus sur son rapport étroit avec ce cinéaste, sur sa passion pour la musique contemporaine, l’enfance, le film d’horreur ou encore l’importance de la lumière dans une œuvre cinématographique.
« Les adieux à la reine » marque votre troisième collaboration avec Benoît Jacquot pour le cinéma. Comment avez-vous conçu votre bande originale ?
Bruno COULAIS : Le film se déroule sur trois jours et débute lors de la prise de la Bastille. Benoît Jacquot ne souhaitait pas mettre de musique lors de la première journée. A l’inverse, dès la deuxième journée, un flot continu de musique s’installe ; elle s’apparente à un nouveau personnage. Pour Au fond des bois, il m’avait passé commande d’un concerto pour violon avant la réalisation de son film. Pour Les adieux à la reine, la musique a été écrite après le tournage. Dans cette situation, je regarde surtout la lumière du film, une source d’inspiration majeure. Celle-ci entretient un rapport très étroit avec le choix des tonalités et l’orchestration. Je ne voulais surtout pas faire de pastiche en copiant la musique propre à la fin du XVIIIe siècle. L’important dans un film d’époque est l’aspect contemporain qui s’en dégage. Les adieux à la reine est un film extrêmement moderne, à l’image du cinéma de Benoît Jacquot.
La harpe, instrument étroitement associé au XVIIIe siècle, est très présente dans votre partition…
B.C. : Effectivement, la harpe semble habiter le décor, elle fait partie du monde visuel de Versailles. Sa sonorité glisse à travers les murs du château sans gêner les dialogues et les personnages. Elle symbolise la mélancolie. Cette partition est parfois dissonante, on y trouve des ostinatos, on est loin de la musique de l’époque. Il s’agit d’un film de vampire ! Les couloirs hantés du Château de Versailles sont effrayants. Ses fantômes déambulent continuellement jusqu’au moment où les rats quittent le navire. L’histoire est alors en marche.
Villa Amalia est un film différent car scindé en deux parties, une sombre et une lumineuse. En est-il de même pour sa bande originale ?
B.C. : Il y a curieusement moins de musique dans la partie solaire que dans la partie sombre. Il y a même une certaine continuité qui découle du piano. Un disque va prochainement sortir où seront compilées les trois bandes originales écrites pour les films de Benoît Jacquot.
Vos œuvres sont souvent dirigées par Laurent Petitgirard. Pourquoi ne les conduisez-vous pas vous-même ?
B.C. : Laurent Petitgirard a dirigé les trois partitions que j’ai écrites pour les films de Benoît Jacquot. La direction d’orchestre est un métier à part. Je passe toutes mes nuits à finaliser mes orchestrations et j’arrive exténué aux enregistrements. Je suis continuellement dans la « cuisine musicale », si bien que je n’arrive pas à avoir suffisamment de distance entre le film et sa musique. En revanche, je suis toujours présent lors des enregistrements. J’interviens de nombreuses fois pour modifier les nuances et il m’arrive ainsi de réécrire certains passages pendant les pauses.
Une fois le montage terminé, réécoutez-vous vos compositions ?
B.C. : Pratiquement jamais, car je n’en ai pas le temps. Il m’arrive de corriger certaines œuvres quand elles sont programmées lors de concerts ou à l’occasion de master classes. Le concerto pour violon composé pour le film Au fond des bois est un cas à part, car écrit comme une œuvre musicale à part entière. Cette commande de Benoit Jacquot était un exercice périlleux, à l’image de son cinéma.
Pourrait-on dire que celui-ci entretient des affinités avec le courant romantique ?
B.C. : Oui et non. C’est un cinéma d’écorché, doté d’une certaine violence, mais aussi d’une belle élégance. Une grande modernité en émane. Benoit Jacquot est très savant musicalement. Il n’a pas mis en scène Werther de Massenet pour rien. Le dialogue musical est avec lui toujours facile, aucunement écrasant. Il ne vous assomme pas avec des références comme d’autres réalisateurs peuvent le faire.
Son cinéma est aussi celui des femmes. Ses actrices vous inspirent-elles ?
B.C. : On dit souvent que les actrices prennent bien la lumière, mais certaines prennent bien bien la musique aussi. C’est le cas d’Isabelle Huppert, Isild le Besco et Léa Sédoux. Quelque chose d’animal se dégage de ces trois actrices. Je n’avais pas besoin d’aller sur le tournage pour le vérifier. Je déteste me rendre sur un plateau: il y fait froid, on s’ennuie ; je n’ai rien à y faire sauf quand la musique y est jouée, ce qui peut arriver. Je n’aime pas la fabrication cinématographique. Je préfère recevoir un choc chimique par la force des images et de la lumière.
A quel moment l’inspiration musicale vous vient-elle ?
B.C. : Je m’adapte facilement aux environnements. J’adore travailler dans les trains, dans les hôtels, dans les cafés… Cela me procure une souplesse formidable. Avec internet, la relation est tellement proche que la distance n’est plus un facteur déterminant. Il y a une immédiateté qui peut toutefois s’avérer dangereuse. Avec Benoit Jacquot, cela ne peut arriver, car je crois qu’il n’a même pas d’adresse mail !
Quel genre de film vous fascine le plus ?
B.C. : Le film d’horreur ! Ce genre se rapproche souvent de la musique dite contemporaine. Le cinéma de Kubrick (avec Shining) et celui de De Palma en sont de bons exemples. Je ne m’arrête pas sur une seule musique contemporaine. J’apprécie celle de l’Ecole de Vienne et le courant postsériel. Je ne suis pas dogmatique comme certains. Je m’en méfie. Je n’aime pas les disciples qui répandent la parole du « Maître ». J’aime autant Pascal Dusapin que Bruno Mantovani, Oscar Strasnoy ou encore Guillaume Connesson. Il y a en ce moment un bouillonnement très riche. La chance du cinéma est de travailler avec des musiciens venant d’horizons différents.
D’où provient votre intérêt pour la musique traditionnelle ?
B.C. : J’aime découvrir toutes sortes de musique. La musique du monde et traditionnelle offre un accès immédiat et facile vers d’autres horizons. C’est dans cette optique que j’ai composé pour le théâtre en travaillant par exemple avec Alfredo Arias.
Vous avez composé un opéra en 2000, puis un Stabat Mater en 2005 et un Concerto pour violon en 2010. Quelle sera votre prochaine œuvre ?
B.C. : Je viens de recevoir le prix France Musique-Sacem de la musique de film (1). On m’a donc chargé pour l’année prochaine de composer un ouvrage. J’en suis ravi, car je souhaite consacrer plus de temps à ce type d’écriture. En 2000, j’ai eu un dégoût de la musique de film. Comme je fais moi-même les orchestrations, cela demandait un travail énorme et je ne pouvais plus voir une seule image de film. J’ai donc composé un opéra et j’ai réalisé que cela faisait du bien d’alterner musique de film et composition personnelle.
François Reichenbach, avec qui vous avez débuté, disait qu’«à toute image documentaire, la musique apporte une part de fiction ». Y pensez-vous lorsque vous composez ?
B.C. : Bien entendu. Quand les jeunes compositeurs viennent me voir, je leur recommande le plus souvent de débuter par le documentaire. Passer de la réalité à la fiction est toutefois dangereux, car il y a un côté manipulateur. La musique manipule les images, particulièrement dans le documentaire. Le compositeur se voit même doté d’un devoir moral !
L’univers de l’enfance semble vous fasciner. Pour quelles raisons ?
B.C. : Je le dis souvent, mais tout ce qui se rattache à l’enfance crée du fantastique. Quand j’utilise des voix d’enfant ou des boîtes à musique, cela crée plus de tension et d’angoisse. C’est l’âge où l’on découvre la peur et nos premières terreurs. C’est ce que l’on entend dans la cantine de La nuit du chasseur et que l’on retrouve dans Les innocents de Jack Clayton.
L’enfance est un thème fétiche de Steven Spielberg et de son compositeur John Williams. Vous sentez-vous proche de ces artistes ?
B.C. : John Williams est selon moi le dernier des grands compositeurs hollywoodiens. Beaucoup essayent d’imiter son style sans toutefois le dépasser.
Que pensez-vous des musiciens américains du courant minimaliste qui se sont mis à la musique de film ?
B.C : J’aime beaucoup John Adams, à l’inverse de Philip Glass dont je commence à me lasser. J’aime aussi Terry Riley et Steve Reich. Mais la répétition est un procédé qui me fatigue de plus en plus. Je souhaite m’en éloigner.
Comment vos compositions ont-elles évolué au fil des ans ?
B.C. : Je me sens beaucoup plus libre qu’il y a quelques années. Je compose depuis l’âge de 18 ans donc mon style a forcément évolué. Je pense toutefois que l’on n’est pas assez audacieux au cinéma. La musique de film n’est pas suffisamment expérimentale. Elle est assez convenue. Côté français, nous sommes moins académiques. Les Américains sont intrigués par notre savoir faire. Personnellement, je ne veux surtout pas travailler avec des orchestrateurs. Le processus hollywoodien est si compartimenté qu’au bout du compte, nous ne savons plus qui est le vrai compositeur !
Entre vos compositions pour les films de James Huth et plus récemment Le Marsupilami d’Alain Chabat, d’où vous vient votre goût pour la comédie ?
B.C. : Je prends toujours la musique au sérieux, même dans la comédie. J’ai aussi innové sur le Marsupilami et la musique s’adapte bien à l’univers d’Alain Chabat. Pour un compositeur, la comédie est certainement le genre le plus difficile. J’essaie de ne pas tomber dans la vulgarité et la facilité. Encore une fois, il faut que les lumières soient belles, que les dialogues conviennent et qu’il y réside un véritable parti pris cinématographique.
Travaillez-vous justement avec les directeurs de la photographie ?
B.C. : Jamais. La musique de film arrive généralement trop tard dans le processus cinématographique. Je les rencontre en projection, mais comme je ne vais pas sur les tournages de films, cela ne facilite pas les choses. La lumière, comme la musique, doit faire vibrer l’image.
Souhaitez-vous composer d’autres opéras dans l’avenir ?
B.C. : Pas pour le moment. C’est trop imposant pour moi, je ne me sens pas assez libre. La musique de concert me convient davantage et me permet de m’isoler. Mais je continue d’aller beaucoup à l’opéra. D’ailleurs, je me sens plus proche des musiciens baroques que classiques et romantiques.
Vous avez aussi composé pour votre fils réalisateur (Come wander with me, de Hugo Coulais, 2011). Le processus était-il différent d’avec un autre cinéaste ?
B.C. : Cela fait très bizarre ! Il s’agit d’une petite composition pour l’un de ses courts-métrages, mais la problématique reste la même : comment faire vibrer le spectateur grâce à la musique ? On a des univers en commun, cela facilite les choses.

Naïve a édité certaines de vos compositions dans un disque dont l’image retranscrit très bien votre univers. Comment l’avez-vous choisie ?
B.C. : J’aime beaucoup cette photo qu’un ami de mon fils a réalisée. Je lui ai donné carte blanche pour cette photo qui retranscrit admirablement mon univers. Elle ressemble à un envol
Avez-vous dû réécouter certaines de vos œuvres à l’occasion de l’hommage que vous a rendu la cinémathèque française en mai 2011 ?
B.C. : Ce fut un moment très émouvant. J’ai dû replonger dans certaines œuvres que j’ai effectivement retravaillées. C’était l’occasion de revoir beaucoup de collaborateurs avec lesquels j’avais l’habitude de travailler. J’aime travailler avec les mêmes personnes et suivre les aventures musicales.
Dans un texte qu’il vous a consacré, Stéphane Lerouge vous compare à un « alchimiste moderne ». Qu’entend-il par ces mots ?
B.C. : J’aime bien mélanger les genres. J’avance de façon intuitive au gré des rencontres musicales. Une cohérence ressort de ces différentes aventures.
Souhaiteriez-vous travailler avec de nouveaux réalisateurs ? Votre style irait bien avec le cinéma de James Gray par exemple.
B.C. : J’adore le cinéma de James Gray ! Le cinéma de Cronenberg m’intéresse aussi beaucoup. Un compositeur de musique de films est un schizophrène : il faut non seulement être au service du film, mais aussi savoir rajouter une touche personnelle. J’ai la chance unique de pouvoir le faire et j’en profite chaque jour.
Propos recueillis par Edouard Brane, le 8 mars 2012
> (1) Prix France Musique-Sacem de la musique de film
« Les adieux à la reine », film de Benoit Jacquot (sortie le 21 mars 2012)
> Vous souhaitez répondre à l’auteur de cet article ?
> Lire les autres articles d’Edouard Brane
Découvrez tous les articles Musique et cinéma GUI632
Photo : DR
Derniers articles
-
02 Mars 2026Vincent BOREL
-
02 Mars 2026Antoine SIBELLE
-
02 Mars 2026Jacqueline THUILLEUX







