Journal
Lohengrin comme si vous y étiez
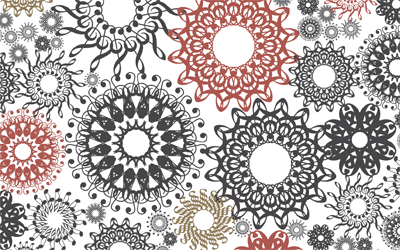
Rien à penser, presque rien à dire de la mise en scène sans histoire et sans surprise de Carsen, reprise dix ans après sa première apparition : le bunker-blockhaus bombardé est toujours aussi anonyme et réfrigérant, accusant le terrible hiatus avec l’arrivée de Lohengrin émergeant de son sous-bois hamiltonien : clairement il vient d’ailleurs. On remercie Carsen de nous rendre le cygne, si justement réel, on regrette qu’il ait par ce décor d’après-guerre surchargé Lohengrin d’une connotation IIIe Reich avec laquelle il n’a strictement rien à faire.
Mais la direction d’acteur tombe très juste – sinon chez Ben Heppner plus soucieux de la puissance de son chant que de la vérité de ses gestes – et l’enfant effrayé qui refuse le pouvoir et plante son arbrisseau demeure toujours aussi émouvant. Wagner eut probablement aimé cette distance par la peur qui donne à la fin de Lohengrin une ambiguïté que la musique indique. Luxe absolu pour cette reprise : une distribution comme aucun Lohengrin ne nous en avait offerte depuis des lustres, et même le fantôme de Gwyneth Jones, mémorable Ortrud in loco en 1996, devait rendre les armes devant les nouveaux venus.
Ce n’était pas tout à fait une prise de rôle pour Mireille Delunsch. Elle avait essayée son Elsa à Bordeaux. Mais la révélation fut de taille. Si Bastille demeure trop vaste pour son instrument, Elsa lui va comme un gant. Non seulement à l’actrice, prodigieuse de vérité et toujours aussi économe, mais à la chanteuse. La voix s’y tend, prend une matière, un éclat qui montrent que le chemin à suivre est bien celui des grands rôles lyriques du répertoire germanique. Son Arabella de Liège l’annonçait, cette Elsa l’affirme : demain se profilent Elisabeth et Senta, une très probable et flamboyante Siegelinde. Pour Elsa, c’est la perfection : poésie du timbre, clarté de la langue, une grâce qu’on ne connaissait avant elle ici qu’à Elisabeth Grümmer ou Gundula Janowitz. La comparaison est dans ce cas raison : comme elles Delunsch est une mozartienne consommée, et pour Elsa il n’y a pas de meilleure école. Un rien de fatigue dans l’étreignant duo du III rappelait que décidément cette Elsa aurait été plus confortable à Garnier.
Heppner pour Lohengrin c’est presque superfétatoire : incroyable d’aisance, de présence, de ligne, multipliant les subtilités, éclairant le grand, le lourd secret du personnage à mesure, avec une connaissance telle du rôle qu’il n’y souffre aujourd’hui pas de rival, tout comme Waltraud Meier, fêtée avec délire par le public de Bastille et qui donne à Ortrud la noblesse d’une magicienne de l’ancien culte, sans pour autant oublier la tigresse. Composition étouffante à force d’arrière-plans et d’angles saillants, mais pourtant sans la vraie voix d’Ortrud qu’on entend plus noire. Peu importe, car aujourd’hui Meier n’a ici aucun vis a vis, et surtout pas Petra Lang, au chant si désordonné.
On restera moins conquis par le Telramund de Jean-Philippe Lafont : beaucoup de caractère mais aucune menace, et de voix désunie, privé du moindre legato, incapable de tendre une ligne de chant, d’y infuser le venin qu fait tout le prix des grands Telramund – mon voisin regrettait Ernest Blanc, il n’avait pas tort. Trop tard aussi pour le Roi Henri de Rootering : timbre captif, perdu dans le vaisseau de Bastille, jouant les utilités, alors que son héraut lui répondant avec le vrai métal du baryton Wagner idéal : Evgeny Nikitin nous promet pour la saison prochaine son Klingsor, on l’entendait déjà ici, et à la réflexion ont lui eût bien donné Telramund à quelques graves près.
Gergiev s’est transformé en mage, cela ne lui arrive que peu souvent mais cela lui arrive, c’est d’ailleurs ce qui fait sa légende. Durant cette soirée on était subjugué par les atmosphères suscitées, le mélange des styles entre opéra romantique et drame épique, intimité et scène d’apparat, la vaste palette de couleurs qu’il obtenait de l’orchestre et qui faisait oublier son médiocre Tristan débraillé de la saison passée qu’on retrouvait juste pour un Prélude du III sans élan. Et bémol réel : impossible de donner au chœur l’ordre et la vitalité qu’ils doivent montrer, surtout lorsqu’on les dirige avec un cure dent, invisible de la scène. Que Gergiev retrouve vite sa baguette d’antan, où qu’il renonce à ce substitut réticulaire ; tout y gagnera en efficacité.
Jean-Charles Hoffelé
Wagner : Lohengrin. Opéra Bastille, le 19 mai, puis les 23 et 26 mai et les 2, 5, 8 et 11 juin 2007
Dernières places disponibles !
Vous souhaitez réagir à cet article ?
Photo : Opéra de Paris/Eric Mahoudeau
Derniers articles
-
23 Février 2026Alain COCHARD
-
21 Février 2026François LESUEUR
-
21 Février 2026Alain COCHARD







