Journal
Compte-rendu - Cyrano de Bergerac d’Alfano au Châtelet - Cyrano enfin
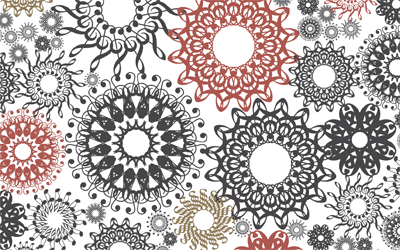
Voilà, c’est fait, Paris aura enfin revu ce Cyrano selon Franco Alfano que José Luccioni avait dévoilé dans sa mouture française à l’Opéra Comique en 1936, doublant la création romaine de la version italienne. Le langage pseudo moderne d’Alfano, paré souvent d’une certaine ironie, s’y fait plus simplement décoratif, efficace, plus sollicité et facile aussi que celui qu’il emploiera à ses plus grandes réussites lyriques, Sakuntala, et surtout Risurrezione qu’il faudrait voir et entendre à sa juste valeur, rien moins qu’un quasi chef-d’œuvre.
Pour Cyrano, Alfano ne prétend pas à ce degré d’inspiration, il flamboie d’orchestre, il italianise sans prendre garde, de rythmes, d’appuis, un français pourtant pas si exotique que cela au compositeur, il écrit large et clairement grand opéra pour des voix de tessiture, de timbre ultramontaines et revendiquées comme telles. Le métier, admirable, est partout et se fait voir sans honte, arborant un savoir faire tapageur qu’un Cilea, un Zandonai ont su plier souvent avec plus d’art et de simple personnalité à des sujets tout aussi ambitieux mais moins proches par leur livret d’une source littéraire prestigieuse (Adrienne Lecouvreur, Francesca da Rimini sont elles des partitions de première force).
Mais l’éclat de l’Hôtel de Bourgogne, la poésie un peu maladroite du Balcon, le grand geste du Siége d’Arras, la mélancolie assez conversation en musique du Couvent des dames de la Croix sont subtilement dessinés et atteignent souvent à l’émotion. Au total l’œuvre reste infiniment séductrice et ne fait pas mentir Edmond Rostand qu’Henri Cain suit d’ailleurs au mot près.
Le Châtelet a donné de grands moyens à Petrika Ionesco : son Hôtel de Bourgogne vu du fond de scène est fabuleux d’éloquence, de maestria, d’éclat, montre un métier du mouvement de foule, une virtuosité jamais creuse pimentée comme dans le tableau chez Ragueneau d’un vrai sens du spectacle dans le spectacle avec force acrobates et bretteurs ; c’est dans ce brillant que son art idéalement apparié à celui du compositeur jette ses plus beaux feux.
Lorsque l’intrigue de substitution apparaît, dès le Balcon, Ionesco s’absente pour ne plus revenir que lors du siège d’Arras, plus brouillon, plus incertain de geste, sans véritable tension de guerre ou de famine.
Que la nécessité de la direction d’acteur paraisse, il abdique, refusant à son spectacle la vérité du théâtre. Chacun fait donc comme il peut ou veut. Nathalie Manfrino donne encore plus de fantaisie et de panache blessée à sa Roxane, un rôle qu’elle porte avec son charisme habituel et son intelligence d’actrice mais qu’elle minore d’une voix plafonnée, incertaine, fatiguée souvent jusque dans un timbre rêche, mais voilà elle est le personnage, gamine déçue par le total manque d’éloquence de Christian, jeune fille de grande allure lorsqu’elle passe les lignes espagnoles dans son carrosse avec le prétexte d’amour, justement émouvante dans sa conversation finale avec Cyrano.
On trouvera la raison de cette maturation depuis ses incarnations montpelliéraines dans la présence plus sombre, plus brûlante dans un sens noir, que Placido Domingo donne à son Savinien. Là où Alagna composait un personnage univoque, un peu trop Fanfan la Tulipe, très cape et épée, mais suprêmement dit et chanté ce à quoi Domingo ne peut plus prétendre (et pour dire en français n’a jamais pu), l’espagnol met des arrière-plans tragiques, va très loin, et plutôt dans Rostand que dans Alfano, malgré l’approximation des mots sauvés par un art de l’expression transcendant. Sa mort donnait le frisson, et remboursait d’une ballade du Duel hachée où la voix n’avait pas encore pu se chauffer (Alagna y reste inimitable, c’est peut être le plus enivrant moment de la partition). Mais taisons nos critiques, si l’on a pu revoir Cyrano c’est d’abord parce que Domingo rêvait de le chanter à Paris, et la voix conserve à un âge avancé – il avoue une bonne soixantaine mais aurait dépassé les soixante-dix – une homogénéité, une présence, un drive, une tenue - et des aigus ! - qui laissent pantois.
Sa présence en scène ne fait qu’une bouchée du Christian pâlot de Saimir Pirgu et la distribution étonne par quelques emplois mal assortis : on aurait donné sans hésiter De Guiche à la stature, à l’autorité naturelle, au mordant de Laurent Alvaro un peu sous employé en Ragueneau alors que Marc Labonnette n’a pas le panache naturel du général dont la tessiture épuise vite sa voix trop vibrée. Franco Pomponi décevait en Valvert et en Carbon, transparent. On se remboursait avec Christian Helmer, Le Bret magnifique, de timbre, de diction, d’élan, de mordant, baryton par l’agilité, basse par la profondeur des harmoniques.
L’Orchestre Symphonique de Navarre saisissait avec panache la verve d’Alfano, mais Patrick Fournillier la sollicitait trop, étranglant souvent ses chanteurs par tant de décibels. Une lecture plus subtile irait comme un gant au grand geste, ça et là décousu, que le compositeur a mis dans son orchestre et qui en fait le personnage principal de son opéra.
Découvrez l’œuvre impérativement et procurez vous le programme, un modèle d’à propos et de documentation ou les plumes inspirées (Olivier Rouvière) ou érudites (Jean Cabourg) vous diront tout et de Cyrano et d’Alfano.
Jean-Charles Hoffelé
Franco Alfano : Cyrano de Bergerac - Théâtre du Châtelet, Paris, le 19 mai, puis les 22, 25, 28 et 31 mai 2009
> Programme détaillé du Théâtre du Châtelet
> Voir les vidéos d’opéra
> Lire les autres articles d’Alain Cochard
Photo : Marie-Noëlle Robert
Derniers articles
-
16 Février 2026Jean-Guillaume LEBRUN
-
16 Février 2026Michel EGEA
-
14 Février 2026Laurent BURY







