Journal
Aventures tryphèmoises ; le roi Pausole à l’Opéra Comique
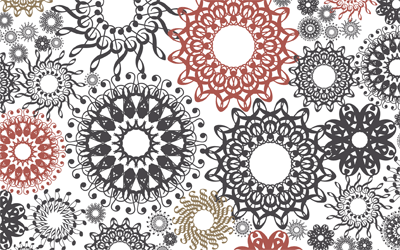
On peine à comprendre ce qui fit tomber Pausole dans un oubli aussi complet. Première des trois opérettes d’Honegger, fille de l’année 1930, elle lui offrit son plus tonitruant succès. A Paris pas moins de quatre cent représentations. Alors pourquoi ce si profond et si long sommeil ? C’est que l’ouvrage se trouve marqué par le style interlope et le ton louche de l’entre-deux guerres que ravagèrent à jamais les horreurs du second conflit mondial. On ne pouvait plus avec le risque permanent du tout puissant champignon sourire aux subtiles voluptés et aux délicieux dévoiements du livret de Willemetz confit dans le libertinage heureux du roman de Pierre Louÿs et même si l’opérette allait rester légère, dés les années cinquante elle allait prendre des allures mémères où le sexe laisserait place à l’amour.
L’amour en place du sexe quelle déchéance ! Aujourd’hui notre nostalgie de l’opérette nous porterait plus naturellement vers André Messager ou Louis Beydts, et d’ailleurs sait-on que le compositeur de la Danse des Morts, enfanta de son imagination fertile non seulement Les Aventures du Roi Pausole, mais aussi une comédie vaudoise, La Belle de Moudon, et avec Jacques Ibert, Les Petites cardinales ? L’opérette, le vice caché d’Honegger ? Oui, et Mireille Larroche comme sa troupe pétillante ont donc encore deux autres ouvrages à raviver. Cette première de Pausole, un enchantement, ne méritait pas la toute petite salle qu’elle recueillit. L’œuvre est délicieuse, capricieuse à mener, mais dans la fosse l’habile Sébastien Rouland mettait tout le sel de sa baguette, entraînant des ensembles encore un rien brouillons qui se disciplineront sans mal.
Lionel Peintre ferait sourire (sinon rire) un régiment de croquemorts en Roi de Tryphème tendre et bouffon qui peine à se prendre au sérieux et Aline sa fille trouve dans le soprano flûté de Cassandre Berthon une voix qui triomphe sans difficulté d’une partie plus salée qu’il n’y parait : au I elle plongeait la salle dans une atmosphère de rêve avec son air « Papa veut toujours », rêve qu’érotisait encore le joli numéro d’acrobate d’Anne Joubineau, faite au moule, tenue sensuellement dans l’éther à de longs drapés de soie ; au III leur duo du téléphone à l’Hôtel du Blanc Sein est un moment d’anthologie.
La Thierette à l’accent provençal d’Edwige Boudry nous réserve quelques fous rires décapants, Marie-Thérèse Keller campe une Diane à la houppe dont le grand air du II est un régal de frustration amusée, Christophe Crapez un Taxis haut en couleurs (que l’on peine à toujours bien comprendre), parfois dépassé en verve par la loufoque Dame Perchuque de Christine Gerbaud, avec sa coiffure qui semble singer celle d’une certaine Patricia P., Pierre-Alexandre Dubois un métayer délirant, mais ce sont Giglio et Mirabelle qui nous tiennent en haleine. Yves Coudray, chérubin devenu jeune minet, se révèle un splendide ténor d’opérette, et l’aplomb de son jeu scénique, son regard salace, ses allures lutineuses, son physique avantageux font vibrer toute la soirée d’une érotisme brillant : souvenez-vous, la Graine d’Ortie d’Yves Allégret, c’était lui ! Pour Mirabelle impossible de trouver mieux que Françoise Masset. La plénitude de son mezzo fruité la destine demain aux grands emplois mozartiens, Dorabella, Zerline . Cette Mirabelle a chanté Didon, cela s’entend dans le galbe de la phrase, l’élégance de la diction même – surtout – dans l’air du travestissement qu’elle caresse avec un chic impressionnant.
Les décors de Daniel Buren revendiquent leur théâtre de poche, la mise en scène pleine d’à propos de Mireille Larroche, qui ne souligne pas mais s’amuse autant que nous, abolit la barrière conventionnelle entre plateau et salle. On a souvent l’impression d’être dans le spectacle et non au spectacle ; c’est la grâce du livret de Willemetz, qui, mine de rien nous dit tout haut ce que tous nous sommes tout bas, autorise cette familiarité que facilite la musique jamais complaisante d’Honegger.
Parisiennes, Parisiens, retournez à l’Opéra Comique – soit dit en passant votre plus belle salle lyrique - faites en craquer parterres, loges et balcons, allez entendre ce joli brin de comédie, vous y verrez même du nu intégral presque pour les deux sexes (et l’on s’explique mal ce « presque » plutôt paradoxalement appliqué, notre timidité naturelle nous a interdit d’en demander la raison au metteur en scène). Passons, non, allez y sans tarder, car nous avons la chance de vivre en 2004 une année bissextile. Vous comprendrez mieux l’invite codée en écoutant le grand air de Diane au II.
Jean-Charles Hoffelé
Opéra Comique, jusqu’au 31 janvier.
Photo : DR
Derniers articles
-
21 Février 2026François LESUEUR
-
21 Février 2026Alain COCHARD
-
18 Février 2026Laurent BURY







