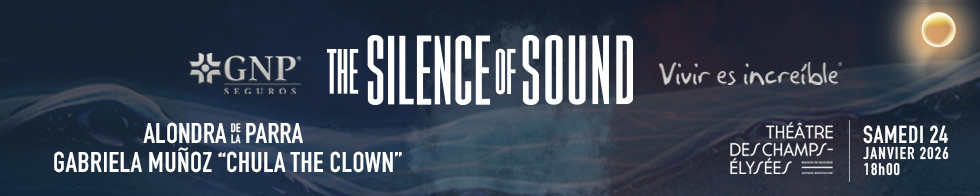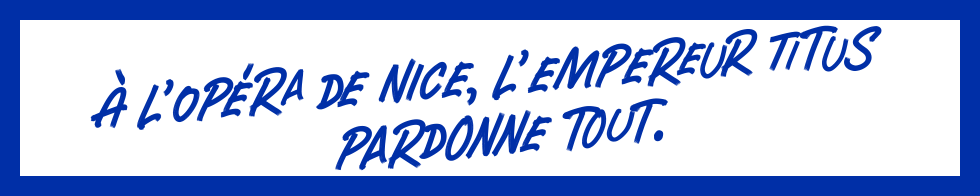Journal
Sylvia revu par Manuel Legris au Palais Garnier – Retour au puits – Compte rendu

« L’argument même de Sylvia révèle, par son caractère mythologico-pastoral et son action fragmentée riche en prétextes à « pas de bravoure » ou à scènes à effet, la décadence, sur le plan de la création chorégraphique, du Ballet à l’Opéra de Paris … à la fin du XIXe siècle », écrivait en 1981 le critique Alfio Agostini dans l’ouvrage Le Ballet de 1581 à nos jours (Ed. Denoël). Cruel pour le correct chorégraphe Mérante, et faisant fi du support miraculeux de la musique de Delibes qui confère à l’œuvre son caractère enchanteur. Cruel surtout parce que Sylvia, histoire d’une vierge chasseresse séduite par un berger, a depuis 1876, date de sa création parisienne, fait de nombreux petits dans le monde, notamment en Russie et à Londres.
Souvenance du chef-d'œuvre de Neumeier
En France, on eut droit à de multiples versions, et notamment à celle, élégante et fine que remonta Violette Verdy d’après les souvenirs de Lycette Darsonval. Puis, surtout à un chef-d’œuvre, l’un des plus grands du maître qui en a généré tant d’autres, John Neumeier. Lui vida le sujet de ses mièvreries et de ses maniganceries baroquisantes pour se concentrer sur la douloureuse histoire d’un amour manqué, de vies qui passent à côté l’une de l’autre, par erreur, par bêtise. Chef-d’œuvre, on le répète, et admirablement conçu pour le Ballet de l’Opéra de Paris, qui le commanda, et dont le style était épousé jusqu’a l’intime par la pensée et la gestuelle du chorégraphe. Et que dire de la prodigieuse escouade qui fit vivre ce Sylvia, créé en juin 1997 et repris en 1999, 2002 et 2005 : outre l’exquise Monique Loudières, la souveraine Elisabeth Platel, un quatuor miraculeux, de ces garçons dont l’Opéra garde la marque comme des traces étincelantes, Nicolas Le Riche, José Martinez, Yann Saïz (éblouissant dans son habit) et un certain Manuel Legris, qui depuis a fait un bien beau chemin.

Attachement aux grands ballets classiques
Legris justement, que revoici aujourd’hui, auréolé de son prestige de directeur du Ballet du Staatsoper de Vienne, puis de la Scala de Milan, postes prenants qu’il a quittés depuis, retrouvant un peu de liberté. Maître solide et attentif, chorégraphe à ses heures, il n’a cessé de défendre les grands ballets classiques, et se plaît à retourner à ses amours d’enfance, enrichies d’une expérience énorme. Sa Sylvia conçue pour le Wiener Staatsoper en 2018, offre donc une série de variations tourbillonnantes, de portés vertigineux, succession de tours de force qui font oublier le trop plein de l’intrigue, laquelle aboutit au vide tant on s’en désintéresse. Tout en restant dans le fil, sans doute, de Mérante, qu’on a à vrai dire complètement oublié.
> Les prochains spectacle de danse <

Une thématique juste esquissée
Car on est un peu déçus : difficiles à comprendre, ce méli-mélo d’affrontements, d’apparitions divines, de danses villageoises qui s’enchaînent sans que l’axe ne se révèle clairement. Et si Legris a d’emblée montré dans son prologue que Diane, amoureuse d’Endymion, ce qui est contraire à son essence de déesse vierge, l’endort pour le savourer en toute impunité, on ne le voit plus guère sinon à la toute fin, ce qui est dommage, surtout quand il est incarné par Florent Melac. Une thématique fascinante et juste esquissée. Les ensembles sont un peu brouillons, sans qu’une vraie raison d’être les relie, et l’argument, si compliqué, ne peut être décrypté tant l’ensemble des gestes n’en révèle pas la psychologie profonde. Bref, Manuel Legris, fantastique interprète, n’a pas, nous semble-t-il, trouvé pour les autres le chemin des gestes qui ajoute de l’âme au divertissement.
Costumes d’une autre époque ...
Et surtout, et hélas, les costumes de Luisa Spinatelli, dont on attendrait plus de fraîcheur et de grâce, montrent des tissus clinquants, tapageurs, sur fond de décors qu’on croyait définitivement bannis depuis que le duo Frigerio-Squarciapino pour Noureev, et Jürgen Rose pour Neumeier avaient atteint par leur beauté à la fois ostentatoire et dosée, l’acmé pour un style qui achevait une époque du ballet. Si le premier acte, par ses effets pastel, dispense un certain charme, le dernier avec ses allusions à un monde bachique suggérées par des masses métalliques, sidère par sa lourdeur.

Magnifique Amandine Albisson
Reste, heureusement, et c’est l’essentiel, l’engagement des beaux danseurs que l’Opéra peut mettre en piste aujourd’hui avec de nombreuses distributions : le soir de la première, magnifique Amandine Albisson, déliée, sinueuse mais vigoureuse, belles pointes, beau tir à l’arc, superbe Guillaume Diop en Eros, malgré ses grandes ailes que l’on croyait remisées au magasin de souvenirs, excellent Germain Louvet en Aminta, battant l’entrechat avec brio, malgré des gestes stéréotypés de berger baroque, bon Marc Moreau, farouche Orion, et lui aussi emporté dans des sauts frénétiques, belle Diane de Roxane Stojanov, dont on regrette la tunique rouge, qui la fait ressembler à Poppée et non à une déesse lunaire.
Avec autour d’eux une troupe que l’on regarde tourbillonner allègrement, car l’on sait combien la présence de Manuel Legris, vraie légende française pour tout danseur classique, l’a aiguillonnée. Gentille fresque que l’on suit avec plaisir, en appréciant les performances, mais sans être touché un instant. D’autant que la battue plus que rude du chef Kevin Rhodes n’aide guère à l’émotion, ses chasseresses devenant Walkyries, le fameux pizzicato sonnant clarine, et le si délicat air de flûte qui évoque en leitmotiv l’amour d’Aminta et de Sylvia, ayant perdu de sa douce mélancolie. Tout brille, mais cela ne suffit pas.
Jacqueline Thuilleux

> Les prochains spectacle de danse <
Sylvia (mus. Léo Délibes / chor. M. Legris) - Paris, Palais Garnier, 8 mai ; prochaines représentations les 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31mai & 4 juin 2025 // www.operadeparis.fr/saison-24-25/ballet/sylvia
Photos (de répétition) © Yonathan Kellerman - OnP
Derniers articles
-
22 Janvier 2026Thierry GEFFROTIN
-
21 Janvier 2026Laurent BURY
-
20 Janvier 2026Michel ROUBINET