Journal
Paris - Compte-rendu : Messe, sortilèges, rédemption – Parsifal à la Bastille
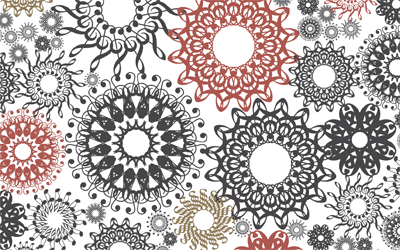
Krzysztof Warlikowski est un rêveur. Il ouvre son Parsifal en projetant la scène finale de 2001 Odyssée de l’Espace où le cosmonaute survivant du vaisseau spatial, David Bowman, à l’approche de la mort, voit devant son lit le terrible monolithe, avant de s’éteindre pour renaître sous la forme d’un gigantesque fœtus astral. L’idée du survivant est nodale dans Parsifal, même si elle renvoie encore plus directement à la mythologie personnelle de Warlikowski. Mais Parsifal au fond ne parle de rien d’autre, c’est une renaissance, celle d’Amfortas, mais aussi celle du rôle-titre, et une mort, celle de Titurel, et au-delà de tout cela une réflexion têtue sur l’avenir du monde et le destin des sociétés humaines.
On a pensé un instant que cette projection préalable, un rien appuyée, viendrait béquiller le spectacle. Mais non, ce n’est qu’un aveu ; pas une symbolique, mais une émotion. Oui Warlikowski est un rêveur, comme tous les poètes. Il invite David Bowman dans son spectacle, afin d’essayer d’aider Parsifal sur le chemin de la connaissance, comme il invite un enfant, omniprésent durant l’acte II, dont on sent confusément qu’il est le double de Parsifal, ou mieux Parsifal enfant encore jusqu’au moment où Kundry lui révèlera la blessure. L’innocence, la première identité du chaste fol. Au début du III, autre projection, dans le silence - enfin ce qu’une salle obtuse et un public grossier laissent encore comme maigre espace à un silence souhaité -, appelé par une scène funambulesque d’Allemagne année zéro de Roberto Rossellini où l’on voit le petit Edmund Koeler jouant dans les ruines d’un immeuble d’où il va se jeter. Un enfant avant son suicide. Les portes ouvertes par cette suggestion sont multiples, on ne les refermera pas ici.
Ces deux indications cinématographiques se coulent plus logiquement dans le discours de l’œuvre que celles apposées d’une manière un rien trop voyante sur le formidable spectacle de L’Affaire Makropoulos la saison passée. Si Makropoulos se déroulait dans le cadre unique et pourtant modifiable d’un cinéma, Warlikowski nous transporte cette fois dans l’amphithéâtre d’une salle de médecine légale ; le livret de Wagner parle assez de douleur et de mort pour que cette translation soit évidente. Le décor garde quelques éléments du film - les lavabos et leurs miroirs rappellent celui de la chambre Louis XVI dans laquelle David Bowman vieillit et meurt, et parfois propose son contraire : ainsi au IIIe Acte l’enfant a échappé aux ruines et à la mort, comme Parsifal en fait, enfin investi de sa mission salvatrice, et cultive un jardin devant le cercueil de Titurel.
On peine ici a retracer toutes les corrélations de sens, les translations poétiques que Warlikowski produit avec une virtuosité qui ne se perçoit pourtant pas. Car ces arrière-plans nourris aux profondeurs de l’œuvre sont comme tissés dans une trame plus immédiate qu’une direction d’acteur qu’on en peut que qualifier de géniale anime tout au long des cinq heures du spectacle. Et quel spectacle !
Quasiment sans provocation, en tous cas sans aucune gratuité : même ce Klingsor devenu magicien de cabaret, même ces filles-fleurs années folles derrière leurs tables de bar, putes de luxe guettant avec une sorte de fatigue, de lassitude, le client, proposent une vérité et non simplement une fantaisie, jusque dans leur rapt de Parsifal, attaché en caleçon à sa chaise. Ces déductions logiques mettent un peu de poil à gratter pour ceux qui veulent en trouver. Il n’est pas certain que le metteur en scène ait voulu apporter de l’eau à ce moulin-là.
On ne vous dira rien de l’Acte III. Sachez simplement que pour nous la vérité de l’œuvre y est pour la première fois totalement incarnée, avec une poésie simplement déchirante. Comme un bonheur n’arrive jamais seul le cast atteint lui aussi à la perfection, avec quelques bémol mineurs : après un quart de siècle de fréquentation du rôle, Waltraud Meier est la plus évidentes des Kundry, même si elle force sa voix et ne trouve plus pour Ich sah das Kind le legato et les couleurs qu’elle y mettait voici peu encore, et Alexander Marco-Buhrmester, Amfortas touchant, n’a pas tout à fait les moyens de son emploi : son baryton un peu clair s’effrite dans un vibrato envahissant. Mais pour Gurnemanz, l’humanité douloureuse de Franz Josef Selig est une bénédiction, pour les quelques phrases de Titurel, la voix abyssale de Victor von Halem distille son sépulcre terrible, et le Klingsor stylé d’Evegny Nikitin tourne le dos à toute une certaine tradition d’histrionisme.
Deux Chevaliers du Graal luxueux et percutant (Gunnar Gudbjörnsson et Scott Wilde), choisis certainement par Warlikowski pour leur intrigante gémellité, des Filles-Fleurs poétiques et précises, emmenées par le soprano cinglant de Valérie Condoluci, en fosse la direction pulsée et dramatique d’Hartmut Haenchen portée par un Orchestre de l’Opéra de Paris au sommet de son art, tous s’inclinaient devant Christopher Ventris, possédé par le destin du chaste fol, transcendé par la direction d’acteur hallucinante de Krzysztof Warlikowski.
Simplement l’un des spectacles absolus dont on ait croisé la route.
Jean-Charles Hoffelé
Richard Wagner, Parsifal, Opéra Bastille, le 4 mars, puis les 7, 11, 14, 17, 20 et le 23 mars 2008 (le spectacle débute à 18h).
Programme détaillé de l’Opéra Bastille
Photo : Eric Mahoudeau/Opéra de Paris
Derniers articles
-
09 Mars 2026Alain COCHARD
-
09 Mars 2026Laurent BURY
-
07 Mars 2026Michel ROUBINET







