Journal
Montpellier - Interview : « L’école buissonnière » selon Frank Braley
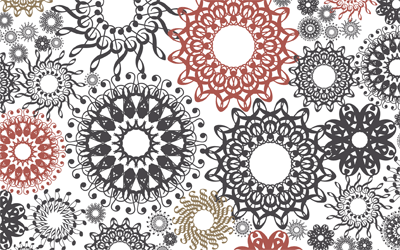
Parmi tous les compositeurs que vous jouez, Beethoven occupe une place particulière dans votre cœur. A l’heure actuelle quelle place occupe t-il dans votre répertoire ?
Il a une place particulière à vrai dire quasiment pour tous les pianistes et dans l’histoire du piano. C’est quelqu’un qui a repoussé les limites de l’instrument. D’abord c’était son instrument. C’était un très grand pianiste, grand improvisateur. C’est vraiment l’instrument qui l’a suivi toute sa vie. Evidemment, on pense à l’immense œuvre que sont les trente deux sonates qui est vraiment une arche énorme et qui parcourt toute son existence ce qui est particulier pour un compositeur. Elle a vraiment ouvert des pans entiers vers le 19e même vers le 20e siècle pour ce qui est de la musique de piano. C’est un compositeur auquel on revient toujours, comme une source, une base qu’on ne peut pas éviter en tant que pianiste. Le Concerto n°4 que j’ai joué les 19 et 21 mai à Montpellier est une très grande œuvre, celle-ci étant particulière et ayant une place spéciale.
On dit souvent que c’est « le plus libre, le plus rapsodique ». Qu’en pensez-vous ?
C'est-à-dire qu’on a toujours cette image de Beethoven… on a tous en mémoire ces portraits avec la mèche en bataille, le regard de braise, le côté conquérant. De fait, il est vraiment le musicien de l’énergie qui se fait chair, musique même du défi, du combat. Il y a vraiment quelque chose de prométhéen et il y a quelques œuvres, rares, qui sont une exploration d’une facette beaucoup plus intime, pas du tout conquérante ou dionysiaque. Vraiment un côté, on pourrait dire plus féminin, Apollinien, plus lumineux. C’est quelque chose de particulier qui n’est pas du tout sur le mode de la lutte mais qui est une musique qui se joue quasiment d’elle-même. C’est très marquant dans le Concerto n°4 qui ne peut pas se jouer à l’énergie. C’est vraiment une œuvre en même temps effectivement libre et lumineuse. Parfois le piano est là juste pour donner un éclairage, une qualité de lumière, de vibration très élevée plus que le discours musical. C’est très très étrange. Je vois toujours une espèce de grande illumination dans cette pièce et quelque chose en même temps de tendre, une lumière chaude et brillante. Beaucoup de joie alors que souvent, c’est un peu exagéré de le dire, mais il y a beaucoup de choses dramatiques chez Beethoven. Là, c’est un côté plus secret, plus mystérieux de son tempérament de compositeur. Il y a quelque chose presque ésotérique de ce concerto.
Dans votre approche de la partition, quand on entend votre façon de jouer le premier mouvement par exemple, y a t il une recherche de sonorité particulière ou cela vient sur l’instant ?
Oui parce que je parlais de lumière et le piano est souvent là pour donner une couleur. C’est étrange la manière dont il utilise l’extrême aigu du piano dans une espère de vibration. Donc, oui, il y a une recherche du son, de cette brillance qui ne doit jamais être agressive. Je ne peux pas le dire autrement qu’une forme de qualité de lumière qui doit émaner de cette musique. Pour moi, c’est une cuisine, une alchimie pour essayer de trouver cette vibration là surtout dans le 1er mouvement parce que le 2e est plus narratif et raconte une histoire. Pour le coup, c’est un combat entre deux forces antagonistes et puis le final, c’est vraiment de la joie en action. Il y a un côté complètement jubilatoire. Et puis cette tonalité de sol majeur a véritablement une couleur que j’essaye de trouver. C’est vraiment quelque chose de très délicat en même temps, de très plein, de chaud, de brillant et avec énormément de douceur.
Avec le chef d’orchestre, Friedemann Layer, quand vous êtes arrivé aux répétitions, étiez-vous d’accord sur l’approche ou vous a il fallu imposer vos idées ?
Cela a été très immédiat car je pense qu’on a à peu près la même approche et puis on a cette manière assez similaire d’aborder les œuvres : une forme d’équilibre entre le respect de la partition et une forme de liberté, de capacité de flexibilité ou d’« improvisation ». Vous parliez du côté rapsodique du concerto, c’est étrange parce que c’est écrit avec beaucoup de gammes, de fioritures, d’arpèges - en soi assez technique -, et il faut arriver à en faire quelque chose de plus naturel. On était assez proche dans ce qui était du tempo…, dans cet équilibre, donc c’était très facile.
Pour rester dans Beethoven, lors de l’enregistrement du disque publié par Harmonia Mundi avec les sonates « Appassionata », « Clair de lune » et n°31 op 110, il y a ce son particulier d’un piano rare, un Steinway… Petite démarche expérimentale ou vous aviez juste un faible pour l’instrument ?
Non, pas du tout expérimentale mais c’est vrai que je suis assez jaloux des musiciens à cordes par exemple. Chaque instrument a une personnalité, a un son, quand ils sont à la recherche d’un grand Guarnerius ou Stradivarius… Il a déjà un caractère en soi ce qui n’est pas le cas pour un piano, surtout moderne qui peut être magnifique et très homogène avec beaucoup de possibilité mais quelque part cela sent l’usine. Il y a ce côté un piano ressemble à un autre piano. Un beau piano ressemble à un beau piano. Il y a quelque chose d’un peu standard.
Même chez Bösendorfer ?
C’est vrai que cela va être un petit peu plus typé, avec de grosses qualités et des défauts qui vont avec. Je cherchais un son pour cette musique. Quand je pense au 19e siècle et à toutes les innovations qui étaient faites - chaque année, des brevets étaient déposés - le piano en 50 ans a été développé de manière incroyable. Depuis la fin du 19e siècle, il ne bouge pas. Il n’y a plus eu de grands changements. Les compositeurs de cette époque étaient tous à l’affût des nouveautés. Celui que je joue sur ce disque est des années 1860-1880. C’est un peu une espèce d’idéal du caractère que peut avoir le piano forte - où chaque instrument a une personnalité et des défauts qui vont avec. C’est des pianos qui sentent le bois, pas le métal ou l’usine. On parle de l’âme d’un violon, ces pianos ont une âme. La fin du 18e siècle, c’est pour moi la quintessence, l’apothéose du piano forte, avec ce côté extrêmement typé, ce son parlant tout de suite. C’est déjà le piano moderne qui fait 2,80 mètres avec un son extrêmement long, de l’ampleur, très orchestral. J’ai été chercher une espèce d’idéal du piano du 19e siècle, qui n’est pas du tout celui que Beethoven aurait pu jouer puisqu’il est mort déjà depuis 50 ans, mais dans mon imaginaire, c’est le piano tel qu’il aurait pu le rêver. Cela donne cet équilibre entre piano forte et piano moderne avec pour moi toutes les qualités du piano forte et déjà les qualités du piano moderne en enlevant les défauts des deux.
i demain en concert on vous propose un piano complètement neuf … comment cela se passe t- il ? Vous vous adaptez ?
Ça, c’est vraiment le destin du pianiste…S’adapter à l’instrument, à la salle. C’est toujours une rencontre. On arrive à la salle de concert, à une répétition et on découvre l’instrument. Standard parce qu’aujourd’hui, un beau piano de concert, c’est une base de travail qui peut tous nous combler, d’une certaine manière.
Les Steinway Allemands sonnent quand même différemment des Américains ?
Très différemment et puis même parfois d’un Steinway à l’autre. Dès qu’un instrument a un peu vécu, qu’il a un vécu de concert de quelques années, il a été joué par les uns et par les autres, il a été travaillé et il y a quand même de très grosses différences. Effectivement, cela fait partie du jeu de s’adapter à l’instrument. Il a encore quelques pianistes qui voyagent avec le leur. De grands exemples qui l’ont fait comme Michelangeli ou Richter. En fait, j’ai des pianos de prédilection dont j’ai les numéros et il m’arrive de les rejouer.
Sur Paris ? en Europe ?
En France ou en Belgique par exemple. D’une salle à l’autre, il m’arrive de ne pas les reconnaître. Un piano qui m’a semblé idéal pour une grande salle de 2000 places, dans une petite de 300, ce ne le sera plus exactement. Pour un type de répertoire, ce sera formidable comme pour un concerto de Rachmaninov. Pour un concerto de Mozart, une sonate de Schubert, ce sera encore autre chose. Comme rencontrer un orchestre, de nouveaux musiciens, un nouveau chef, trouver un équilibre qui est sans cesse transformé. C’est le plaisir de la rencontre avec ses joies et parfois ses petites frustrations.
Y a-t-il une salle où vous avez déjà joué qui vous inspire particulièrement à cause de l’acoustique, de la chaleur du lieu ?
Oui, j’ai des salles dans lesquelles j’ai de grands souvenirs comme le Concertgebouw d’Amsterdam. Une salle magique, mythique et en plus qui sonne vraiment merveilleusement bien. D’autres petites salles que j’adore comme la salle du conservatoire de Liège, de taille presque idéale, 800 personnes, un écrin qui sonne merveilleusement. Je retrouve dans deux semaines la salle du Musiekverein de Vienne ce n’est quand même pas mal aussi. Vraiment de belles salles, souvent anciennes et puis des salles modernes, j’attends avec impatience la salle Pleyel qui a été faite par les mêmes architectes que la salle de Lucerne dans laquelle j’ai joué et qui est merveilleuse, une salle fantastique. Pour Pleyel, j’ai vu quelques photos et j’ai la chance de jouer la saison prochaine.
Quel répertoire aviez vous joué à Lucerne ?
J’avais fait un triple concerto de Beethoven. On fera du Ravel à la Salle Pleyel en musique de chambre.
J’allais aborder le sujet avec ce trio que vous formez avec les frères Capuçon.
Oui, enfin je ne dirais pas qu’on forme un trio parce qu’on n’est pas du tout exclusif. Pour certains répertoires, ils ont beaucoup joué avec Nicolas Angelich. Ils ont fait du Brahms ensemble, ils ont joué avec d’autres pianistes comme Martha Argerich… C’est vrai qu’on a quand même une complicité, ça fait des années qu’on travaille ensemble. On se retrouve très régulièrement. C’est une équipe très forte.
Comment a été possible cette collaboration ?
Là c’est encore une rencontre. J’ai rencontré Renaud quand il était tout jeune émoulu - il sortait du conservatoire - dans un festival à la Baule organisé par René Martin. On a joué une sonate ensemble et ça a tout de suite collé. A cette époque là, Gauthier n’était pas un bébé mais il était un adolescent et n’avait pas commencé la vie de concert. Evidemment, c’est le rêve de jouer avec eux deux qui se connaissent si bien, qui ont une capacité de se comprendre, de marier le son du violon et du violoncelle à un niveau très pointu. Arriver là et avoir déjà cette osmose entre eux est quelque chose de rare. Se joindre à cette équipe, cela forme quelque chose de très cohérent.
Et leur complicité, souvent il y a des anticipations incroyables sur scène…
Voilà, ce n’est pas que le côté ‘frère’ parce qu’ils jouent ensemble depuis très longtemps mais il y a vraiment une compréhension instinctive l’un de l’autre et une manière de respirer ensemble et de s’écouter même sans avoir besoin de se regarder. Il y a quelque chose de très fort entre tous les deux, c’est évident. S’intégrer dans ce rapport là, c’est un privilège.
Là, vous partez en tournée avec eux… (NDR en juin)
Oui d’ailleurs je les retrouve pour un triple de Beethoven à Athènes et puis en Autriche. Dans la tournée, je fais un Concerto de Beethoven, le 2e avec Neville Mariner. Formidable chef d’orchestre.
Est-ce qu’il fait partie de vos chefs préférés ? Les musiciens le citent souvent.
Je viens de le rencontrer. On n’avait jamais joué ensemble et là en un mois, on fait trois concerts différents ensemble. Un Mozart, le triple de Beethoven et le 2e. On s’en est amusé tous les deux quand on s’est rencontré. On s’est dit ‘on a attendu longtemps mais on va plus se quitter pendant un mois’. Oui, c’est un grand chef. Il a plus de 80 ans maintenant et a une expérience formidable derrière lui. Malgré cela, il a une fraîcheur - une forme physique étonnante - dans le travail et dans l’appétit de musique et de jouer. Une ouverture qui est admirable. Quelqu’un qui a joué comme ça avec tous les plus grands pourrait prendre de haut un jeune soliste, enfin quelqu’un qui a mon expérience, et bien pas du tout. Au contraire, il y a le plaisir de la rencontre. Il est extrêmement ouvert à la nouveauté et il est d’une souplesse exemplaire. Il aime accompagner donc c’est une grande qualité pour un chef. Je suis très admiratif des gens qui après une très belle vie de musicien ont toujours cette envie de jouer, d’apprendre du répertoire, de rencontrer des nouveaux musiciens. C’est une leçon !
Y a-t-il d’autres chefs avec qui vous aimeriez collaborer ou cela vient au hasard des rencontres ?
Non, je ne le dirais pas en ces termes là. Il y en a quelques uns avec qui j’aurais aimé jouer mais ils sont morts, Bernstein, Carlos Kleiber…une espèce de rêve. Après les rencontres sont parfois fortuites. L’année dernière, j’ai fait une rencontre absolument merveilleuse avec Armin Jordan, encore un grand exemple avec une culture et une expérience inouïe. Après tout ce n’est pas une question de grand chef. Il y a des rencontres qui opèrent tout d’un coup. Quand cela se passe, c’est un cadeau. Je peux très bien dire ‘je rêve de jouer avec Lorin Maazel ou Ozawa’ et puis que finalement, on ne se comprenne pas. Du haut de ma petite expérience, je sais que ce n’est pas une question de réputation ou de niveau. Parfois l’alchimie opère. C’est comme en musique de chambre, on peut faire des affiches formidables en ne mettant que des grands noms comme au foot en fin de compte. Le Real de Madrid, cela fait deux ans qu’ils ne gagnent pas le championnat. On peut mettre soit- disant les meilleurs ensembles et puis, ça ne prend pas. En musique, c’est pareil.
Sans cataloguer le phénomène, il y a de grandes saisons de concerts de série A, notamment aux Etats-Unis, où on réunit des grands noms…
On fait un casting, avec des grands noms… sans garantie.
A Verbier, cela se passe aussi comme cela !
Carrément ! Et alors si ça marche… si on met Martha Argerich avec Kissin (rires) et que ça fonctionne alors c’est atomique et tant mieux pour tout le monde.
Récemment à la Roque d’Anthéron, vous aviez pris la parole en préambule pour donner des clefs d’écoute au public, justifier des choix. Est-ce que vous pensez que ce genre d’échange fait défaut au rituel du cérémonial de la musique classique ou est-ce qu’il s’agit d’une initiative complètement personnelle ?
Je ne vais pas dire qu’il fait défaut mais je sais que j’aime le faire, quand je le peux, dans certains contextes, certaines salles ou répertoires. J’aime créer ce contact-là. A la place du public, cela me ferait plaisir. Evidemment, il y a le côté du rituel. C’est merveilleux quand cela fonctionne. Cela peut être la plus belle chose du monde quand il est habité. Un rituel qui est parfois vide de sens, c’est misérable tout simplement. Depuis que je suis adolescent, je me demande comment de temps en temps, on peut le bousculer voire complètement le faire imploser. J’ai fait pas mal d’expériences à ce niveau-là, beaucoup en musique de chambre. Dès qu’il y a une possibilité de créer un contact beaucoup plus direct avec le public, de démystifier le soliste qui arrive du haut de sa superbe dans sa bulle, c’est quelque chose que j’aime faire. Quand je vais voir Grégory Sokolov, qu’il est dans son monde et qu’il fait un concert stratosphérique, là le rituel est habité. C’est une espèce de sacerdoce la manière dont il fait son métier et c’est extraordinaire.
Cela vient de ma culture, quand j’étais ado j’avais plus une culture pop que classique. J’aime au concert sentir comme si la scène était une espèce de chez moi. Je m’installe, je reçois des gens comme s’ils étaient des invités. Pour partager un moment de musique. J’ai envie de leur dire à un moment pourquoi je joue ça, leur donner deux, trois clefs, il ne s’agit pas de faire un cours de master classe ou de didactique. Je sais que de l’autre côté, c’est très bien perçu aussi parce qu’il y a souvent un mur de glace, de verre entre la scène et le public. Un peu de prévention ou de peur dans les deux sens. Nous, ça s’appelle le trac, on connaît bien ça. Du public, il y a une grande révérence par rapport à la grande musique en disant, ‘je ne comprends pas, ce n’est pas pour moi’. Comme un langage ésotérique, c’est un peu la messe en latin. Moi, je n’officie pas en latin donc j’aime bien revenir au langage vulgaire au sens noble du terme. J’adore quand j’ouvre un bouquin d’un grand physicien qui arrive à me faire comprendre la théorie des corps : j’ai l’impression d’être plus intelligent. C’est la vulgarisation à son plus haut niveau. Dans la salle, il y a des gens qui sont mélomanes, qui ne savent pas lire la musique. Comment essayer de les faire rentrer dans la cuisine et leur faire percevoir des choses que nous, musiciens, vivons
? Quel genre de contact avez-vous justement avec le public ? Est- il anonyme ou y a-t-il des personnes qui viennent vous voir à la fin des concerts ?
On ne peut même pas parler du public, c’est un peu une masse informe. Nous n’avons que l’applaudimètre et s’ils crient ‘bravo’. C’est très pauvre par rapport à ce qui se passe en fait dans une salle. L’un peut s’ennuyer, s’endormir, l’autre être dans un état d’extase, simplement rêvasser, se détendre ou se couper de ses soucis de la réalité. Il y a tellement de manières d’apprécier un concert. Alors heureusement de temps en temps, quelqu’un sort du public et vient me voir. Pas pour me dire ‘vous êtes merveilleux, vous avez bien joué’ - cela fait toujours plaisir - mais pour me dire quelle expérience cette personne a faite ce soir là. On plonge un tout petit peu dans quelque chose qui est très intime et complètement mystérieux. Cela arrive rarement mais de temps en temps. Une lettre, un courrier. Quelqu’un qui exprime à tel concert ce qui s’est passé pour lui, ce qu’il a ressenti. J’aime avoir le retour. C’est en fait une aventure partagée, on est sur le même bateau. Le concert, c’est un moment complètement éphémère, que l’on vit ensemble. J’aime bien rencontrer les gens après le concert.
Est-ce que votre vie actuellement de concertiste correspond à l’idée que vous vous en faisiez quand vous avez choisi entre les sciences et la musique ?
Vous savez, on fantasme beaucoup sur la vie quand on est étudiant…sur la vie de musicien, de soliste. J’allais au concert, Salle Pleyel voir Brendel, Lupu, Pollini, Argerich… je me disais « ah oui un jour, peut être je serais là ! » Non, je ne dirais pas que ça correspond. C’était une suite de surprises, de découvertes, d’apprentissages. La vie de concert se vit, elle ne s’apprend pas. C’est in vivo avec des étapes, des cycles, des moments où on a l’impression de revenir en arrière ou avec l’expérience de libération. J’ai conscience maintenant du privilège que c’est d’avoir cette vie là. J’entends souvent dire que « ah oui, mais c’est dur »… Evidemment, je ne peux pas dire que c’est une promenade de santé. C’est beaucoup de travail, de stress et d’exigence. Le fait que le concert est à tel moment, à tel endroit et qu’il faut être là au moment même.
C’est aussi une performance qui demande beaucoup d’énergie mais c’est un privilège incroyable de vivre dans la musique. Mes collègues de travail, c‘est Beethoven, Mozart, Debussy, Ravel, Bach… c’est avec eux que je vis toute la journée. Et puis, des amis musiciens avec qui j’ai la chance de faire de la musique de chambre, des orchestres que je rencontre qui sont plutôt bienveillants quand j’arrive. La musique est une nourriture et c’est une très très bonne nourriture.
A certains moments, j’ai plus vécue cette vie de concertiste comme un combat parce que pour monter sur scène, il faut beaucoup de confiance et d’énergie. Et comme ce n’est pas un métier qui est dissociable de ce que l’on est dans le privé, on est très dépendants des différentes périodes que l’on traverse dans sa vie privée. Heureusement, je vis de mieux en mieux cette activité, un peu comme un cadeau.
Vous m’avez dit que vous aimez d’autres styles de musique comme la pop Est-ce que vous jouez du jazz en privé ? On sent une liberté dans votre façon de jouer Gershwin.
Non, justement !! C’est parce que je suis un pianiste de jazz raté !! (rires) que je me suis tourné vers cette musique. C‘est vrai que j’écoutais beaucoup de musique pop mais j’écoutais beaucoup de jazz adolescent. J’allais au concert. Mon frère, qui faisait de la musique, m’emmenait au New Morning à 13, 14 ans. J’avais une fascination surtout pour l’improvisation. C’est cette liberté- là que j’aime dans le jazz, chose que nous avons perdue. Il y a quelques musiciens classiques qui savent le faire encore aujourd’hui. Il faut se souvenir que de tout temps jusqu’au 18e, la musique a été contemporaine. Les interprètes étaient souvent compositeurs et généralement improvisateurs. Sur scène. Une cadence dans un concerto de Mozart, c’était comme un chorus en jazz. C’est une chose dont on s’est coupé et j’ai la nostalgie de quelque chose que je n’ai pas connue. C’était une manière de flirter avec cette musique, de m’en rapprocher le plus possible sans être hors sujet. Je ne vais pas commencer à faire du faux jazz alors que je suis médiocre dans ce domaine.
Gershwin était idéal pour moi parce que c’est une musique qui est complètement écrite qui a vraiment un style très fort. Il s’agissait de capter un esprit justement de liberté. C’est une musique très proche de la musique populaire, de la comédie musicale, de danse et en même temps, elle est très soignée, fouillée dans l’écriture. C’était un peu un défi : ou jouer comme une caricature jazzy dans le mauvais sens du terme… Chabadabada et essayer de faire swinguer ou jouer de manière trop rigide, trop classique et de ne pas arriver à trouver l’esprit. J’étais sur cette arrête du funambulisme, entre ces deux écueils. Cela dit ce n’est pas très différent : quand on joue du Mozart, c’est la même chose. Mon idéal en tant qu’interprète et aussi quand je suis dans le public, c’est d’avoir l’impression que la musique est recrée au moment même, même si elle a été écrite il y a deux cents ans. Comme si elle était improvisée. La marge de liberté n’étant pas du tout la même.
Etes- vous satisfait de l’enregistrement du DVD Gershwin réalisé lors de la Roque d’Anthéron ? il y a justement cette impression de liberté…
Là, il y a juste la rapsodie alors que sur le disque il y a toute l’oeuvre de Gershwin. C’est une pièce que j’ai beaucoup jouée et il m’arrive de la jouer en ayant l’impression que je l’improvise, que cela sort au moment même.
On parlait de ça tout à l’heure… Comment faire vivre le texte ? Une pièce de théâtre tout le monde peut la lire et se faire plaisir. La musique, très peu de gens peuvent ouvrir une partition et l’entendre. Elle préexiste, il suffit juste de lui redonner vie. Ce que je recherche est que cela semble le plus naturel possible. Au moment où on l’entend, que cela semble absolument convaincant, frais. Comme si cela prenait vie au moment même. C’est pas le côté gardien de musée, voilà, je vais vous jouer une énième version… C’était un enregistrement live, sans filet, en public, il y a cette intensité- là aussi. C’est comme un personnage qu’on s’approprierait. On rentre dans sa peau. On finit par faire corps avec. Après cela on peut déplaire, certains peuvent trouver que ce n’est pas la bonne esthétique, peu importe, tellement de gens proposent des choses différentes.
C’est une musique que j’ai beaucoup fréquenté et aussi, toute une période que j’aime, une élégance du début de siècle, des années 30, 40. Je n’ai pas du tout écouté Gershwin au piano quand j’ai préparé ce disque mais je me suis repassé parfois en boucle Ella Fitzgerald chantant Gershwin. J’ai revu Gene Kelly, Fred Astaire. C’est cette époque où les gens savaient tout faire et étaient des acteurs fantastiques, musiciens, danseurs. Quand on voit Fred Astaire danser, on sait que les numéros étaient répétés des semaines et des semaines mais on a l’impression que c’est aussi naturel que de marcher. Même les orchestres hollywoodiens, on voit le son qu’ils avaient, la culture, cette élégance. Le sens du style. On ne peut même pas comparer entre une comédie musicale de Gershwin et le spectacle Notre Dame de Paris. Gershwin était admiré par Schönberg, il y avait quand même des passerelles. Le jazz est une musique savante, très sophistiquée et qui en même temps touchait le plus grand nombre et avait un impact populaire. C’était une manière de puiser l’inspiration dans cette époque- là.
A l’heure actuelle, écoutez- vous les jazzmen vivants ? Vous arrive t-il d’aller au concert ?
Non, c’est vrai qu’il y a des disques que j’écoute en boucle ou des musiciens que j’ai beaucoup écoutés.
Du vieux jazz ?
Oui, si on parle de Bill Evans, de Keith Jarett, Art Tatum ou Eroll Garvin que j’ai écouté en boucle tout l’été dernier avec ‘concert by the sea’. Tout d’un coup, je me plonge dans un disque. Il y a ce duo de Michel Petrucciani avec Eddie Louis ‘Conference de presse’, qui est un moment de pure musique, on sent que chacun a la science de son art. Ce qui naît est complètement improbable, il pourrait ne pas naître et c’est complètement euphorisant. Non, je ne vais pas tellement au concert, c’est très curieux, je suis assez minimaliste. Il y a un livre ou deux livres qui voyagent avec moi, je vais les lire, les relire. Il va y avoir un disque que je vais écouter cinquante fois.
C’est très personnel ou vous pouvez nous donner des titres ?
Non, non, ce n’est pas personnel. Dernièrement l’immortalité de Kundera que j’ai relue je ne sais pas combien de fois. Des livres avec lesquels je vis. Des disques, alors cela peut être des disques pop Un disque de Muse que j’ai écouté en boucle l’été dernier. Ou un disque qui m’a le plus marqué, le dvd de Cecilia Bartoli et Il Giardino Armonico dans le disque Vivaldi. C’est une source d’inspiration où je m’abreuve. Ou alors je les ai entendus une fois et cela me poursuit pendant des mois comme si c’était le temps pour l’assimiler. Je ne suis plus tellement boulimique comme il y a une dizaine d’années. C’est peut- être l’âge qui fait cela, l’envie de revenir ou de prendre le temps d’aller chercher et creuser. Que ce soit une partition, un disque ou un livre ou même un film.
En pop, c’est peut être devenu compliqué pour tomber sur un disque qui sort du lot… Prenons l’exemple d’un Jeff Buckley qui a hypnotisé par sa voix tout un public en un temps très bref, l’espace d’un seul disque et ensuite d’un disque posthume…
Oui, par exemple. Mais après, ce n’est même pas un jugement esthétique. C’est une forme d’inspiration et ce n’est pas non plus à comparer avec Bach ou Beethoven. Pourquoi tout d’un coup, il y a deux mois, j’ai un petit flash avec Pink et j’écoute ce que fait cette fille ? Tout d’un coup, il y a une source et qu’est ce que j’ai à prendre ? Quand je vois Freddie Mercury sur scène. Moi, j’ai toujours le rêve sur scène d’avoir cet impact ou cette qualité de présence. Cette démesure sur scène, chose que par exemple Bartoli a sans ampli, sans micro, dans une salle de 2000 personnes et elle balance un air de Vivaldi et c’est Freddy Mercury à Wembley. C’est aussi fort. C’est acoustique, une présence, c’est la foudre qui tombe. C’est vrai que j’ai besoin d’aller dans beaucoup d’univers différents pour garder la fraîcheur, amener autre chose dans la musique que je fais. Je ne suis pas mono- maniaque. Je n’ai pas une âme de spécialiste. Je ne vis pas en vase clos dans un univers fermé qui ne serait que mon microcosme musical. J’aime le voyage. J’aime aussi faire l’école buissonnière, sortir prendre des chemins de traverse de temps en temps, même parfois sur scène.
Vous avez le temps pour cela ?
On a toujours le temps, il suffit de sécher en fait. Il suffit d’avoir la volonté.
Florence Michel
le 21 mai 2006, Le Corum, Montpellier.
Photo : DR
Derniers articles
-
06 Mars 2026François LESUEUR
-
05 Mars 2026Le Duo Reflet au Festival Elite de l’Ecole Normale de Musique (Salle Cortot) – Splendide maturationAlain COCHARD
-
04 Mars 2026Alain COCHARD







