Journal
Compte-rendu : Deux bals, un mort - Mazeppa et Eugène Onéguine à l’Opéra de Lyon
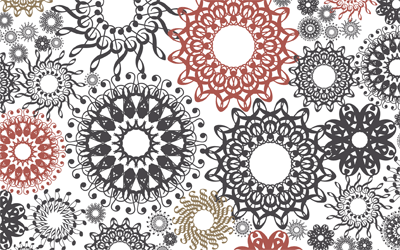
En patron d’opéra avisé, Serge Dorny a fait refaire à l’identique les décors d’Eugène Onéguine, sachant qu’en cette trilogie Pouchkine l’art de Stein s’y applique au mieux. D’ailleurs, la production, parfaite si ce n’est qu’elle évoque plutôt la Russie de Tchekov que celle de Pouchkine, commence à voyager ; nul doute qu’elle s’imposera comme un classique, avec ce que cela suggère comme aboutissement mais aussi comme limites.
Inutile de chercher ici la ré-interprétation fulgurante (ni la direction d’acteur au cordeau) d’un Tcherniakov. Stein vit sereinement dans son monde réaliste, il déroule presque avec naïveté les scènes sentimentales et la parabole sociale, les équilibre, fait triompher la terrible morale désenchantée en une scène finale anthologique. Peu de choses ont changé depuis la première série de cette production, et en tous cas, cette fois, Grémine ne chante pas son air les mains dans les poches, attitude peu noble qui nous avait froissé aux premières représentations et apparue alors comme une incroyable faute de syntaxe.
Avec le recul, on est obligé de concéder à Stein un formidable travail d’équipe qui fait le roman de Pouchkine indubitablement vivant. Mais cette équipe est aussi l’œuvre de Serge Dorny. Peu de directeur de maison d’opéra sont aussi versé que lui dans l’école de chant russe. Il repère les chanteurs de demain avec un œil aussi avisé qu’inspiré. On sait à quel point l’Onéguine de Wojtek Drabowicz avait marqué la production, être noir et pourtant attachant, monstre froid pour lequel on ne pouvait s’empêcher de ressentir une coupable et troublante compassion.
Alexey Markov ne va certainement pas si profond dans le personnage, mais son Onéguine univoque se retourne comme un gant dans la scène finale, fragile, perdu, fou, soudainement l’inverse de lui même. Il fallait pour produire cet effet soufflant – il vole la vedette à Tatiana, tour de force, alors même que l’ultime scène est habituellement son grand numéro d’actrice - justement faire jusque là son Onéguine un peu frustre, simple en tous cas. Et Markov, si il n’a pas encore l’impressionnante ligne vocale de Drabowicz, ni son timbre serré et noir si spécifique des barytons polonais, souvenez-vous d’Andrzej Hiolski, chante admirablement, phrasant large, parlant dans son chant, dessinant le texte.
A ce jeu des subtilités Lenski lui vole pourtant la vedette : Edgaras Montvidas détaille chaque inflexion du poète sans oublier de cambrer ses lignes, il montre dans le timbre cette nuance solaire des grands ténors lituaniens, avec quelque chose de l’élan italianisant d’un Virgilius Noreika. On pourra trouver son « kouda kouda » trop détaillé, mais cette palette de nuances, cette syntaxe si précise, qui plie le chant dans le mot, n’est rien moins que géniale. Le couple masculin Onéguine-Lenski, car sans aller aussi loin que la proposition de Warlikowski qui faisait assassiner Lenski par Onéguine au lit il s’agit bien d’un couple, idéalement apparié physiquement, emportait littéralement la soirée.
Une Tatiana formidable d’élan – dans sa lettre anthologique, elle emplissait la jauge de l’Opéra de Lyon d’aigus aussi pleins que projetés – et qui ajoute une incarnation majeure au personnage, avec cette chaleur typique que seules savent y mettre les sopranos ukrainiennes, Olga Mykytenko, semblait plus proche de l’idéal de Pouchkine que tous ses comparses : le naturel et le tourment réunis avec un art qui cache l’art, admirable, renversant d’autant que cette magnifique musicienne a pris depuis la création du spectacle un aplomb supplémentaire, dessinant plus exactement le personnage (la scène de lettre animée seconde par seconde). Et toute la distribution vibrait de la même grâce : l’Olga mutine d’Elena Maximova, voix du bon dieu, physique sublime, refusait de noircir son âme (chez Tcherniakov, c’est elle la mauvaise, elle qui tue par avance Lenski, ici simplement une brave fille devenu durant le bal du II le jouet d’ Onéguine), la nourrice tendre et subtilement détaillée de l’admirable Margarita Nekrassova, le Monsieur Triquet composé avec art par Jeff Martin, un Prince Grémine lyrique et tendre qui savoure son air avec délectation mais sans ostentation , l’immense Michail Schelomianski, puis, bien entendu Marianna Tarasova, Madame Larina plus vraie que nature et pourtant plus noble qu’à l’habitude. Cette tenue du chant et du personnage frôlent le génie. Tous étaient amoureusement accompagnés par la battue ardente de Mikhail Petrenko, dont la direction pleine d’apartés, les équilibres poétiques transcendant, la liberté agogique enfin assumée, disaient toutes les complexités d’une partition inépuisable.
La veille, une autre véritable équipe donnait presque toutes ses chances au difficile mais essentiel Mazeppa. Olga Guryakova exprime les désarrois et la passion amoureuse de Maria avec une simplicité désarmante, les chantant avec cet engagement qui porte ton son être et excuse quelques duretés dans un chant parfois un peu bas. Oui, Anatoly Kotscherga exagère à chanter tout du long si faux, mais il sauve son Kotchoubeï par un parlando sidérant de vérité psychologique. Oui Nikolai Putilin ne peut offrir que les limites de son chant mais avec une honnêteté qui lui gagne tous les pardons –d’autant qu’il savait très bien ne pas pouvoir effacer le somptueux souvenir qu’y avait imprimé à jamais Drabowicz – et du moins a-t-il exactement l’âge du rôle, ce qui redonne à l’intrigue son élément primordial. Marianna Tarrasova retrouve en Lioubov un grand rôle qui la rembourse des emplois de composition où elle brille mais où elle ne donne qu’une part de son art magistral, Misha Didyk est le plus vaillant des Andreï, Edgaras Montvidas un Iskra de luxe, Jeff Martin en deux geste campe un incroyable cosaque ivre, et Alexey Tikhomirov fait mieux qu’une utilité en Orlik : comme pour son Zaretski d’Onéguine, un vrai personnage. Orchestre âpre et sombre, tendu à rompre par la baguette de Petrenko.
En sortant de ces Pouchkine lyonnais, on se prenait à espérer qu’une équipe aussi fabuleuse nous offrira un autre Tchaïkovski : le très surprenant Opritchnik, troisième essai lyrique de l’auteur, une œuvre fulgurante à la scène, attend toujours sa première française, pour ne pas évoquer La Pucelle d’Orléans, l’Enchanteresse, le Voïévode ou Les Souliers….
Jean-Charles Hoffelé
Tchaikovski : Mazeppa, Eugène Onéguine - Opéra de Lyon, le 18 et 19 mai 2010
> Vous souhaitez répondre à l’auteur de cet article ?
> Lire les autres articles de Jean-Charles Hoffelé
Photo : DR
Derniers articles
-
27 Février 2026Jacqueline THUILLEUX
-
26 Février 2026Alain COCHARD
-
25 Février 2026Michel EGEA







