Journal
Une interview de Nicolas Stavy, pianiste – "L’une des particularités de la musique de Schnittke, c'est vraiment l'intensité du silence. »

Nicolas Stavy vient de faire paraître chez BIS (1) le premier volume d’une intégrale de la musique pour piano d’Alfred Schnittke (1934-1998). Esprit curieux, amoureux des chemins de traverse, l’interprète a choisi non une organisation chronologique mais une construction en arche mêlant des pièces de diverses époques. Une découverte passionnante et un éclairage précieux sur un compositeur dont on connaît mieux la production symphonique ou chambriste.
En attendant le récital de sortie de disque, le 30 janvier à la salle Cortot (2), on retrouve Nicolas Stavy à la Bibliothèque nationale de France (Salle Ovale) dès le 1er décembre, en compagnie des archets d’Hélène Collerette, Marc Desmons et Virginie Constant, pour un séduisant programme Fauré (1ère Sonate pour violon et piano), Debussy (Nocturne et Scherzo pour violoncelle et piano) et Ernest Chausson (Quatuor avec piano). Un concert proposé parallèlement à l’exposition « Impressions nabies » et inscrit dans le cours de la cinquième saison musicale européenne de la BnF et de Radio France.(3)
Poursuivant votre exploration de territoires peu parcourus de la musique, et après un disque Tishchenko (les Sonates nos 7 et 8, chez BIS), vous vous êtes lancé dans l’intégrale de la musique pour piano d’Alfred Schnittke. Pourquoi votre attrait pour ce compositeur ?
Ma curiosité pour la musique russe remonte à l’enfance. Tout a commencé par Chostakovitch (4), un compositeur qui m’a fasciné : son intensité, sa gravité résonnaient en moi. Beaucoup pour des questions familiales, des questions d'origine, une partie de ma famille ayant disparu pendant la seconde guerre mondiale en Europe de l'Est. D’un contexte historique grave, Chostakovitch a créé une œuvre inouïe.
Et si je me suis intéressé à Tishchenko, et à présent à Schnittke, c'est parce qu’il me semble que ce sont les deux compositeurs, pendant et après Chostakovitch, qui ont le plus été nourris par l’intensité et la gravité de leur époque.
« Schnittke se définissait comme un compositeur russe, complètement russe, mais sans une goutte de sang russe ! »
Schnittke a de multiples origines et présente un côté profondément russe, même s'il ne l'est pas à proprement parler. C'est un Russe d'adoption, d'origine allemande. Il appartient à une Europe orientale vaste. Ce mélange culturel est très présent, tout comme ses origines germaniques : derrière un langage profondément russe, on le sent dans la structure des œuvres. Schnittke se définissait comme un compositeur russe, complètement russe, mais sans une goutte de sang russe !
Dans le premier volume de mon intégrale, j'ai voulu d’emblée donner cet éclairage, cette variété. Il en sera de même pour le second : j'ai cherché à construire les deux disques comme des programmes de concert, c'est à dire chacun avec une arche.
Je pense que ce sera vraiment une découverte pour une immense majorité du public, comme ça l’a été pour moi, même si je connaissais relativement bien le répertoire chambriste et orchestral de Schnittke. Sa musique pour piano, en occident, reste confidentielle bien qu’elle présente une immense richesse artistique.
J’ai voulu vraiment créer cette arche, montrer la variété d’écriture avec des pièces de jeunesse, des pièces centrales comme la vaste Sonate n° 2 (1990), très polyphonique, très construite, et les Cinq Aphorismes (1990). Ce petit cycle constitue pour moi un bijou ; une musique vraiment inconnue, presque abstraite par moments. Et cette profondeur des silences ... C’est une musique dont il faut s’imprégner, on ne l’écoute pas d’une demi-oreille. On entre dans un univers d'une densité et d'une intensité absolument gigantesques. Ça a été une découverte assez bouleversante.
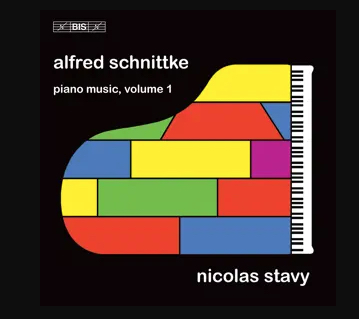
« Il est de notre responsabilité d’interprète de jouer cette musique afin qu’elle soit mieux connue. »
Pour nous aussi, croyez-le bien. Rappelons juste que Schnittke est né en 1934 et est mort en 1998. Il a eu beaucoup de mal à sortir d'URSS. Mais il a été interprété par certains des plus grands musiciens soviétiques, le Quatuor Borodine par exemple, qui ont en quelque sorte « popularisé » sa musique en occident ...
En Union Soviétique, Schnittke était vraiment une star gigantesque, tout comme en Allemagne. En France, on le connaît surtout pour son œuvre orchestrale, un peu sa musique de chambre. Je crois qu'on le joue beaucoup aux Etats-Unis aussi. En France, on a encore cette difficulté d'aller au-delà de Chostakovitch. Il est de notre responsabilité d’interprète de jouer cette musique afin qu’elle soit mieux connue.
J’ajoute que le fait de travailler avec un label tel que BIS pour ce projet est pour moi une chose formidable. À l’exception de la musique pour piano, ils avaient quasiment enregistré tout Schnittke. Ils ont commencé il y a environ trente ans alors même que le compositeur était encore vivant.
> Les prochains concerts contemporains de piano <

© A.S. di Girolamo
« J’essaie d'élargir mon répertoire et de me transformer à chaque fois ; un peu comme chez un acteur. »
Vous êtes issu de l’école française – Dominique Merlet, Gérard Frémy, Christian Ivaldi ont été vos professeurs. Votre éducation musicale s’est donc faite à travers un répertoire éloigné de celui que vous explorez aujourd’hui ...
J'ai commencé très tôt à travailler avec Dominique Merlet, connu pour être spécialiste de Debussy et Ravel. Dès mon adolescence, il m'a vraiment formé avec l'idée d’aborder une pluralité de répertoires. Un interprète, selon lui, devait être un caméléon. J’essaie d'élargir mon répertoire et de me transformer à chaque fois ; un peu comme chez un acteur. Il y a de grands acteurs, je pense à Jean Gabin par exemple, qui a été une immense figure du cinéma et qui avait une personnalité incroyablement intense. Eh bien, on lui a confié, voire écrit, des personnages qui collent à cette stature, à ce charisme exceptionnels. Et il y a d'autres acteurs auxquels je m’identifie plus. Je me souviens d’avoir vu Michel Bouquet, sur scène au théâtre, qui était absolument saisissant et qui jouait une pièce incroyable sur Furtwängler (À torts et à raisons de Ronal Harwood, où Michel Bouquet était face à Claude Brasseur ndlr). En le voyant sur scène, j’ai littéralement vu arriver Furtwängler ; il n'y avait pas de doute, c'était bien lui ! C’est cette façon d'incarner qui me séduit.
Mon activité d'interprète est justement d'essayer de me transformer, de me mettre au service de l'œuvre et du compositeur. Donc, quand je joue les Sept dernières paroles du Christ de Haydn, que j’ai enregistrées (BIS), quand je joue du Chopin, du Chostakovitch, du Schnittke, du Brahms ou du Schubert, je tente vraiment de me plonger dans une époque, dans un univers.
« Je voulais terminer avec une des œuvres les plus sombres mais aussi les plus énigmatiques. »
Le disque s’ouvre, de manière assez saisissante, par le Prélude et Fugue de 1963. Vous auriez pu opter pour les Cinq Préludes et Fugue de 1953-54 (il s’agit bien de cinq préludes suivis d’une unique fugue ndlr), de caractère post-romantique, et premier ouvrage du programme dans l’ordre chronologique. Pourquoi ce choix ?
A vrai dire, j'ai beaucoup hésité. Initialement, je voulais commencer par les Cinq Préludes et Fugue parce qu'en effet ça aurait été à la fois l'ordre chronologique et aussi un ordre d'évolution stylistique. Mais là encore, entre ces considérations et une arche musicale, je choisis toujours l'arche musicale ! L’une des particularités de la musique de Schnittke, c'est vraiment l'intensité du silence. Et dans ce Prélude et Fugue, qui ouvre le disque, comme dans les Aphorismes qui le referment, on trouve cette intensité. Et je voulais terminer avec une des œuvres les plus sombres mais aussi les plus énigmatiques. Une manière refermer le programme par des points de suspension. De plus les Cinq Préludes et Fugue, que j’ai placés entre la 2ème Sonate et les Petite Pièces de 1971, apporte une respiration, une parenthèse d’air frais dans le cours de l’enregistrement, ce qui me paraît très important.

© Ch. Lamotte
« Il est rare qu’une œuvre de jeunesse, d'un compositeur en devenir, offre ce niveau d'inspiration. »
Connaissiez vous ces œuvres pour piano de Schnittke avant de préparer cet enregistrement ?
Non, je ne les connaissais pas, à l’exception du Prélude et Fugue que j'avais écouté il y a bien longtemps. J’ai envie de poursuivre chez Schnittke et, après le répertoire pour piano seul, j’aimerais aborder le Quintette – immense chef-d’œuvre ! – et le Concerto pour piano et cordes. J’aimerais aussi jouer le Quatuor avec piano qui a été pensé comme complément au Mouvement de quatuor de Mahler. Et puis plein d'autres choses, dont les deux sonates pour violoncelle et piano.
Pour revenir aux Cinq Préludes et Fugue, composés par un Schnittke de 19 ans, il est rare qu’une œuvre de jeunesse, d'un compositeur en devenir, offre ce niveau d'inspiration. Pour prendre un exemple très différent, quand j'ai fait mon disque Fauré (BIS), j’ai enregistré deux inédits : une mazurka qui est déjà très riche et très belle et une petite sonate de jeunesse en trois mouvements. Il n’en a jamais écrit d’autre par la suite. Elle est adorable, mais on sent que c'est vraiment une étude de style. Elle est étonnante, parce qu’on sait que c’est du Fauré, mais c'est une œuvre à la manière de Haydn ou de Mozart, qui n'est ni du Haydn, ni du Mozart ... pas plus que du Fauré ! C’est très différent avec les pièces de jeunesse de Schnittke, d'une beauté absolument incroyable.
Parlons enfin de la Sonate n°2, qui est très spectaculaire. Avec dans le dernier mouvement un instant de suspension, très tendre et ... étonnant !
Tout à fait. Cela tient à ce qu’il intervient en plein milieu d’un mouvement assez endiablé où Schnittke fait beaucoup penser à Prokofiev ou à Chostakovitch, son mentor. On peut presque parler de rage dans ce final, d’une énergie proprement fulgurante. Et pourtant, il finit pianissimo avec quelque chose de très profond.
Propos recueillis par Frédéric Hutman, le 1er octobre 2025

(1) Alfred Schnittke, vol. 1 : Prélude et Fugue (1963), Sonate n° 2 (1990), Cinq Préludes et Fugue (1953-54), Petites Pièces pour piano (1971), Cinq Aphorismes (1990) - 1CD BIS -2797 / SACD
(2) Salle Cortot / 30/01/26 : sallecortot.com/event/nicolas-stavy-piano-schnittke-bach-schubert/
(3) Bibliothèque nationale de France (Site Richelieu / Salle Ovale) / 1/12/2025 : www.bnf.fr/fr/agenda/concert-dans-le-salon-des-nabis-ernest-chausson-gabriel-faure-claude-debussy
(4) Rappelons la réussite de Nicolas Stavy dans un programme d'inédits de Chostakovitch (parmi lesquels la version pour soprano, basse, piano et percussions de la 14e Symphonie) - "Shostakovitch / Works unveiled" - BIS - 2550 /SACD
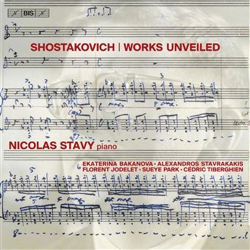
Photo © Jean-Baptiste Millot
Derniers articles
-
21 Février 2026François LESUEUR
-
21 Février 2026Alain COCHARD
-
18 Février 2026Laurent BURY







