Journal
La Passagère de Mieczysław Weinberg en création française au Capitole de Toulouse [jusqu’au 29 janv. ; Mezzo 8 févr.] – Nuit et brouillard – Compte rendu
La Passagère de Mieczysław Weinberg en création française au Capitole de Toulouse [jusqu’au 29 janv. ; Mezzo 8 févr.] – Nuit et brouillard – Compte rendu

Le répertoire lyrique n’est pas un catalogue clos. Il recèle toujours des chefs-d’œuvre oubliés. Ce constat ne concerne pas les seules périodes baroque et romantique. La Passagère (1968), du Russo-Polonais Mieczysław Weinberg (1919-1996), en fait partie. Sa création française au Capitole de Toulouse constitue un choc moral et émotionnel qui la place d’emblée au rang des Dialogues des Carmélites, de Lulu ou de Lady Macbeth de Mzensk.


© Mirco Magliocca
Sublimer l’horreur
L’amitié féconde qui liait Chostakovitch et Weinberg ne doit pas oblitérer la profonde originalité de ce dernier. La Passagère, comme née à l’écart des agitations formelles de l’Occident post-sériel, est unique en son genre. Par son sujet, d’abord : elle traite de la déportation et de la Solution finale. La majeure partie de l’action se situe à Auschwitz. La famille du compositeur périt au camp d’extermination de Trawniki – un sort auquel lui-même échappa, laissant dans son âme une douleur inextinguible, où la perte se mêle à un véritable syndrome de Lazare. Pourquoi survivre ? Et pour en faire quoi ? Cette œuvre coup de poing, que nous recevons en plein visage.
Weinberg a tiré de ce passé intolérable un opéra qui sonne, perpétuellement, juste. Il s’est inspiré pour cela d’un roman de Zofia Posmysz, survivante de la Shoah, paru en 1959 et, à ce jour, jamais traduit en français ni en anglais. Elle aborde le sujet sous un angle inattendu : racontant l’histoire du point de vue d’une ancienne gardienne d’Auschwitz. Un renversement vertigineux, qui permet d’explorer les mécanismes de la culpabilité et du refoulement.


© Mirco Magliocca
Naufragés de l’Histoire
Sur un paquebot en partance pour le Brésil, un couple allemand fortuné fête sa lune de miel. Le bonheur post-guerre est brutalement interrompu par la vision d’une étrange femme en laquelle Lisa — Anaïk Morel (1), charnelle, éperdue — croit en reconnaître une autre jadis connue dans le camp, lorsqu’elle y sévissait sous son véritable nom : la SS Anneliese Franz. Elle a tu à son époux Walter (le vaillant ténor Airam Hernández, parfait en mari égoïste) sa vie d’avant 1945. Tout va dès lors ressurgir. Ce qui est évoqué ira à rebours des conventions liées à la déportation. Si Lisa fut bourreau, elle le fut d’abord d’elle-même. Se révèle peu à peu un personnage d’une grande complexité, en quête de considération de la part de ses victimes, et s’étonnant de se voir haïe.

> Les prochains concerts en Midi-Pyrénées <

© Mirco Magliocca
Dialogues d’Auschwitz
De là découle une bienveillance déplacée, qui l’amena à protéger, dans le camp, l’amour de Marta — la passagère, incarnation fantastique de Nadja Stefanoff, flamme sombre et tenace— et de son fiancé Tadeusz, violoniste juif, dont la gardienne SS précipitera pourtant la perte. Plutôt que de raisonner en noir et blanc, en victimes et bourreaux, le livret de La Passagère explore les ambivalences profondes de la repentance allemande. C’est souvent du Hannah Arendt mise en notes. L’intrigue développe également la sororité et les rivalités entre les déportées du camp — françaises, polonaises, lituaniennes, russes, juives… Une Babel de douleur, à laquelle correspond musicalement une Babel de langues : yiddish, allemand, français, russe, anglais. Tous les modes d’expression sont convoqués : théâtre parlé pour les aboiements rauques des SS, Sprechgesang, lignes vocales épurées issues de l’opéra classique, mélodies folkloriques. La distribution, très majoritairement féminine, n’est pas sans évoquer celle des Carmélites de Poulenc. S’en détachent peu à peu Céline Laborie et Victoire Brunel, Ingrid Perruche, la Bronka bouleversante de Janina Baechle, la belle Yvette de Julie Goussot, Anne-Lise Polchlopek, Sarah Laulan.
Moussorgsky et grincements jazzy
La production, signée Johannes Reitmeier, venue d’Innsbruck, se révèle littérale et efficace. L’action, se déployant sur deux temporalités — celle du navire et celle des flashbacks d’Auschwitz — prend place sur une tournette dévoilant une complexe structure de bois aux formes allusives : tour à tour proue de paquebot, salon luxueux, ou dortoir sinistre du camp. Une tourelle domine l’ensemble, évoquant à la fois une cheminée de navire et celle d’un crématoire. Ce mur noir de la mort est invoqué par le chœur — très impliqué — de l’Opéra du Capitole dans de grands aplats choraux où le compositeur fait soudain surgir les mânes de Khovanchtchina.


© Mirco Magliocca
L’œuvre aura débuté par une ouverture brutale, entamée aux percussions et aux cuivres, durant laquelle on voit brièvement tout un peuple basculer d’une vie quotidienne à l’exil, puis à l’indifférenciation mortelle de la numérotation. Les identités s’effacent ; ne restent que les tatouages, l’inscription sur une liste, et la marche vers la Solution finale. L’Orchestre national du Capitole jette toute son énergie sous la direction inspirée de Francesco Angelico, les pupitres de cordes portant l’émotion à des niveaux troublants. De cette matière âpre émergent aussi de vastes plages lyriques, notamment au début de l’acte II, lors des retrouvailles amoureuses de Marta et de Tadeusz — rôle dans lequel le baryton Mikhail Timoshenko se montre bouleversant.
La partition brasse, dans un même geste créatif, jazz, riffs de guitare électrique, chants orthodoxes, musique klezmer et théâtre parlé. Surgit parfois un trio vocal évoquant les Parques, notamment pour les trois SS, rôles redoutables incarnés par Damien Gastl, Baptiste Bouvier et Zachary McCulloch. Point d’orgue de la soirée : la citation puis la déconstruction de la Chaconne pour violon seul de Bach, dont l’iridescente mélancolie fond sur le public, au terme d’une représentation émotionnellement éprouvante, par son sujet, par son traitement, par son irréprochable interprétation.

Le Quatuor Danel © Marco Borggreve
Un concert pour mémoire
La veille, au soir, en préambule à cette première française, on aura pu entendre, au même Capitole, deux quatuors de Weinberg et le Quintette pour piano et cordes de Chostakovich, par le Quatuor Danel et la pianiste Elisabeth Leonskaja. Perturbante musique que la 2e Sonate en si mineur de Chostakovitch, amplie de marches avortées et de répétitions lancinantes, comme si l’armée des ombres se présentaient à notre imaginaire, écho du roman Vie et destin de Vassili Grossman. L’immense pianiste, qui a connu Chostakovich, sert le maître en babouchka bienveillante. Quant au Quatuor Danel, qui œuvre à la découverte de l’œuvre de Weinberg (2), c’est la fougue, et la précision qui sidère, notamment celle du premier violon Marc Danel dans le 6e Quatuor op. 35 (1946) de Weinberg, terrible d’aspérités, de violences et de désintégrations. Musique brutale, autoritaire, composée comme sur le fil d’un rasoir. En seconde partie, le très troublant 2e Quatuor op.3 (1940) où Haydn ne cesse de pointer l’oreille avant de se diluer en thèmes de valses et en amplitude beethovenienne. Apothéose finale avec l’Opus 57 de Chostakovitch, où le formalisme de rigueur, noue des noces barbares avec le moi d’un créateur à la révolte contenue. Ces deux passagers du XXe siècle ne nous laissent pas indemnes.

Vincent Borel

(1) Lire l’interview d’Anaïk Morel : www.concertclassic.com/article/une-interview-danaik-morel-soprano-toulouse-23-29-janv-mezzo-8-fev-il-faut-entrer-1000-dans
(2) Rappelons que le Quatuor Danel a signé une très belle intégrale en 6 CD des 17 quatuors de Weinberg chez CPO.
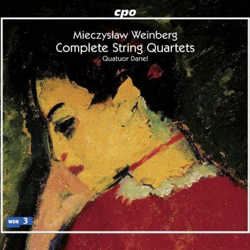
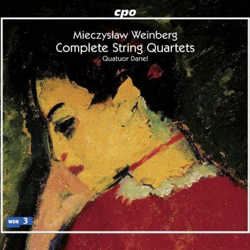
Weinberg : La Passagère (création française) – Toulouse, Théâtre du Capitole, 23 janvier ; prochaines représentations les 25, 27 et 29 janvier 2026 // https://opera.toulouse.fr/la-passagere-7818117/
Photo © Mirco Magliocca
Derniers articles
-
10 Mars 2026Thierry GEFFROTIN
-
10 Mars 2026Alain COCHARD
-
09 Mars 2026Alain COCHARD







