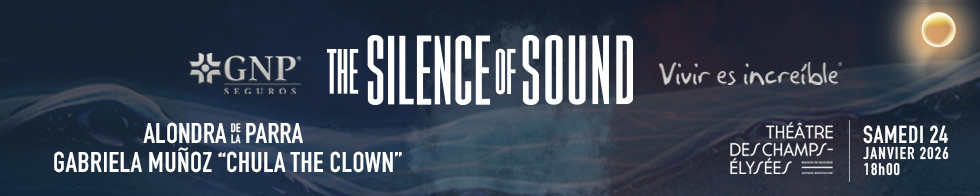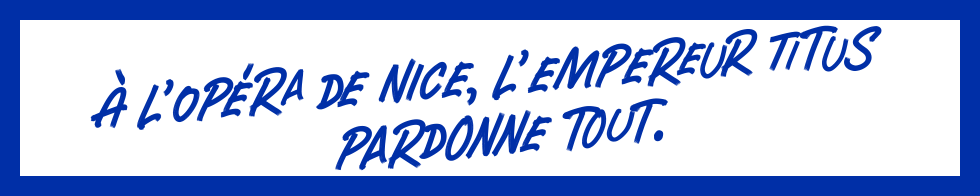Journal
La Main gauche de Ramon Lazkano en création scénique à la Cité de la Musique – L’empreinte de Ravel – Compte rendu

La traversée à bord du France et la tournée en Amérique, l’invention du Boléro, la visite de Wittgenstein et la création du Concerto pour la main gauche, celui en sol avec son adagio composé « deux mesures par deux mesures »… Tous ces épisodes bien connus de la vie de Ravel apparaissent dans le roman (Ravel) que Jean Echenoz lui consacra en 2006. Curieux roman, plein d’ellipses, hommage à un compositeur dont il ne scrute que les dernières années, celles où sa musique jaillit encore en quelques éclairs prodigieux avant de s’éteindre. Structuré en courts chapitres, il semble courir après Ravel, ne parvenant à attraper que quelques scènes, fragments de vie et de musique.

© Quentin Chevrier
La Main gauche, l’opéra qu’en tire Ramon Lazkano aujourd’hui, après une longue gestation, renforce encore cette impression d’un récit, d’une vie et d’un art qui s’émiettent, qui s’érodent, qui s’effacent. D’abord parce qu’il redécoupe encore le livre pour en faire un livret. Est-ce que cela peut se chanter ? Anne-Marie Lazarini avait porté sur scène le même roman, avec l’acteur Michel Ouimet dans le rôle de Ravel et deux autres acteurs pour incarner tous les autres personnages – ce choix de rôles multiples et aussi celui de Ramon Lazkano. Mais c’était du théâtre ; la musique propre à l’écriture de Jean Echenoz, pleine de syncopes, n’avait pas à se plier aux conventions lyriques. Dans un entretien paru dans le programme de salle, Ramon Lazkano dit ne pas chercher « à faire chanter mon personnage de Ravel de la manière dont il fait chanter sa musique », ce qui est sans doute sage. Peut-être un peu trop sage même : le chant se tient dans l’ensemble dans une prosodie sans grande surprise, sorte de conversation en musique qui ne s’anime qu’à de rares moments – curieusement, ceux les plus proches de la voix parlée.

Pierre Bleuse © Quentin Chevrier
> Les prochains concerts de musique contemporaine en Ile-de-France <
Marie-Laure Garnier, d’une extraordinaire justesse
Cela rejaillit sur – ou est amplifié par – l’interprétation. Si la trajectoire vocale de Ravel se révèle avec évidence, d’une certaine volubilité à une expression resserrée voire laconique, le ténor Peter Tantsits ne lui donne ni ampleur ni véritable caractère – là où au théâtre, Michel Ouimet faisait littéralement vivre Ravel. Quant aux multiples figures portées par le baryton Allen Boxer (du commandant du France à Paul Wittgenstein), elles ne se distinguent guère les unes des autres. Seule Marie-Laure Garnier, voix assurée, prononciation impeccable, impose sa voix et son charisme. Parmi ses multiples rôles (Hélène Jourdan-Morhange, Marguerite Long…), son interprétation d’Ida Rubinstein, quand Ravel lui offre son Boléro, est d’une extraordinaire justesse : quelques mouvements, mais surtout une présence irradiante, suffisent à faire apparaître la danseuse dans un moment de parfaite magie lyrique.

Pierre Bleuse © Quentin Chevrier
Une floraison d’idées merveilleuses
Au fond, dans cette Main gauche, l’essentiel se passe à l’orchestre. C’est là que chaque scène trouve sa singularité. Là aussi, à défaut de la voix, que se trouve l’empreinte ravélienne, pas tant dans l’orchestration (quinze musiciens dont un accordéon et un très subtil assortiment de percussions) que dans l’esprit. Quelques bribes de Ravel passent. Musique purement diégétique quand est évoquée la Sonatine que Ravel joue en oubliant le Menuet, mais le plus souvent prémonitions ou réminiscences allusives (le Boléro, La Valse, les concertos, L’Enfant et les Sortilèges, réduits à quelques rythmes, timbres ou fragments mélodiques fugaces). C’est là, dans cet orchestre, l’Ensemble Intercontemporain magnifiquement dirigé par Pierre Bleuse, que se trouve probablement le cœur de la réflexion de Ramon Lazkano sur la musique de son aîné, mais aussi, plus généralement sur toute musique et tout art : une floraison d’idées merveilleuses, toujours sous la menace de l’oubli.
C’est là aussi, semble-t-il, que prend appui la vidéo de Mathieu Crescence qui vient compléter la mise en espace légère mais efficace de Béatrice Lachaussée, intégrée au plateau, au sein et autour de l’orchestre. Au-delà d’un apparent naturalisme (locomotives, océan, nature, maison de Ravel), la composition vidéo figure une mémoire déjà fragilisée, avec ses manques et ses palimpsestes.
Jean-Guillaume Lebrun

Lazkano : La Main gauche – Paris, Cité de la musique, 3 octobre 2025
Photo © Quentin Chevrier
Derniers articles
-
22 Janvier 2026Thierry GEFFROTIN
-
20 Janvier 2026Michel ROUBINET
-
20 Janvier 2026Laurent BURY