Journal
Paris - Compte-rendu : L’envers du tableau, Bastille rend justice à Tannhäuser dans sa version parisienne
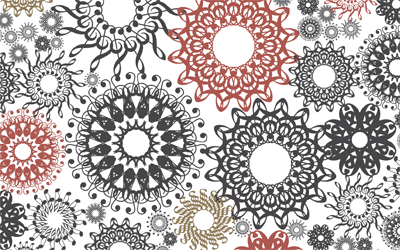
Gustav Courbet et son « Origine du Monde » sont partout dans Paris en cette fin d’année jusque sur la scène enfin « dégrèvée » de la Bastille. Robert Carsen aura cédé à cet enthousiasme du moment en la plaquant sur le personnage de Tannhäuser, rendant explicite, voire trivial, le Venusberg, ce Mont de Vénus qui désigne en poétique de barrière le con féminin. Le Minnesänger sera donc peintre, et peintre romantique, Vénus son modèle, Elisabeth sa muse. Astuce habile, un tableau retourné fait voir la croix de son bâti. Carsen s’en servira abondamment pour ses pèlerins, tous peintres, et partant à Rome avec les toiles retournées exposant leurs croix. Tout cela fonctionne d’autant mieux qu’on ne subit pas une réduction de sens, comme si souvent dans les relectures de Carsen, mais au contraire un élargissement du propos. Car quel héros wagnérien peut se targuer d’être l’autoportrait voilé du compositeur, sinon Tannhäuser ?
Si Carsen n’a pas renoncé à ses tics – oui, vous aurez des serviteurs et un cocktail – il réussit particulièrement la dramaturgie de l’acte II, a vrai dire la meilleure Wartburg qu’on ait vue, portant le chœur et les ensembles du tournoi de poésie-peinture jusqu’à incandescence et faisant une grande partie du spectacle dans la salle : conséquence, on vérifiait une fois de plus que l’acoustique de Bastille brillait devant la fosse et s’éteignait derrière celle-ci.
Comme si un bonheur ne suffisait pas, la distribution et l’orchestre atteignaient des niveaux stratosphériques plus entendus depuis des lustres dans cette œuvre que ce soit à Paris ou ailleurs : on ne confirmera pas pour la Venus de Béatrice Uria-Monzon les bémols dont nos confrères l’ont affublée : la voix est longue, déployée sur tout l’ambitus, d’une sensualité opulente, avec déjà cette maîtrise de la grande ligne et cette puissance de projection qui caractérise les interprètes majeurs du rôle, sans évoquer la plastique légendaire de l’artiste qui par pudeur a préféré laisser sa place à une doublure pour le modèle nu. Et son allemand, pour ce qui s’avère son premier rôle wagnérien, sonne tout à fait plausible.
Stephen Gould retrouvait le vrai format du Heldentenor que veut Tannhäuser. La voix est splendide en des termes athlétiques, suprêmement saine, alerte, avec déjà dans le médium ce grain un peu sombre qui permet aux vrais ténors wagnériens d’asseoir leur carrière. Le retour de Rome le montre en pleine forme là où tant n’ont plus que quelques cordes vocales élimées à faire entendre. Mais pardon, si Carsen voulait un Tannhäuser artiste, alors le coup porte à faux, car Gould ne nuance pas et à vrai dire ne compose par un personnage vocal très caractérisé. On aura pourtant tort de se plaindre au regard de ce qu’il nous a donné à entendre, et à voir, car l’acteur n’est pas non plus indifférent.
Ce léger glissement entre le propos du metteur en scène et la conception assez prosaïque de son Tannhäuser profitait au Wolfram de Matthias Goerne : artiste jusqu’à la dernière goutte de son sang, Liedersänger dans l’âme, et amoureux des mots au point que pour la Romance à l’étoile il produisait des creusements, des apartés, tout un luxe d’émotions qui hélas faisaient perdre à la page sa fluidité naturelle : une confession au lieu d’une chanson. Pour le timbre, avec ce vibrato contenu qui est comme la respiration d’une âme, il faut simplement remonter au plus parfait Wolfram du XXe siècle : seul Herbert Janssen peut lui être comparé. Et pour une fois Wolfram prenait toute sa place dans le drame de Tannhäuser, osant se révéler comme ce double de lumière bien plus ambigu qu’il n’y paraît. La confrérie des chevaliers étincelait de talents forts : König, Conrad, Lukas et Smilek, tous tempérés par le Hermann de Franz-Josef Selig, pure poésie, dessinaient autant de vrais caractères.
Mais la soirée était transcendée par deux miracles : la direction d’Ozawa, se gardant de « wagnériser » une partition où il fait meilleur entendre les frémissements d’un opéra qui, quasi autant que Lohengrin, doit à Weber – ce qui n’amoindrissait ni la tension du drame, ni l’amertume du propos si présente dans les accompagnements comme empoisonnés du retour de Rome ; et surtout l’Elisabeth d’Eva- Maria Westbroek, rayonnante et fragile pourtant, mais assez volontaire pour emporter la mise, avec cet aigu infini qui indique que demain elle sera Isolde jusque dans le Liebestod.
Fabuleuse soirée comme l’Opéra de Paris avait oubliée d’en connaître depuis trop longtemps.
Jean-Charles Hoffelé
Richard Wagner, Tannhäuser, Opéra Bastille, le 18 décembre, puis les 27 et 30 décembre (dir. Pierre Vallet)s.
Réservez vos places à l’Opéra Bastille
Photo : Opéra de Paris
Derniers articles
-
02 Mars 2026Vincent BOREL
-
02 Mars 2026Antoine SIBELLE
-
02 Mars 2026Jacqueline THUILLEUX







