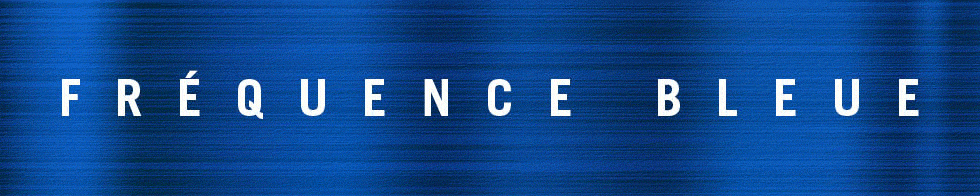Journal
Philippe Jordan dirige les Gurre-Lieder à la Philharmonie – Flamboyante apothéose – Compte-rendu
Philippe Jordan dirige les Gurre-Lieder à la Philharmonie – Flamboyante apothéose – Compte-rendu

Lancé par Stéphane Lissner pour sa première saison officielle à la tête de l’Opéra Bastille, le cycle Schönberg avait été inauguré hors les murs, à la Philharmonie de Paris, en septembre dernier (1) ; sept mois plus tard, il s’y conclut avec l’immense point d’orgue des Gurre-Lieder, toujours sous la direction fervente de Philippe Jordan. On ne pouvait rêver plus belle apothéose que cette fresque gigantesque, symbole du post-romantisme le plus flamboyant, dans la lignée des grandes sagas mahlériennes, Das Klagende Lied ou Huitième Symphonie « des Mille ». Mi cantate profane, mi opéra-oratorio, les Gurre-Lieder, d’après des poèmes (traduits en allemand) de l’écrivain danois Jens Peter Jacobsen, développent un scénario de conte médiéval, d’inspiration onirique et wagnérienne.
Dans la première partie, très Tristan und Isolde, le roi Waldemar et sa maîtresse Tove chantent à tour de rôle leur passion, avant qu’une colombe des bois (Waldtaube) ne relate comment la reine Helwige a fait tuer sa rivale, au château de Gurre. Maudissant Dieu d’avoir laissé accomplir ce forfait (deuxième partie, très brève), Waldemar est condamné à errer éternellement, au cours de chasses nocturnes, avec les spectres de ses vassaux — c’est l’aspect Vaisseau fantôme du troisième volet. Le réveil de la nature dissipe ces sombres fantasmagories, et l’œuvre s’achève par un hymne à la gloire du soleil. Entrepris en 1900, au temps de La Nuit transfigurée, achevés une douzaine d’années plus tard, à l’époque du Pierrot lunaire, les Gurre-Lieder marquent à la fois un point de non-retour dans l’œuvre de Schoenberg, et l’amorce d’un essor nouveau — que laisse pressentir l’intervention finale du récitant, en sprechgesang. Leur succès sans lendemain, lors de la création à Vienne, en 1913, ne consola guère le compositeur, conscient du malentendu sur lequel reposait l’approbation inhabituelle du public.
A voir le plateau de la Philharmonie saturé de pupitres, on comprend pourquoi les Gurre-Lieder, qui mobilisent des effectifs hors-norme, sont rarement donnés aujourd’hui : 4 harpes, 8 flûtes, 7 clarinettes, autant de trompettes et de trombones, 10 cors … Même affluence sur les gradins dominant la scène : le chœur maison au complet est renforcé par les voix masculines du Chœur Philharmonique de Prague.
Quant aux cinq solistes vocaux, ils ont fort à faire, à commencer par le ténor en charge du rôle le plus long et le plus lourd, celui du roi Waldemar, tessiture de heldentenor, entre le Tristan de Wagner et l’Empereur de La Femme sans ombre, de Richard Strauss. Le jeune ténor germanique Andreas Schager triomphe vaillamment de ces embûches, sans sacrifier la tendresse lyrique de son personnage.
Il en a d’autant plus de mérite que sa partenaire, Irène Theorin, l’une des grandes Elektra et Brünnhilde actuelles, lui réserve une répartie économe, étrangement distante et placide, avec un timbre pur mais froid. Comment ne pas regretter la chaleur passionnée dont Jessye Norman enflammait naguère chaque lied de Tove, en particulier le « Nun sag ich dir zum ersten mal », l’une des plus ardentes effusions mélodiques de Schoenberg ?
Grâce à la magnifique mezzo anglaise Sarah Connolly, l’intensité dramatique est à nouveau au rendez-vous pour le récit de la Waldtaube. Formée à l’école du baroque, sachant donner à chaque mot sa charge organique d’affect, son poids charnel d’émotion, elle délivre une leçon de déclamation tragique d’une grandeur bouleversante. D’un maintien hiératique, sans ostentation ni geste factice, d’une voix puissante et sombre, aux inflexions suprêmement expressives, Sarah Connolly aura hissé cette soirée à un sommet des plus impressionnants.
Après l’entracte, où deux nouveaux personnages épisodiques (un paysan et un bouffon) rejoignent le plateau, au tour de l’orchestre et des chœurs de mener l’action, sous la direction enthousiaste et sans cesse en alerte de Philippe Jordan. Comme dans ses Cinq pièces pour orchestre, Schönberg explore en effet les registres instrumentaux extrêmes, s’aventure jusqu’aux limites les plus risquées, notamment les profondeurs abyssales des cuivres graves (trombones et tubas), à la fin de La Chasse sauvage.
Entraînés à la rude école du Ring, les pupitres de l’orchestre de l’Opéra triomphent de ces périls. Dans le mélodrame final, pour tenir la partie de sprechgesang du récitant, souvent confiée à d’anciens chanteurs au métier éprouvé, on attendait la mezzo Brigitte Fassbaender, aujourd’hui retirée de la scène, une ex-Waldtaube sous la direction du regretté Claudio Abbado. Sa défection de dernière minute est compensée par la venue du vétéran Franz Mazura, toujours sur le pont à 92 ans, fameux Docteur Schön de la production en trois actes de la Lulu d’Alban Berg, au Palais Garnier, en … 1979 ! Sa seule présence « historique » a conféré au dernier épisode (chasse sauvage du vent d’été) une émotion supplémentaire.
« Tous les chemins mènent à Rome, sauf la voie du juste milieu » professait un Schönberg ennemi de la tiédeur et de tout compromis. L’hommage que Philippe Jourdan et ses troupes ont rendu tout au long de cette saison à sa musique confirme le bien-fondé de ses choix extrêmes, comme de ses partis pris radicaux.
Dans la première partie, très Tristan und Isolde, le roi Waldemar et sa maîtresse Tove chantent à tour de rôle leur passion, avant qu’une colombe des bois (Waldtaube) ne relate comment la reine Helwige a fait tuer sa rivale, au château de Gurre. Maudissant Dieu d’avoir laissé accomplir ce forfait (deuxième partie, très brève), Waldemar est condamné à errer éternellement, au cours de chasses nocturnes, avec les spectres de ses vassaux — c’est l’aspect Vaisseau fantôme du troisième volet. Le réveil de la nature dissipe ces sombres fantasmagories, et l’œuvre s’achève par un hymne à la gloire du soleil. Entrepris en 1900, au temps de La Nuit transfigurée, achevés une douzaine d’années plus tard, à l’époque du Pierrot lunaire, les Gurre-Lieder marquent à la fois un point de non-retour dans l’œuvre de Schoenberg, et l’amorce d’un essor nouveau — que laisse pressentir l’intervention finale du récitant, en sprechgesang. Leur succès sans lendemain, lors de la création à Vienne, en 1913, ne consola guère le compositeur, conscient du malentendu sur lequel reposait l’approbation inhabituelle du public.
A voir le plateau de la Philharmonie saturé de pupitres, on comprend pourquoi les Gurre-Lieder, qui mobilisent des effectifs hors-norme, sont rarement donnés aujourd’hui : 4 harpes, 8 flûtes, 7 clarinettes, autant de trompettes et de trombones, 10 cors … Même affluence sur les gradins dominant la scène : le chœur maison au complet est renforcé par les voix masculines du Chœur Philharmonique de Prague.
Quant aux cinq solistes vocaux, ils ont fort à faire, à commencer par le ténor en charge du rôle le plus long et le plus lourd, celui du roi Waldemar, tessiture de heldentenor, entre le Tristan de Wagner et l’Empereur de La Femme sans ombre, de Richard Strauss. Le jeune ténor germanique Andreas Schager triomphe vaillamment de ces embûches, sans sacrifier la tendresse lyrique de son personnage.
Il en a d’autant plus de mérite que sa partenaire, Irène Theorin, l’une des grandes Elektra et Brünnhilde actuelles, lui réserve une répartie économe, étrangement distante et placide, avec un timbre pur mais froid. Comment ne pas regretter la chaleur passionnée dont Jessye Norman enflammait naguère chaque lied de Tove, en particulier le « Nun sag ich dir zum ersten mal », l’une des plus ardentes effusions mélodiques de Schoenberg ?
Grâce à la magnifique mezzo anglaise Sarah Connolly, l’intensité dramatique est à nouveau au rendez-vous pour le récit de la Waldtaube. Formée à l’école du baroque, sachant donner à chaque mot sa charge organique d’affect, son poids charnel d’émotion, elle délivre une leçon de déclamation tragique d’une grandeur bouleversante. D’un maintien hiératique, sans ostentation ni geste factice, d’une voix puissante et sombre, aux inflexions suprêmement expressives, Sarah Connolly aura hissé cette soirée à un sommet des plus impressionnants.
Après l’entracte, où deux nouveaux personnages épisodiques (un paysan et un bouffon) rejoignent le plateau, au tour de l’orchestre et des chœurs de mener l’action, sous la direction enthousiaste et sans cesse en alerte de Philippe Jordan. Comme dans ses Cinq pièces pour orchestre, Schönberg explore en effet les registres instrumentaux extrêmes, s’aventure jusqu’aux limites les plus risquées, notamment les profondeurs abyssales des cuivres graves (trombones et tubas), à la fin de La Chasse sauvage.
Entraînés à la rude école du Ring, les pupitres de l’orchestre de l’Opéra triomphent de ces périls. Dans le mélodrame final, pour tenir la partie de sprechgesang du récitant, souvent confiée à d’anciens chanteurs au métier éprouvé, on attendait la mezzo Brigitte Fassbaender, aujourd’hui retirée de la scène, une ex-Waldtaube sous la direction du regretté Claudio Abbado. Sa défection de dernière minute est compensée par la venue du vétéran Franz Mazura, toujours sur le pont à 92 ans, fameux Docteur Schön de la production en trois actes de la Lulu d’Alban Berg, au Palais Garnier, en … 1979 ! Sa seule présence « historique » a conféré au dernier épisode (chasse sauvage du vent d’été) une émotion supplémentaire.
« Tous les chemins mènent à Rome, sauf la voie du juste milieu » professait un Schönberg ennemi de la tiédeur et de tout compromis. L’hommage que Philippe Jourdan et ses troupes ont rendu tout au long de cette saison à sa musique confirme le bien-fondé de ses choix extrêmes, comme de ses partis pris radicaux.
Gilles Macassar

(1) Lire le CR : www.concertclassic.com/article/philippe-jordan-dirige-lorchestre-de-lopera-la-philharmonie-de-paris-fleur-de-timbre-compte
Paris, Philharmonie 1, 19 avril 2016
Photo © Jean-François Leclerq / Opéra national de Paris
Derniers articles
-
16 Juin 2025Michel ROUBINET
-
16 Juin 2025Jean-Guillaume LEBRUN
-
15 Juin 2025Laurent BURY