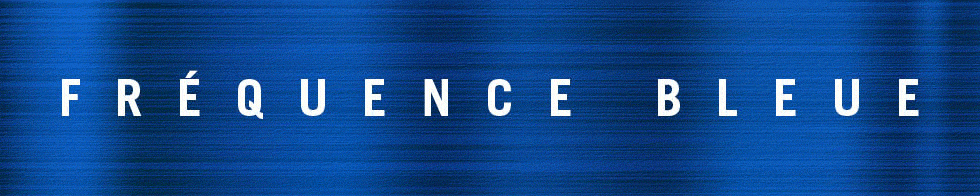Journal
Luciano Pavarotti - La voix balsamique de Modène s’est tue - Hommage Concertclassic

L’une des plus grandes et surtout l’une des plus belles voix du XXe siècle s’est tue à Modène, la ville qui avait vu naître le ténorissimo, alias Luciano Pavarotti, le 12 octobre 1935. A l’instar de sa carrière, l’homme fut totalement paradoxal : une voix d’une incroyable ductilité ornée d’un timbre somptueux et délicat dans un corps de colosse : un ogre qui aurait avalé un rossignol. Tel fut le ténorissimo italianissimo, celui qui incarna durant quatre décennies le bel canto dans toute sa splendeur, son rayonnement et toute l’acception du terme. Comme la Callas ou la Schwarzkopf, Luciano Pavarotti était reconnaissable à la première note : son timbre unique, à la fois corsé et luminescent, constituait la griffe d’un art dont les racines plongeaient au plus profond de la culture et de l’histoire italiennes. Comme le dôme de Milan ou le David de Michel-Ange, cette voix appartenait au patrimoine italien.
Boulanger à Modène, son père avait déjà une solide réputation de ténor. A défaut de naître dans le pétrin, Luciano tombe ainsi dans la marmite lyrique. Pourtant, il commence une carrière d’instituteur, brève, il est vrai, car vite interrompue à la suite d’un concours de chant en Emilie-Romagne. Après un passage dans un conservatoire régional, il parfait sa formation comme doublure de ces grands anciens encore nombreux dans l’Italie d’après guerre. Ce qui explique une longue période de galère : cette voix solaire n’a pas illuminé d’un coup le firmament lyrique d’une Italie, terre des ténors par excellence, sous le charme des Gigli, di Stefano et autre Bergonzi. Ainsi Pavarotti dut-il faire antichambre avant d’être propulsé sur les principales scènes internationales.
C’est à ses débuts tardifs qu’il dut, en partie, sa légendaire longévité vocale qui fit de lui le ténor obligé de la mondialisation lyrique. L’ex-pédago avait aussi une rare intelligence de ses moyens naturels et des limites qu’il ne devait pas franchir afin de durer en préservant le capital de sa voix d’or massif. Jamais, il n’accepta de chanter en une autre langue que l’italien. Aussi son répertoire va-t-il de Mozart à Puccini en passant par Verdi et les grands belcantistes romantiques vers lesquels le couple Joan Sutherland-Richard Bonynge sut l’entraîner. Il se fit orfèvre de sa voix pour ces compositeurs du début du XIXe siècle. Mais cet artiste délicat habitait un corps d’ogre affamé pour qui le bien manger dictait des paragraphes entiers de ses contrats : à l’autre bout de la terre, il voulait manger italien.
Le PDG de sa maison de disques, un certain Jean-Marie Messier, avait organisé dans un palais de Modène un gala suivi d’un dîner pour ses 40 ans de carrière. Je garde l’image du ténorissimo, Panama vissé sur la tête, dévorant un plat de pâtes au côté de sa fille préférée, ne daignant gratifier son hôte placé au bas bout de la table du moindre regard de toute la soirée. Muflerie ? Non, il était chez lui dans sa ville et ne voulait pas qu’un quidam vint l’importuner. L’argent ? Certes, il l’a aimé pour ce qu’il lui permettait d’abord d’offrir à ses parents et à sa nombreuse famille. Et pour ces chevaux qu’il a tant aimés. Une photo extraordinaire montre Pavarotti chevauchant devant le Met de New York sous une pluie de confettis. Chanter, manger, aller à cheval : un seul et même plaisir à croquer la vie pour notre ogre du contre ut.
Comme son père poussant la note pour le plaisir de ses amis, Luciano Pavarotti n’a jamais utilisé sa voix que pour donner le plus grand bonheur possible à ses auditeurs. Et en avançant en âge, il n’a eu de cesse d’en augmenter le nombre en quittant le cercle étroit des salles d’opéra pour les temples du sport, de Bercy au Madison Square Garden où il n’hésitait pas à se produire seul en récital, son éternel mouchoir blanc à la main. Pour gagner un autre public que celui des aficionados du bel canto, il s’est joint souvent à des vedettes de variétés et de rock, de Céline Dion à U 2 lors de concerts de charité. C’est sans conteste ce qui explique la fabuleuse notoriété de cet artiste hors du commun dans le monde entier et hors des frontières du seul monde lyrique.
C’est la même démarche qui le conduisit à rassembler les « Trois ténors » avec Placido Domingo et José Carreras. Les jaloux ont dénoncé une affaire de gros sous et le fisc allemand tenta même de récupérer une partie du pactole. On est moins regardant sur les bonnes affaires des milieux sportifs ou des groupes de musique moins classique ! Ce qui compte, c’est que Pavarotti n’a jamais trompé sur la marchandise : quel que soit son partenaire, il a fait du Pavarotti, avec la même exigence que sur la scène de Covent Garden ou du Palais Garnier : il ne s’est pas abaissé, il a élevé au contraire ses auditeurs et avec lui, c’est l’opéra comme genre prétendument élitiste, qui est devenu populaire.
Voici un autre paradoxe de Pavarotti, parangon du ténor italien le plus traditionnel de Caruso à Gigli chantant l’opéra et la chanson napolitaine, mais oeuvrant à la démocratisation de son art à travers le monde entier et à travers toutes les couches sociales. Comme l’atteste son amour proclamé pour ses parents et l’attention qu’il leur a portée jusqu’à leur mort, il n’a jamais renié ses origines modestes. Là réside sans doute la vérité profonde de son art du chant où le naturel est toujours préféré à l’artifice. De ses années de galère, il n’avait gardé aucune amertume, mais au contraire le souci d’aider ses jeunes collègues. Et d’abord par le concours qui porte son nom et dont l’un des plus brillants lauréats s’appelle Roberto Alagna auquel il ouvrit d’un coup les portes de la Scala de Milan.
Il a été le témoin, j’allais dire immobile et incontournable, de l’irruption des théâtreux dans la mise en scène lyrique. Il savait d’intuition que l’essentiel passe par le geste musical, vocal : avec Pavarotti, prima la musica et personne n’aurait osé le contredire, car il avait le public avec lui. Sa dernière apparition à l’Opéra Bastille remonte à 1992 dans Un Bal masqué de Verdi pour lequel Nicolas Joël, directeur désigné de l’Opéra de Paris pour 2009, eut la sagesse de régler sa mise en scène autour de l’énorme silhouette de Pavarotti auquel le mouvement des autres imprimait une sorte de mobilité. Il ne manquait pas d’humour et encore moins d’endurance, comme ce soir de Tosca au Palais Garnier où un frêle tabouret céda – heureusement en douceur ! – sous son poids, le précipitant un peu vite dans les bras de Kiri Te Kanawa : il en fallait plus pour rompre la ligne de chant de Puccini qui sortit indemne de l’incident.
Vers la même époque, au début des années 80, Pavarotti avait chanté « Idoménée » de Mozart au Festival de Salzbourg affublé d’une incroyable jupette de légionnaire romain. Soudain avant d’attaquer le grand air, il se retourne vers une colonne et s’y appuie la tête sur l’avant bras. Coup de fatigue ? Je me renseigne à l’issue de la représentation : rire de mon interlocuteur qui m’explique que Pavarotti avait refusé de se fatiguer à mémoriser le texte et l’avait … écrit comme une anti-sèche sur le fût de la colonne. Tel était ce géant débonnaire du contre-ut, simple et réaliste, focalisé sur l’essentiel, la beauté de la musique. Et d’une voix qui avait des saveurs balsamiques, à la fois corsées et sucrées, de… vinaigre de Modène.
Jacques Doucelin
Photo : DR
Derniers articles
-
17 Juin 2025Alain COCHARD
-
16 Juin 2025Michel ROUBINET
-
16 Juin 2025Jean-Guillaume LEBRUN