Journal
Les Archives du Siècle Romantique (51) – Hector Berlioz, « Institut. Concours de musique et voyage d’Italie du lauréat. », Gazette musicale de Paris, 2 février 1834 [extrait]

Un bon siècle de vie musicale exploré au fil d’un peu plus de 600 pages : l’épaisseur du volume pourrait de prime abord rebuter certains ; impression immédiatement contrebalancée par le titre, plus qu’engageant : « Bons Baisers de Rome ». De fait, cette étude particulièrement fouillée offre une belle illustration de l’esprit de la collection Actes Sud/Palazzetto Bru Zane. En mêlant l’histoire, l’anecdote bien choisie –si précieuse pour la compréhension intime des choses – et la musicologie, ces « Bons Baisers » constituent une formidable mine d’informations, pour le simple mélomane averti comme pour des lecteurs aux préoccupations plus pointues. Vivante, pleine de détails, d’extraits de lettres, cette approche transversale du Prix de Rome apporte une contribution décisive à la connaissance de ce que l’auteur désigne à juste titre comme « un continent musical englouti ». Un sujet tout trouvé pour le directeur scientifique du découvreur Palazzetto Bru Zane !
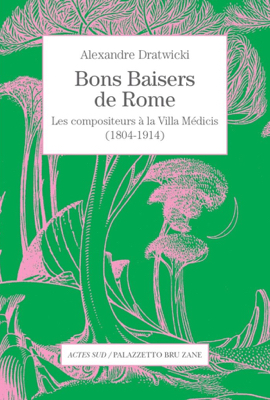
Le voyage jusqu’à Rome nous est décrit de savoureuse manière avec, avant l’arrivée du chemin de fer – conquête de la modernité que d’aucuns ne manquèrent pas de copieusement maudire ! –, le voiturin à partir de Marseille. Ce pittoresque mode de transport, vanté par Gounod, laissait tout le temps de « jouir en détail » du paysage et de se préparer « au climat et aux beautés pittoresques de l’Italie » et à la découverte de Rome qui, écrira plus tard Théodore Dubois, « apparaissait aux jeunes pensionnaires comme un élan longuement désiré.»
Découverte de la Villa Médicis... et de l’autre face de la médaille ! : des chambre « petites, incommodes et surtout excessivement mal meublées » pestait Berlioz. Et parfois très mal orientée, pouvait regretter Gabriel Pierné a propos de la sienne, « au nord et où le soleil ne pénètre jamais » ! D’autres furent heureusement bien mieux lotis et gardèrent un souvenir ébloui de leur séjour romain, Bizet, Massenet ou Charpentier par exemple.
Ingres, un directeur « fou de musique »
« Bons baisers de Rome » réserve un important chapitre à la vie quotidienne des pensionnaires. Une existence conditionnée par la personnalité et les décisions des seize directeurs (2) qui se succédèrent à la tête de la Villa Médicis durant la période abordée. La présence entre 1834 et 1841 d’Ingres, peintre « fou de musique » selon Gounod, fut louée par ce dernier et par Ambroise Thomas, entre autres. Mais on vit des directorats plus chahutés, tel celui de Jules Lenepveu, qui provoqua un mouvement de rébellion en s’installant un potager dans le Bosco (lieu de verdure et domaine réservé des pensionnaires qui aimaient à venir s’y détendre), ou celui (double mandat en fait ; 1867-1872 et 1885-1891), d’Ernest Hébert, dont la seconde partie fut entachée par des affaires financières. Des directeurs qui eurent des relations parfois compliquées avec Paris et l’Académie des beaux-arts, tutelle de la Villa.

La vie quotidienne des pensionnaires
Rythme des journées, horaires des repas, menus, personnel de service, sexualité (cf. le sous-chapitre « le pensionnaire et la vertu »), maladies, etc. : on a vraiment l’impression de partager le quotidien des hôtes de la Villa au fil d’un livre qui traite aussi du contact avec la ville, de la découverte de sa vie musicale (objet de jugements souvent très rudes, sur la médiocrité des exécutions en particulier), des salons romains où les pensionnaires pouvaient nouer de charmantes et/ou utiles relations, sans oublier les visites de diverses personnalités à la Villa – elle vit passer Adolphe Nourrit, Johann Baptist Cramer, Fanny et Felix Mendelssohn, Franz Liszt, Pauline Viardot, Sarah Bernardt et bien d’autres ...
L’avide découverte de Wagner !
Point essentiel abordé par A. Dratwicki, le rôle de la bibliothèque de la Villa dans la vie des pensionnaires et leur développement esthétique offre matière à des pages très instructives (appuyées sur les registres d’emprunt qui ont pu être conservés). Dégarnis à l’époque de Berlioz, qui ne manqua pas de s’en plaindre, les rayonnages vont peu à peu s’enrichir au fil des ans, d’ouvrages littéraires évidemment, mais surtout, pour le domaine qui nous intéresse, de nombreuses partitions dont la découverte aura parfois des conséquences directes sur l’activité créatrice des pensionnaires. Ainsi Bizet composa-t-il son Te Deum très peu de temps après s’être plongé dans... deux Te Deum de Le Sueur. Les compositions de Lully, Revel, Rameau ou Gluck attirèrent beaucoup la curiosité aussi, tout comme, à partir de la fin du siècle, celles de Richard Wagner, objet d’une « étude avide » par les pensionnaires.
A la découverte des toutes ces pages, il faut ajouter – et l’ouvrage ne manque pas de s’y attarder – celle de musiques anciennes, hors de la Villa, grâce au gros travail de copie effectué par certains pensionnaires de manuscrits conservés dans divers lieux de la Ville Eternelle – la bibliothèque de la Minerve, celle de Saint-Louis des Français, etc. – ou d’autres cités italiennes (Venise, Assise, etc.).
Autant de trouvailles dont chacun fit son miel à sa façon et dont les influences se lisent sur les « envois de Rome ». A. Dratwicki les observe du point de vue réglementaire, comme de celui des genres abordés (permanence de la musique vocale, avec une place importante du répertoire sacré, et montée en puissance de la musique instrumentale) ou de l’évolution du langage - d’un style néo-palestrinien à la tellurique déflagration du génial Psaume XLVII de Florent Schmitt.
De l'amour à la haine
Enfin, l'ouvrage envisage aussi avec attention le relation, très variable selon les personnalités, avec l’Italie et la Villa, de l’amour jusqu’à la haine, avant de conclure sur le retour à Paris et la réintégration, pas toujours commode, dans la vie musicale française.
La sortie de « Bons Baisers de Rome » offre une excellente occasion de laisser la parole à un célèbre – et turbulent ! – pensionnaire de la Villa, Hector Berlioz, qui, dans la Gazette musicale de Paris du 2 février 1834, narrait de son inimitable plume le voyage jusqu’à Rome et livrait des sentiments fort contrastés à propos de son expérience italienne ; enthousiaste envers l'enivrante poésie des paysages et des monuments, plus que critique s’agissant de la vie musicale de la péninsule et d'une Villa Médicis que Debussy, autre pensionnaire atypique, décrira par la suite comme une « usine à Spleen ».
Alain Cochard
*
Hector Berlioz, « Institut. Concours de musique et voyage d’Italie du lauréat. », Gazette musicale de Paris, 2 février 1834 [extrait]
Article complet : www.bruzanemediabase.com/fre/Documents/Articles-de-presse/Gazette-musicale-de-Paris-2-fevrier-1834-Institut.-Concours-de-musique-et-voyage-d-Italie-du-laureat
[…] Toutefois, quelque oiseau de nuit que je fusse, il n’en fallut pas moins partir pour l’Italie ; cette terre chérie du soleil et des poètes, qui reçoit aussi malheureusement les fades baisers du sirocco et des marchands de cavatines. En consultant mes souvenirs sur ce beau voyage, je trouve une ligne de démarcation bien distincte tracée entre mes impressions musicales et le riche trésor de poésie que l’art ancien et moderne, la nature sauvage et la nature civilisée étalaient à l’envi sous mes pas. Ici une mystification ; là un enchantement continuel. D’un côté platitudes stupides, de l’autre hymne sublime d’amour et d’enthousiasme s’élevant de la terre aux cieux, et répété plus beau par les cieux à la terre. Examinons les deux faces inégales de cette médaille.
En débarquant à Livourne, je trouvai une petite horreur de musique, misérable, pâle, exténuée, semblable à ces maigres danseuses qui, vêtues d’une veste rouge brodée de galons de cuivre et d’un pantalon blanc taché de boue, étalent pour quelques sous leurs lascifs mouvemens aux yeux des matelots du port. J’avais, il est vrai, entendu à Marseille, comme adieu de la France, le Tableau parlant de Grétry ; et, franchement, la muse italienne, toute chargée qu’elle fût de sales oripeaux, me déplut infiniment moins que la vieille muse provinciale française, dont le nez, armé de lunettes, sentait le tabac de dix pas. À Florence, la première représentation d’un ouvrage nouveau de Paccini me fit voir comment on pouvait faire un opéra avec une phrase, encadrée dans un tissu de réminiscences. En musique sacrée, je n’eus à admirer que la sensibilité profonde, le génie homérique, l’imagination toute shakespearienne d’un organiste, qui, aux funérailles du jeune Napoléon Bonaparte, fils de la reine Hortense, mort à vingt ans, exprimait sa religieuse douleur, sur le colossal instrument en sifflotant dans le haut du clavier tarentelles, saltarelles, bourrées, et autres petits airs gais. J’appris à cette époque par les journaux français la mise en scène de l’Euryanthe de Weber. On l’exécutait à la fois à l’opéra et au théâtre allemand de Paris.
À Gênes, j’assistai à une représentation de l’Agnese de Paër ; madame Ferlotti daignait chanter le rôle d’Agnese, mais fort doucement, en cantatrice qui sait à un franc près ce que son gosier lui rapporte par année. Aussi son désespoir ne m’effraya-t-il guère plus que la folie de fort sage père.
Cependant de quoi aurais-je pu me plaindre ? J’étais à Gênes, patrie de Paganini, et j’avais l’agrément de voir par les feuilletons des Débats que cet étonnant violoniste donnait des vertiges à toutes les organisations musicales de Paris.
À Rome, j’ai admiré une multitude de choses. Zadig et Astartea d’abord, de M. Vaccaï, partition dans laquelle il n’y a d’extraordinaire que deux grosses-caisses et un tambour de régiment. À l’orchestre du théâtre d’Apollo, où j’entendis cet intéressant ouvrage, ainsi qu’à celui du théâtre Valle, il n’y a qu’un seul violoncelle. Jugez de l’effet que peut produire la partie de basse dans des salles immenses comme celles que je viens de nommer ! À la procession de la Fête-Dieu (Corpus Domini) deux musiques militaires distantes de vingt pas l’une de l’autre, et jouant toutes les deux à la fois dans deux tons différens, accompagnaient l’hostie sainte et les images de la Vierge de leur impie et brutale cacophonie. Un aveugle aurait pu croire au renouvellement des Bacchanales. En entrant dans Saint-Pierre, dans cet immense et sublime temple dépositaire des pensées intimes des plus grands génies de l’Italie, je ne pus m’empêcher de frissonner en pensant à la musique qu’on devait y entendre. Grand Dieu ! me disais-je, si l’art musical s’y élève à la hauteur des autres arts, je vais être écrasé d’admiration. L’exécution de ces merveilles doit être colossale. Le chœur des quatre mille Lévites du temple de Salomon n’est pas de trop pour ces voûtes michelangesques ; il y faut un orgue animé par les vents, et le temps pour chef d’orchestre… J’entendis plus tard le fameux Miserere de la semaine-sainte. Hélas ! je ne veux dire ce que j’en pense... Pour me consoler de la mystification (que je ne puis m’empêcher du reste de trouver excellente), je lus le lendemain dans l’Avenir une analyse de la symphonie avec chœurs de Beethoven, qu’on venait de monter magnifiquement au Conservatoire de Paris.
À Naples, je suis allé un soir me rafraîchir dans la vaste salle de Saint-Charles ; il n’y avait guère plus de trente personnes au parterre. Ou jouait un opéra de Mercadante, Zaïra, qui ne m’a rien fait du tout. L’exécution en était fort convenable, et infiniment supérieure sous tous les rapports, à ce que j’avais entendu jusqu’alors en Italie. Une glace que je pris en sortant, me fit pourtant beaucoup plus de plaisir que cette musique. La compensation ordinaire m’attendait. Je vis cette semaine, dans les feuilles françaises, que Meyerbeer venait de donner, avec un immense succès, son Robert-le-Diable, à l’Opéra de Paris. Pendant mon séjour à Rome, j’eus l’occasion de faire la connaissance et d’apprécier l’admirable talent de Félix Mendelssohn. Impatienté de tout ce qu’il entendait, il voulut un jour se désinfecter avec le grand septuor de Hummel. Vains efforts ! peine perdue ! Après bien des recherches minutieuses et d’inutiles essais, il fallut reconnaître que la ville de Rome n’avait pas six artistes capables d’accompagner décemment le pianiste prussien. Ils ont du reste une naïveté charmante dans leur orgueil national. Ils sont persuadés que la musique n’existe pas hors des frontières d’Italie. Je demandais au marchand de musique de la place d’Espagne, un morceau de Weber : « Cosa e questo Vebere ? me répondit-il, Francese, Tedesco ? caro moi ! quello non e conosciuto. » Leurs affiches de théâtre sont impayables. J’ai lu imprimée l’annonce suivante : « Il magico quartetto del tanto applaudito opera di Blanca e Faliero, musica del celeberrimo maestro, illustrissimo cavaliere Rossini. » Ouf.
Tout cela je l’ai vu, et je ne parle que d’après des impressions directement personnelles. Que le hasard m’ait mal servi, cela se peut, je souhaite plus de bonheur à ceux qui viendront après moi. En tous cas, ce n’est que sous ce rapport seulement, que je trouve le voyage d’Italie ridicule pour un musicien. Sous tout autre, son influence doit être grande sur les imaginations ardentes et poétiques. C’est en lettres de feu que je vois encore tracés dans ma mémoire ces mots, premiers anneaux d’une chaîne de beaux souvenirs : Plaine de Rome, aride, déserte, sombre. Après une fatigante journée de chasse, assis sur les ruines ruinées d’un temple antique, au sommet d’un de ces tristes monticules dont la plaine est couverte, et seul, j’ai écouté avec un profond recueillement le grave chant des cloches de Saint- Pierre, dont la croix d’or étincelait à l’horizon. Le jour de Pâques, mêlé à tout ce peuple bigarré, qui s’agite et bruit en vingt langues différentes, j’ai reçu la bénédiction que tous les ans à cette époque le pape répand sur la ville et le monde du haut du balcon pontifical, entouré des pompes du Vatican, salué par les cris de joie des sauvages montagnards des Abbruzzes, dont l’enthousiasme éclate rival des trompettes et des canons du fort Saint-Ange. — Perdu à minuit dans le cratère du Vésuve un vague sentiment d’effroi a fait battre mon cœur, aux sourds râlemens, aux cris de fureur, qui s’échappaient de sa bouche. Des tourbillons de flammes et des roches fondantes dirigées contre le ciel comme de brûlans blasphèmes, retombaient, roulaient sur les flancs de la montagne, et s’arrêtaient en fin pour former un ardent collier sur la vaste poitrine du volcan. Sur ma tête le ciel étoile ; à mes pieds la mer de Naples illuminée de mille feux de pêcheurs ; des torches errantes dans les hauteurs ; des voix au fond des prépices ; des cris au loin ; et tout près, le pétillement de la lave, des bouffées de gaz, s’échappant avec violence de ces soupiraux de l’enfer… Je me crus au sabbat, sur le Blocksberg. — J’ai parcouru tristement le squelette de cette désolée Pompeia, et spectateur unique j’ai attendu sur les gradins de l’amphithéâtre, la tragédie d’Euripide ou de Sophocle, pour laquelle la scène paraît encore préparée. — Couché au soleil sur la grève, comme un boa qui digère, j’ai admiré à midi la mer faisant la sieste, et les plis moelleux de sa robe azurée, et le bruit flatteur avec lequel elle l’agile doucement. — Puis le Pausilippe, le soleil couchant, le cap Misène, la baie de Baïa, les souvenirs virgiliens ; Turnus, Pallas, le bon Évandre, Énée, et les bataillons de héros aux panaches flottans, dont le génie du poète a peuplé ce rivage. — Lodi enfin, avec son pont célèbre, où j’ai passé deux heures, plongé dans une triste et profonde rêverie ; songeant aux jours qui ne sont plus, à cette grande gloire éteinte, à cette perfide destinée qui vint prendre par la main,
Le tribun, jeune et fier, amaigri par des veilles
Que des rêves d’espoir emplissaient de nouvelles,
pour l’amener... mourir de l’œil à Sainte-Hélène. Oh ! si tel est le point de vue sous lequel on envisage le voyage d’Italie pour les musiciens, oui, certes, répondrai-je, tout chante dans ce beau pays : les cieux, la mer, la terre et les montagnes. Oui, oui, c’est un immense et sublime concert, c’est la plus haute, la plus intime poésie musicale ! Mais il serait mieux, en ce cas, d’accorder aux lauréats de l’Institut, la liberté pleine et entière d’errer suivant leur caprice, soit aux cimes décharnées de l’Apennin, soit aux riches plaines milanaises, soit aux îles napolitaines et siciliennes, de parcourir cette terre féconde, mus seulement par leurs sympathies individuelles, depuis les Alpes jusqu’à l’Etna, depuis Milan jusqu’à Messine ; au lieu de les envoyer spécialement à Rome, où ils perdent un temps si précieux avec le jeu du disque, l’orvieto, les cailles et les modèles. Au lieu de passer les trois quarts de leur temps dans les États du pape, et d’employer seulement les six derniers mois de leur séjour en Italie à explorer, tant bien que mal, les autres parties de ce magnifique jardin, il serait plus raisonnable peut-être qu’ils fissent le contraire. Mais l’Accademia di francia de Rome, est fille de l’Académie française de Paris ; la routine, d’ailleurs, a de longs bras, et peut enlacer même au-delà des monts les artistes assez jeunes pour avoir encore l’illusoire espérance d’échapper à ses atteintes. […]
Hector Berlioz
(1) Alexandre Dratwicki : « Bons Baisers de Rome », les compositeurs à la Villa Médicis (1804-1914) – Actes Sud / Palazzetto Bru Zane (633 p. / 45 €)
(2) On sait que Camille Saint-Saëns fut pressenti en 1904 pour prendre la direction de la Villa Médicis. Attaché à sa liberté, le maître déclina la proposition et ce fut le peintre Carolus-Duran (1837-1917) qui occupa le poste de 1905 à 1913.
Photo © © Académie de France à Rome - Villa Médicis
Derniers articles
-
15 Mai 2024Laurent BURY
-
14 Mai 2024Alain COCHARD
-
14 Mai 2024Alain COCHARD







