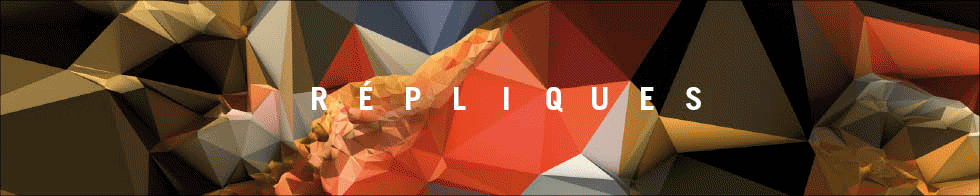Journal
Paris - Compte-rendu : Pazzia e morte, Era la notte par Anna Caterina Antonacci
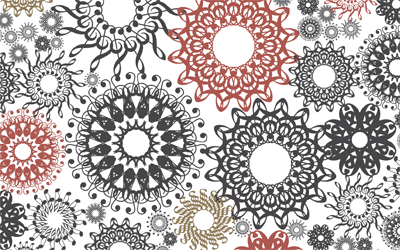
Le spectacle, en une saison est devenu un classique. Il faut dire que Juliette Deschamps a tout fait pour. Son travail minimaliste, concentré sur la seule direction d’acteur, porté par l’eau et le feu, entouré de lumières mystérieuses qui font cette nuit de cierges, cet autel votif si implacable – seule l’averse finale en aura raison –, atteint une sorte d’absolu. Ces scènes lyriques interfoliés avec des pièces instrumentales réflexives de Biaggio Marini forment non pas un concert, mais une lecture. Et l’on se prend à repenser à la fulgurante lecture du Banquet de Platon imaginée par Juliette Deschamps avec une pléiade d’acteurs dominée par Michel Piccoli et donnée à l’Auditorium du Louvre voici peu. Car nous ne sommes pas au théâtre, mais devant un soliloque en quatre parties. Le texte n’est pas – ou si peu –action, mais incarnation.
Rien de ce petit miracle poétique n’aurait été possible sans Anna Caterina Antonacci, une tragédienne, qui sait ce que récit veut dire, et accentue, infléchit, dit en fait plutôt qu’elle ne chante, respectant en cela les intentions de Giramo lorsqu’il écrit son clouant Lamento della pazza, où la scansion, le cri, le détaché des mots se substituent à la musique. Précis quasi clinique de la folie dite – on croirait entendre Arthaud par moment – où la voix ne doit pas être belle mais vraie. Cassandre chez Berlioz, au fond, ne procède pas autrement, pétri de déclamation gluckiste, et l’on sait quelle Cassandre est Antonacci. La plainte, elle serait plus naturellement parente du chant. Mais Juliette Deschamps ne l’entend pas ainsi. Et Ariane sans son Thésée, dit avant de chanter, d’autant qu’Antonacci donne à chaque syllabe un élan meurtrier.
Monteverdi ignorait ce legato engluant l’émotion dont on a trop recouvert son Lamento d’Arianna, Antonacci lui rend la dureté du verbe qu’il reconnaissait pour vertu première non seulement dans ses madrigaux, dans sa Selva, mais aussi dans ses opéras. Cependant lorsque le chant éclate littéralement, lorsque la lyrique des notes oblitère le texte comme dans le sublime Lagrime mie de Strozzi, alors Antonacci laisse entendre à nu ces terribles incertitudes vocales qui saisissent son instrument au dépourvu. La justesse disparaît, le timbre s’élime, ne reste plus que le garde-fou des mots, parapet dangereux, trop abrupt.
Pour le Combatimento di Tancredi e Clorinda, qu’on ne devrait pas donner autrement qu’à voce sola, si l’on veut qu’il soit d’une seule coulée à la fois récit et action, description et épreuve, fiction et réalité, le mot à nouveau règne, d’autant que Monteverdi n’y met que la musique du verbe, jusque dans les emballements furieux du combat, où les consonnes sont des dagues, et les voyelles du sang. Terrible confusion et ironie absolue de l’existence, petit Roméo et Juliette de poche que cet épisode de la Jérusalem délivrée où l’on entend exactement le fracas des batailles d’Uccello.
Antonacci, avec son gran ferro, cette armure à terre déjà abandonné par le corps qui la portait, est perdue au sens de l’oubli total de soi dans ce qui reste l’une des musiques de mort les plus explicatives, les plus âprement réelles jamais composées. Monteverdi y est encore aujourd’hui probablement en avance de quelques siècles.
L’averse pouvait venir, le public applaudir sans attendre le murmure de la Sinfonia, postlude en soupir. Ce qui s’était consommé sous ses yeux ce soir-là, et dans son oreille, c’était rien moins que l’âge d’or du canto italiano par sa vraie prêtresse.
Jean-Charles Hoffelé
Era la notte, Théâtre des Champs Elysées, le 5 mai 2007
Vous souhaitez réagir à cet article ?
Programme détaillé du Théâtre des Champs-Elysées
Les autres comptes rendus de Jean-Charles Hoffelé
Photo : DR
Derniers articles
-
28 Mai 2024Alain COCHARD
-
28 Mai 2024Laurent BURY
-
27 Mai 2024Alain COCHARD