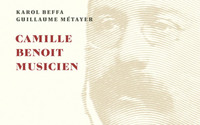Journal
Paris - Compte-rendu - Après Tristan, Salonen au TCE
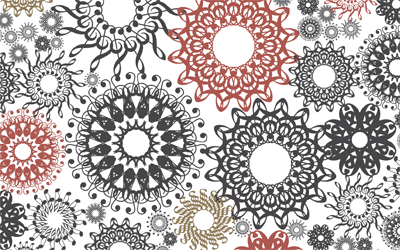
Le chromatisme, vous connaissez ? Il autorise les pires dévoiements, revendique une sexualité foisonnante, encourage la mort, produit le suicide. Schoenberg, qui se voulait prophète des temps modernes était dans sa jeunesse intoxiqué par le chromatisme. Il fit une œuvre pour lui tordre le coup, La Nuit transfigurée, mais chemin faisant c’est l’œuvre qui se retrouva noyée dans ce foutu chromatisme. De cette victoire de la musique sur le compositeur les interprètes prennent en général acte, et La Nuit transfigurée, poème de Dehmel ou pas à l’appui, devient une immense déploration sentimentale.
Salonen lui ne s’avoue pas vaincu. Comme il faisait dans la fosse de la Bastille avec Tristan, il s’immerge dans le texte, s’introduit dans les arcanes de la partition, traque tous les points de résistance dont le compositeur a jalonné son œuvre : au final sa Nuit transfigurée est bien une musique de l’avenir, au langage fluide et déconcertant, où les suspensions tonales éclatent.
Le chef introduit une distance salvatrice qui permet à l’objet de prendre la lumière, et à la sentimentalité de disparaître pour laisser s’exalter le sentiment. Car la Nuit transfigurée n’est pas un poème symphonique, mais un opéra sans voix, dont le lyrisme est tout entier dans la forêt des cordes, musique sans texte mais où les mots se bousculent pourtant. Et il faut faire entendre tout cela, cette grammaire précise, novatrice, fulgurante, qui se dissimule au cœur de ce bon vieux chromatisme.
Une gageure que Salonen produit avec un luxe de couleurs, de phrasés, de variations de tempos (toujours notées précisément par le compositeur, rarement respectées par les interprètes), et surtout un geste incroyablement précis dans l’expression comme dans l’esthétisme. La couleur change dans une mesure, les mètres si fluctuant de Schoenberg ne sont plus segmentés mais respirent dans leurs fractions pour dessiner des lignes qui n’en finissent pas, l’œuvre retrouve, loin de tout romantisme, son ton de paraphrase dramatique.
Beaucoup ont détesté, glacé par ce qu’ils entendaient comme une démonstration, alors que justement ce feu glacé nous a étreint comme jamais ne l’a fait cette œuvre au concert.
Entracte, puis la Symphonie Lyrique de Zemlinsky. Chef d’œuvre. Contrairement à ce que laissait entendre le compositeur à son éditeur – avertissement à visée commerciale – la Symphonie Lyrique n’est pas déduite du Chant de la terre, ni de forme, ni de propos, mais répond en fait à la première partie des Gurrelieder, et s’inscrit elle aussi dans une filiation tristanesque.
Le chromatisme s’y est dissous dans des harmonies plus neuves, l’immense orchestre, délicat à posséder dans son complexe foisonnement, n’appartient dans son effectif pléthorique qu’à Zemlinsky lui même. C’est de fait l’une de ses phalanges les plus étendues, que l’acoustique un peu courte du Théâtre des Champs-Elysées ne peut restituer dans sa verticalité touffue comme dans sa dynamique vertigineuse.
Pour en posséder la langue, il faut que l’orchestre l’ait à son répertoire. Salonen a invité l’œuvre dans celui du Philharmonia, qui n’en possède pas encore tous les réflexes de lecture et les balances délicates que seule la fréquentation produira. A Vienne, à Berlin, à Genève, ou Armin Jordan en fut un défenseur inspiré, à l’Orchestre de Paris où Eschenbach a produit un travail exemplaire, l’œuvre est pour ainsi dire entrée dans le grain des instruments.
Mais les tempos sont les bons, les caractères admirablement dessinés, la balance n’insistant pas trop sur les éléments orientaux qui sont plus dans l’esprit de Zemlinsky une signalétique, une couleur plutôt qu’une atmosphère. Admirable Solveig Kringelborn, qui joue un personnage, probablement la Tove des Gurrelieder justement, alors que son amant colosse, Juha Uusitalo, se cantonne à un récital de mélodie, le nez dans la partition, mais chantant avec beaucoup d’art bien que les couleurs de sa voix, graves clairs, aigus sombres et un peu tassés, soient comme ternies par un allemand qui lui reste en bouche.
Broutilles, radotage de critique, l’œuvre était là entière, incarnée, le voyage chavirant, et l’on sortait du Théâtre des Champs-Elysées léger, heureux enfin d’un grand concert.
Jean-Charles Hoffelé
Paris, Théâtre des Champs-Elysées, le 4 mars 2009
> Programme détaillé du Théâtre des Champs-Elysées
> Lire les articles de Jean-Charles Hoffelé
Photo : DR
Derniers articles
-
23 Avril 2024Alain COCHARD
-
23 Avril 2024Jacqueline THUILLEUX
-
22 Avril 2024Jacqueline THUILLEUX