Journal
Compte-rendu - Le Château des Carpathes de Philippe Hersant - Retour d’un chef-d’œuvre
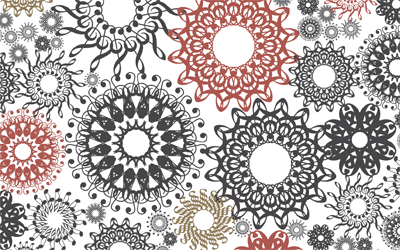
Quelques semaines après avoir dirigé l’opéra de Philippe Hersant, Le Château des Carpathes, à Rennes et Quimper, Laurent Petitgirard n’a pu trouver à Paris de scène pour accueillir une représentation de l’œuvre, créée en 1992 lors du Festival de Radio France et Montpellier.
Peut-être finalement est-ce un mal pour un bien car Le Château des Carpathes est de ces œuvres qui n’ont nul besoin de mise en scène pour être convaincantes. Une légère mise en espace (les chanteurs prenant place en différents points de la scène ou sur le balcon d’arrière-scène), des surtitres qui incluent les didascalies et quelques simples jeux de lumière suffisent à plonger le spectateur dans le drame, d’autant que – trouvaille habilement exploitée par le compositeur – une partie de l’action (la progression de Franz dans le château) est narrée, commentée en direct par un serviteur (le sobre Bernard Bloch) du maître des lieux.
Le livret, adaptation d’un texte de Jules Verne, est un modèle du genre. Le librettiste, Jorge Silva-Mela, est un homme de lettres, de théâtre et de cinéma de premier plan au Portugal. Son texte est un mélange toujours équilibré de simplicité et d’images immédiatement évocatrices, avec juste ce qu’il faut d’insistance pour que la musique puisse s’en emparer et bâtir son espace dramatique. C’est justement ce que Philippe Hersant fait à merveille. La forme de l’œuvre, en un prologue et deux scènes enchaînées, favorise une construction symphonique d’envergure émaillée de quelques impressionnants gestes dramatiques, comme les interludes confiés aux timbales ou les monologues du violoncelle solo.
Dans l’atmosphère gothique du conte de Jules Verne, peu de personnages ont leur place. La Stilla, tout d’abord, la cantatrice que l’on entend vocaliser en coulisse avant de jouer son dernier rôle, une longue lamentation, sur la scène du théâtre San Carlo, puis de le répéter ad libitum une fois enfermée dans l’illusion, ressuscitée mais sans chair par l’invention du Baron de Gorz – Jules Verne ayant ainsi pensé, en 1892, une sorte de cinéma tridimensionnel. La soprano Karen Wierzba fait ici sensation : elle recrée l’émotion des airs monteverdiens dans le prologue et campe à merveille une Stilla éthérée, désincarnée dans la scène du château. L’énergie que déploie le ténor Marc Haffner dans le rôle du comte de Franz, figure romantique de l’amant voyageur à la recherche de sa bien-aimée, anime son personnage d’une dimension dramatique qui, là encore, ne nécessite ni accessoire ni mise en scène.
Marcel Vanaud, qui avait créé en 1992 le rôle du Baron, hôte du château et ravisseur de la voix et de l’image de Stilla, a toute la véhémence, la folie même de son personnage – qui culmine dans le trio final, face à la fougue désespérée de Franz et où se fond la beauté irréelle du chant de la cantatrice défunte. Même les notes que le baryton doit pousser quelque peu pour surmonter le tumulte de l’orchestre participent à la construction du rôle. Dans le rôle à la fois crucial et ingrat de l’aubergiste à qui Franz se confie en arrivant aux abords du château, la mezzo Sophie Pondjiclis s’en sort bien, lui donnant par des éclats détimbrés un caractère assez vériste, même si elle manque parfois d’un peu de puissance.
De puissance, l’Orchestre Colonne ne manque pas. Tout au long de l’heure et demie que dure l’ouvrage, la direction de Laurent Petitgirard ne faiblit jamais. L’orchestre, cordes solides, bois colorant de sombre l’atmosphère, porte à lui seul le décor et l’intrigue. Laurent Petitgirard a assurément transmis à ses musiciens le virus lyrique.
Jean-Guillaume Lebrun
Paris, Salle Pleyel, lundi 11 mai 2009
> Programme détaillé de la Salle Pleyel
> Lire les autres articles de Jean-Guillaume Lebrun
Photo : DR
Derniers articles
-
24 Avril 2024Alain COCHARD
-
24 Avril 2024Alain COCHARD
-
23 Avril 2024Alain COCHARD







